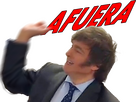Création de pays : Aetheria
Généralités :
Nom officiel : République populaire socialiste et écologique d'Aetheria
Nom courant : Aetheria
Gentilé : [à remplir] Aetheriens, Aetheriennes
Inspirations culturelles : Démocratie antique (Grèce), suisse contemporaine avec une forte influence socialiste et communiste axée sur le partage des richesses et l'écologie
Situation géographique :
Langue(s) officielle(s) : etherien (synthèse de langues latines et germaniques)
Autre(s) langue(s) reconnue(s) : Français, Allemand, Grec
Drapeau :

Devise officielle : Égalité, Participation, Harmonie
Hymne officiel :
1er couplet
Du peuple libre s'élève un chant,
Unis sous un ciel éclatant,
Aetheria, terre d’espérance,
Où règne en paix notre alliance.
Refrain
Égalité, force et lumière,
La voix du peuple est notre prière,
Chantons ensemble, fiers et unis,
Aetheria, notre pays !
2e couplet
Nos mains bâtissent l’avenir,
Chaque voix fait grandir l’empire,
Science et arts, flammes jumelles,
Guident nos âmes fraternelles.
Refrain
Égalité, force et lumière,
La voix du peuple est notre prière,
Chantons ensemble, fiers et unis,
Aetheria, notre pays !
Monnaie nationale : L'Éco-Sol
Capitale : Agora Nova
Population : 18 millions d'habitants
Aperçu du pays :
Présentation du pays :
Aetheria est une nation insulaire fondée sur les principes d’une démocratie directe, s’inspirant de la Suisse et des démocraties antiques. Son économie repose sur la collectivisation des moyens de production et un modèle coopératif où les travailleurs votent les décisions économiques. Cette approche garantit un équilibre entre initiative individuelle et bien commun.
Le pays impose des normes écologiques strictes pour minimiser l’impact environnemental de son industrie et de ses infrastructures. Chaque politique publique doit respecter des standards élevés de durabilité pour assurer un avenir viable.
La culture et les arts sont au cœur de l'identité nationale. L'État soutient la création artistique à travers des fonds publics et des coopératives culturelles, favorisant ainsi la diffusion de son patrimoine à l'international.
Aetheria est également un acteur majeur de la recherche scientifique et technologique, investissant massivement dans l'innovation écologique et les solutions technologiques à faible empreinte énergétique. L’efficacité et l’optimisation des ressources guident chaque avancée.
Chronologie historique d'Aetheria :
- 1860-1900 : Colonisation utopiste et ouvrière – Les fondations de l’égalité
- 1900-1930 : Essor industriel et premières luttes sociales – L’ombre du progrès
- 1930-1933 : Crises économiques
- 1933 : La Révolution populaire menée par Antoni Varkas
- 1939-1945 : Aetheria et la Seconde Guerre mondiale
- 1939-1945 : Un refuge pour les intellectuels, artistes et scientifiques persécutés Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, Aetheria adopte une posture de neutralité stricte, refusant toute participation militaire au conflit. Toutefois, son positionnement idéologique et démocratique attire rapidement l’attention des régimes autoritaires, qui voient en cette société égalitaire une menace à leur modèle de domination.
- 1946 : Proclamation de la République populaire socialiste d'Aetheria – Un nouveau départ démocratique
- 1950-1970 : Mise en place des Chambres Cantonales Populaires – L’équilibre entre collectivisation et autonomie locale
- 1975 : Première vague de réformes écologiques – L’héritage de Nadia Belova et la transition vers un modèle durable
- 1985 : Création de la Chambre Fédérale Populaire – L'institutionnalisation de la démocratie directe
- 1990-2000 : L’âge d’or culturel d’Aetheria sous l’impulsion de Dario Estevez
- Lucien Daervin (1835-1895) : Philosophe et penseur socialiste, il a posé les fondations de la pensée égalitaire et coopérative d’Aetheria. Son ouvrage L'Utopie Réelle a influencé les premières communautés ouvrières.
- Mira Kovac (1872-1938) : Syndicaliste et militante pour les droits des travailleurs, elle a organisé les grandes grèves du début du XXe siècle, plaidant pour une gouvernance ouvrière directe.
- Antoni Varkas (1898-1955) : Révolutionnaire et stratège politique, il a dirigé le soulèvement populaire de 1933, mettant fin à la domination des élites industrielles.
- Selena Arvidsson (1910-1970) : Première dirigeante d’Aetheria, elle a mené la transition démocratique et mis en place la Constitution participative.
- Ilias Montreau (1923-1988) : Économiste et architecte des Chambres Cantonales Populaires, il a créé un équilibre entre autonomie régionale et gouvernance fédérale.
- Nadia Belova (1940-2005) : Représentants délégués du peuple pour l’Environnement, pionnière de la première vague de réformes écologiques, elle a initié la transition vers les énergies propres.
- Gaspard Noiret (1955-2020) : Visionnaire du tirage au sort politique, il a conçu le modèle représentatif actuel d’Aetheria, combinant expertise et participation citoyenne.
- Dario Estevez (1968-) : Dario Estevez, figure emblématique du monde de l’art et intellectuel engagé, accède au poste de Délégué Populaire de la Culture et des Arts.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’île d’Aetheria, au climat rude rappelant celui de l’Islande, reste largement inhospitalière et inhabitée, hormis quelques communautés autochtones vivant en harmonie avec la nature. Les conditions extrêmes, l’absence de ressources minières majeures et l’isolement géographique dissuadent toute colonisation impérialiste ou industrielle, ce qui préserve la région des grandes rivalités européennes.
C’est dans ce contexte que Lucien Daervin, philosophe et militant socialiste français, voit dans ces terres vierges un terrain idéal pour l’expérience d’une société utopiste et égalitaire. À l’époque où l’Europe est secouée par la montée du capitalisme industriel et l’exploitation ouvrière, où les idées socialistes prennent de l’ampleur (notamment avec Le Capital de Karl Marx en 1867) et où des expériences de colonies anarchistes et coopératives émergent en Amérique du Sud et aux États-Unis (Colonie Icaria aux USA, Colonie Cecilia au Brésil), Aetheria apparaît comme une nouvelle terre d’asile, ouverte à tous ceux qui rêvent d’une alternative au monde capitaliste en plein essor.
Dès 1875, Daervin et une poignée de pionniers établissent la première coopérative ouvrière, refusant le principe de propriété privée des moyens de production. Ce projet attire des enthousiastes de toutes nationalités : des ouvriers français et allemands fuyant la répression post-Commune de Paris (1871), des socialistes russes et italiens cherchant à échapper à la censure et aux dictatures, mais aussi des intellectuels britanniques influencés par le mouvement coopératif de Robert Owen. On y trouve même des Américains déçus par l’échec des expériences socialistes dans leur propre pays. Tous convergent vers Aetheria, un territoire sans État, sans aristocratie et sans propriété foncière, où seul le travail collectif et la démocratie participative régulent la vie quotidienne.
Contrairement aux modèles coloniaux impérialistes qui marquent cette époque (comme la ruée vers l’Afrique entamée en 1884 par les grandes puissances européennes), la colonisation d’Aetheria repose sur un principe volontaire et inclusif, sans exploitation d’une population indigène, mais avec une tentative d’intégration harmonieuse des quelques autochtones présents. Ces derniers, bien que peu nombreux, transmettent aux colons leurs savoirs sur la survie dans cet environnement froid et hostile, notamment sur l’agriculture adaptée et la gestion des ressources naturelles.
Les premières décennies sont difficiles : les hivers sont rigoureux, les infrastructures quasi inexistantes, et l’organisation politique expérimentale. Mais l’idéal d’une démocratie directe, d’une économie basée sur la coopération, et d’une production respectueuse des ressources motive les habitants à persévérer. Lucien Daervin et ses partisans posent ainsi les bases d’une nation unique, façonnée non par la conquête, mais par le rêve partagé d’une société plus juste et plus humaine.
"Frères et sœurs de toutes nations, travailleurs, penseurs, rêveurs d’un monde meilleur !
Regardez autour de vous : dans chaque usine, chaque atelier, chaque mine, nos corps sont brisés par des machines qui n’appartiennent qu’à ceux qui ne travaillent pas. Nos vies sont rythmées par les ordres des maîtres, nos espoirs écrasés sous le poids de l’argent, et nos droits piétinés par des rois, des patrons et des marchands sans visage. Nous sommes ceux qui construisent les villes, cultivent les terres, et pourtant nous ne possédons rien.
Mais il existe une autre voie. Loin des chaînes du vieux monde, au cœur d’une terre libre et vierge, nous avons la possibilité d’écrire notre propre destin. Une terre où la richesse ne sera plus un privilège, où la justice ne sera pas l’outil des puissants, où chaque homme et chaque femme participera aux décisions de la communauté. Là-bas, en Aetheria, nous bâtirons un foyer pour tous ceux que l’oppression a rejetés, un refuge pour ceux qui croient encore en la fraternité des peuples.
Nous n’avons ni roi, ni maître, ni frontières. Nous avons le courage et la volonté. Nous avons les idées qui feront trembler les tyrans et briller l’avenir.
Alors, je vous le dis, venez ! Venez et prenez part à l’œuvre la plus grande de notre époque. Venez avec vos outils, vos esprits, vos espoirs ! Là-bas, au nord du monde, Aetheria attend ses enfants.”
Extrait du discours de Lucien Daervin – 1873

Le début du XXe siècle marque un tournant décisif pour Aetheria, qui passe d’une société utopiste agricole et artisanale à une nation en pleine industrialisation. Tandis que l’Europe et l’Amérique du Nord connaissent une explosion technologique avec l’essor du pétrole, de l’automobile et de l’électricité, Aetheria suit une trajectoire similaire, mais sous un modèle collectiviste. Les premiers hauts-fourneaux, les manufactures textiles et les usines de machines agricoles émergent, favorisant une autosuffisance économique et une modernisation rapide. Inspiré par le modèle des soviets en Russie après la Révolution de 1917, le pays met en place des conseils ouvriers pour gérer les usines et encadrer la production, mais la pression pour produire toujours plus entraîne une centralisation du pouvoir et l’apparition de nouvelles inégalités.
Les premières tensions apparaissent lorsque la hiérarchie informelle des coopératives se cristallise : certains dirigeants d’usines, bien que théoriquement élus, concentrent de plus en plus de pouvoir et privilégient les secteurs stratégiques au détriment des conditions de travail. Les anciennes valeurs de partage et de participation se heurtent aux réalités du développement industriel, où les cadences s’accélèrent et où les décisions deviennent de plus en plus technocratiques.
Face à ces dérives, une figure se distingue : Mira Kovac, ouvrière d’origine hongroise, qui devient la première grande leader syndicaliste d’Aetheria. Inspirée par le mouvement ouvrier international et notamment par la montée des luttes sociales aux États-Unis (grèves du textile en 1912 à Lawrence) et en Europe (grève générale britannique de 1926), Kovac fédère les travailleurs autour d’une revendication simple : le retour à la démocratie directe dans la gestion des entreprises et l’amélioration des conditions de travail.
Les grandes grèves de 1927 : un tournant pour Aetheria
En février 1927, après des années de frustrations, une vague de grèves paralyse le pays, notamment dans les secteurs de la métallurgie et de l’énergie. Les travailleurs réclament une semaine de travail de 40 heures, des congés payés et une participation réelle aux décisions industrielles. Dans les rues, des manifestations éclatent, et pour la première fois, l’idéal socialiste d’Aetheria semble en péril.
Le gouvernement, embarrassé, hésite à utiliser la force. Contrairement aux démocraties libérales où l’État sert de médiateur entre le capital et le travail, Aetheria ne possède pas de classe capitaliste dominante, ce qui rend le conflit interne encore plus explosif. Après plusieurs semaines de blocage, les syndicats obtiennent la mise en place d’une cogestion ouvrière plus stricte et une réforme du tirage au sort des dirigeants d’usines, garantissant une meilleure rotation des responsabilités.
Cet épisode marque un moment charnière : il prouve que même une société fondée sur des principes égalitaires n’est pas à l’abri des contradictions du progrès, et que la lutte sociale reste essentielle pour éviter la bureaucratisation du pouvoir. Mira Kovac devient une figure emblématique de la résistance ouvrière, et son héritage influencera les générations suivantes dans la gestion des institutions politiques et économiques du pays.
"Camarades, souvenez-vous de nos pères et mères qui sont venus en Aetheria avec un rêve : celui d’une terre sans maîtres, sans exploiteurs, où le travail ne serait pas une malédiction mais un droit et une fierté. Aujourd’hui, nous voyons nos idéaux se fissurer sous le poids des machines et des chiffres. Aujourd’hui, nous sommes pressés comme dans n’importe quelle usine de New York ou de Berlin, et pourtant, nous sommes censés être libres.
Nous ne nous battons pas contre des rois ou des patrons étrangers, mais contre notre propre indifférence, contre l’oubli de nos valeurs fondatrices. Nous ne demandons pas la charité. Nous demandons ce qui nous revient de droit : une voix dans l’organisation du travail, une justice pour nos corps brisés, une égalité réelle dans les décisions qui façonnent notre avenir.
Si nous cédons aujourd’hui, demain, nous serons des rouages, et après-demain, nous ne serons plus rien. Nous ne sommes pas une armée, nous ne sommes pas un parti, nous sommes la force du peuple uni. Debout, camarades ! Aetheria ne trahira pas son rêve !"
Extrait du discours de Mira Kovac – Mars 1927
Alors que le monde plonge dans une série de crises économiques et politiques dans les années 1930, Aetheria n’échappe pas aux bouleversements de l’époque. Tandis que les États-Unis font face à la Grande Dépression (1929), que l’Europe bascule vers les extrêmes avec l’ascension du nazisme en Allemagne et du fascisme en Italie, Aetheria voit son propre modèle social vaciller sous le poids des tensions économiques et des inégalités croissantes.
Après les grandes grèves de 1927, qui avaient permis une réforme du tirage au sort dans les usines et une meilleure cogestion ouvrière, le pays entre dans une période d’instabilité. L'industrialisation rapide a créé une élite technocratique au sein même des conseils ouvriers. Certains secteurs stratégiques (métallurgie, énergie, transport) concentrent le pouvoir entre les mains de gestionnaires influents, tandis que la population rurale et les petits artisans se sentent de plus en plus marginalisés. L’idéal démocratique d’Aetheria semble s’effacer au profit d’une bureaucratie industrielle naissante.

À partir de 1930, la crise internationale et la chute des exportations aggravent la situation. L’inflation monte, l’économie ralentit, et des tensions apparaissent entre les régons les plus industrialisés et les régions agricoles, qui dénoncent une répartition inégale des ressources.
C’est dans ce contexte explosif qu’émerge Antoni Varkas, un ouvrier métallurgiste charismatique et fervent défenseur du retour aux principes de la démocratie directe. Ancien militant syndical et vétéran des grèves de 1927, il s’impose comme le leader du mouvement populaire qui commence à gagner du terrain à partir de 1932. Inspiré par les insurrections ouvrières en Espagne (qui mèneront à la guerre civile en 1936) et les luttes antifascistes en Europe, Varkas appelle à une refondation complète du système politique d’Aetheria.
Le 1er mai 1933, alors que les manifestations du jour des travailleurs rassemblent une foule immense dans la capitale, le mouvement dégénère en soulèvement généralisé. Les quartiers industriels de la ville se mettent en grève, et des groupes de travailleurs organisent des assemblées spontanées, refusant de reconnaître l’autorité des technocrates en place. Les manifestations gagnent en intensité, et en juin 1933, les insurgés prennent le contrôle des institutions fédérales. Après des semaines de négociations et de tensions, les élites industrielles, prises au piège, sont contraintes de démissionner, mettant fin à une décennie de centralisation bureaucratique.
Antoni Varkas, acclamé par le peuple, proclame la période de transition démocratique et annonce une refonte totale des institutions politiques d’Aetheria. L’objectif : redonner le pouvoir aux citoyens par des formes de démocratie directe, tout en empêchant la concentration du pouvoir dans les mains d’une nouvelle élite.
La révolution de 1933 marque un tournant majeur dans l’histoire du pays. Elle prouve que même dans une société fondée sur des principes égalitaires, le pouvoir peut dériver vers une caste dirigeante si aucun contrôle démocratique n’est maintenu. Cette insurrection permet d’introduire des réformes structurelles profondes, qui aboutiront en 1946 à la création d’un système politique entièrement refondé.
Aetheria et la Seconde Guerre mondiale
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, Aetheria se retrouve dans une position délicate. Fidèle à sa politique de neutralité, le pays refuse d’entrer dans le conflit et adopte une posture diplomatique prudente. Cependant, sa position géographique stratégique, bien qu’isolée, attire l’intérêt des puissances belligérantes, notamment l’Allemagne nazie et l’Union soviétique.
Menaces extérieures :
Dès 1940, des tentatives d’espionnage et d’infiltration sont détectées. L’Allemagne nazie, en pleine expansion en Europe, tente d’obtenir le soutien d’Aetheria pour sa machine de guerre en promettant des accords économiques avantageux. De son côté, l’Union soviétique considère Aetheria comme un modèle socialiste intéressant mais perçoit son indépendance idéologique comme une menace potentielle.
Crise interne :
La Chambre Fédérale Populaire est divisée entre ceux qui prônent une coopération économique limitée avec les puissances européennes et ceux qui exigent un isolement total. Antoni Varkas, toujours influent, défend une ligne dure : aucune alliance avec des régimes totalitaires, qu’ils soient fascistes ou communistes.
Les pressions économiques :
À mesure que la guerre progresse, Aetheria fait face à un blocus commercial imposé par les deux camps, soucieux de restreindre les échanges avec ce pays neutre dont l’impartialité est perçue comme une menace stratégique, le rendant ainsi un ennemi potentiel aux yeux des belligérants.. Cette situation met à mal l’économie du pays, qui doit se tourner vers une autonomie énergétique et alimentaire accrue pour éviter l’effondrement.
L’"Épreuve de l’Hiver" (1942-1943) :
L’année 1942 est marquée par un hiver particulièrement rude, combiné à la pénurie de biens importés. Pour la première fois depuis sa fondation, Aetheria fait face à une crise humanitaire. Le gouvernement instaure une mobilisation générale des ressources, intensifiant la collectivisation agricole et mettant en place des plans d’urgence pour assurer la survie de la population.
Résistance et solidarité :
Malgré sa neutralité officielle, Aetheria devient un refuge pour des milliers d’exilés européens fuyant la guerre. Des intellectuels, des résistants antifascistes, des juifs persécutés et même des soldats déserteurs trouvent asile sur l’île. Cette politique d’accueil clandestine place le pays sous haute surveillance des puissances étrangères, mais Aetheria parvient à éviter l’intervention directe en maintenant un équilibre diplomatique précaire.
Fin du conflit et conséquences :
En 1945, avec la chute du Troisième Reich et la fin de la guerre en Europe, Aetheria sort de la guerre affaiblie économiquement mais renforcée politiquement. Son modèle de gouvernance participative, éprouvé par la crise, en ressort plus fort et inspire une nouvelle génération de dirigeants, prêts à refonder le pays sur des bases plus démocratiques et écologiques.
"Aetheria est née du refus des empires et des tyrannies. Nous ne nous soumettrons ni aux chants des dictateurs ni aux menaces des empires déclinants. Notre force, ce n’est pas notre armée, c’est notre unité, c’est notre peuple. Nous resterons un phare d’espoir dans ce monde en guerre. Mais que personne ne s’y trompe : si notre souveraineté est menacée, nous nous lèverons comme un seul homme pour défendre notre terre, notre liberté, et notre vision d’un monde où chacun est l’égal de l’autre. Aetheria ne tombera pas sous la botte des despotes, quels qu’ils soient.”
Extrait du discours d’Antoni Varkas – 1941 (Face aux tensions internationales)
Alors que l’Europe bascule dans l’horreur de la guerre et des persécutions, Aetheria devient un refuge pour les intellectuels, les artistes et les scientifiques persécutés par les régimes fascistes et totalitaires. Dès 1936, avec l’intensification des purges en Allemagne nazie, puis après l’invasion de la France en 1940, le pays voit affluer des artistes juifs, des écrivains surréalistes bannis, des musiciens censurés, et des scientifiques fuyant la répression idéologique.
Un exode artistique et intellectuel sans précédent
Parmi les figures marquantes de cette vague migratoire, on trouve :
- Des peintres et sculpteurs du Bauhaus allemand, contraints à l’exil après la fermeture de leur école en 1933.
- Des cinéastes et dramaturges juifs, fuyant les lois antisémites et la censure imposées par le régime nazi.
- Des compositeurs modernes, interdits en Italie et en Allemagne en raison de leurs expérimentations jugées "dégénérées".
- Des philosophes et penseurs marxistes et libertaires, contraints de fuir les purges staliniennes en URSS.
- Des scientifiques juifs et pacifistes, refusant de mettre leur savoir au service des technologies militaires destructrices en développement en Allemagne et aux États-Unis.
Aetheria, refuge des scientifiques pacifistes et des penseurs anti-militaristes
Dans le contexte de la guerre, les grandes puissances se lancent dans une course effrénée aux innovations scientifiques et technologiques à des fins militaires. Face à cette instrumentalisation de la science au profit de la guerre, Aetheria devient le sanctuaire des scientifiques refusant de collaborer avec l’industrie de la mort.
Des physiciens, chimistes, biologistes et ingénieurs juifs et pacifistes, menacés en Europe, trouvent refuge dans les laboratoires de recherche d’Aetheria. Parmi eux, on trouve :
- Des physiciens ayant fui l’Allemagne et refusant de travailler sur la bombe atomique.
- Des biologistes et médecins engagés contre les expériences eugénistes nazies.
- Des ingénieurs souhaitant développer des technologies civiles et non militaires.
Ces scientifiques, au lieu de se consacrer aux armes, orientent leurs recherches vers des avancées technologiques pacifiques et écologiques, jetant ainsi les bases du futur modèle énergétique et industriel d’Aetheria.
Un tournant pour la recherche scientifique et technologique
Cette vague d’intellectuels et de scientifiques marque le début d’une révolution dans la politique de recherche du pays. Plutôt que de financer une industrie militaire, Aetheria investit dans des technologies durables, des sources d’énergie alternatives et des avancées médicales.
Les travaux de ces chercheurs exilés ouvrent de nouvelles perspectives en énergie renouvelable, en physique des matériaux et en médecine sociale, faisant d’Aetheria un pôle d’innovation unique au monde. En 1944, la Chambre Fédérale Populaire adopte le Pacte pour la Recherche Éthique, une loi interdisant toute militarisation de la science et garantissant la liberté académique des chercheurs.
Conséquences après 1945 : un modèle d’inspiration mondiale
À la fin de la guerre, en 1945, Aetheria sort renforcée sur le plan culturel et scientifique. Si le pays a souffert économiquement du blocus commercial, il a gagné en influence en devenant le symbole d’une alternative possible à la domination capitaliste et autoritaire.
Les scientifiques et intellectuels qui s’y sont réfugiés contribuent à faire d’Aetheria un laboratoire d’idées et d’expérimentations sociales, artistiques et technologiques, un rôle qu’elle conservera tout au long du XXe siècle.
"Dans un monde où l’on demande aux savants de bâtir des machines à tuer, nous, peuple d’Aetheria, déclarons que la science ne sera jamais esclave de la destruction.
À ceux qui cherchent une terre où la recherche sert la vie et non la mort, où l’intelligence est guidée par l’éthique et non par la guerre, où l’avenir se construit dans l’innovation et non dans la peur, nous ouvrons nos portes.
Ici, la science sera au service de l’humanité, et non des empires."
Extrait du manifeste de 1943 sur la science et la liberté en Aetheria

Après des décennies de luttes sociales, une révolution populaire et une Seconde Guerre mondiale qui a fragilisé le pays économiquement tout en renforçant son rôle de refuge pour les artistes et scientifiques persécutés, Aetheria entre dans une nouvelle ère en 1946.
À la suite de la révolution de 1933, menée par Antoni Varkas, le pays était entré dans une période de transition démocratique marquée par des réformes progressives mais encore instables. Avec la fin du conflit mondial, il devient évident qu’un nouveau cadre politique est nécessaire pour garantir la stabilité du pays et éviter que les erreurs du passé — concentration du pouvoir dans les conseils ouvriers et montée d’une bureaucratie technocratique — ne se reproduisent.
Selena Arvidsson, figure de la refondation démocratique
Dans ce contexte, une figure émerge : Selena Arvidsson, juriste et militante politique, issue du mouvement ouvrier et profondément influencée par les principes de démocratie participative et d’autogestion. Elle a joué un rôle clé dans la rédaction d’un nouveau modèle constitutionnel, inspiré des idéaux fondateurs d’Aetheria mais adapté aux défis du XXe siècle.
Le 12 juillet 1946, devant une foule rassemblée sur la grande place d’Agora Nova, elle proclame officiellement la République populaire socialiste d'Aetheria et présente la nouvelle Constitution, qui instaure :
- Une démocratie participative totale, où les citoyens ne se contentent pas d’élire des représentants, mais participent directement aux décisions majeures via des référendums et des assemblées populaires.
- Un modèle d’autogestion des travailleurs, où toutes les entreprises et institutions sont dirigées collectivement par les employés et citoyens impliqués, supprimant ainsi toute forme de hiérarchie autoritaire.
- Un engagement écologique et social, intégrant des principes de développement durable et de protection des ressources naturelles, influencés par les travaux des scientifiques exilés durant la guerre.
Une proclamation qui résonne dans un monde en reconstruction
La proclamation de la République populaire socialiste d’Aetheria en 1946 ne passe pas inaperçue sur la scène internationale. Alors que l’Europe est divisée entre le bloc occidental capitaliste et le bloc soviétique communiste, Aetheria refuse de s’aligner sur l’un ou l’autre, affirmant son modèle unique de socialisme démocratique, non autoritaire et écologique.
Un moment d’unité et d’espoir
Le 12 juillet 1946 restera dans l’histoire d’Aetheria comme le jour où la nation s’est pleinement réappropriée son destin. Après des années de crises, de conflits et d’isolement, elle affirme une vision politique inédite, fondée sur la souveraineté populaire, la justice sociale et la démocratie directe.
L’image de Selena Arvidsson, debout sur le perron du nouveau bâtiment fédéral, levant la Constitution sous les acclamations du peuple, devient un symbole puissant de cette nouvelle ère.
"Citoyens d’Aetheria, notre nation a connu l’oppression, l’injustice et la guerre. Nous avons vu nos idéaux menacés par la bureaucratie, puis par la tyrannie des empires. Nous avons résisté. Nous avons tenu.
Aujourd’hui, nous proclamons la République populaire socialiste d’Aetheria, non comme un simple gouvernement, mais comme un serment solennel à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui viendront après nous.
Nous refusons que le pouvoir appartienne à une caste, à un parti, à une élite technocratique ou militaire. Il appartient au peuple, et au peuple seul.
Nous déclarons qu’aucun citoyen ne devra travailler sous la contrainte d’un maître, qu’aucune loi ne pourra être imposée sans le consentement du peuple, que notre terre ne servira jamais à nourrir la guerre, mais seulement la vie.
Aetheria ne sera pas un État parmi d’autres. Nous serons la preuve vivante qu’une autre voie est possible. Une voie où l’intelligence, la solidarité et la justice forment les piliers de la société.
Peuple d’Aetheria, ce jour est le vôtre. Bâtissons ensemble l’avenir que nous méritons !"
Extrait du discours de Selena Arvidsson – 12 juillet 1946

Après la proclamation de la République populaire socialiste d'Aetheria en 1946, le pays se trouve confronté à un défi majeur : transformer les idéaux démocratiques et socialistes en un système économique et institutionnel fonctionnel. La question centrale devient alors : comment organiser la production et la prise de décision économique sans tomber dans une bureaucratie centralisée ni dans un modèle anarchique déstructuré ?
C’est dans ce contexte que Ilias Montreau, économiste visionnaire et ancien militant du mouvement ouvrier, est chargé de structurer un modèle économique basé sur l’autogestion et la coopération. Inspiré par les expérimentations de l’autogestion yougoslave sous Tito, mais aussi par les théories anarcho-communistes et les premiers travaux sur l’économie décentralisée, Montreau propose une solution inédite : les Chambres Cantonales Populaires.
1952 : Création des Chambres Cantonales Populaires – Une démocratie économique locale
Plutôt que de concentrer la gestion économique au niveau national, Montreau défend l’idée que chaque région d’Aetheria doit être maître de son développement. Ainsi, en 1952, le gouvernement met en place les Chambres Cantonales Populaires, qui deviennent les véritables piliers de l’économie et de la gouvernance locale.
Ces chambres ont pour mission de :
- Superviser l’activité économique locale, en garantissant que les entreprises collectivisées fonctionnent selon les principes d’équité et de durabilité.
- Assurer la gestion des services publics (éducation, santé, transports) en fonction des besoins spécifiques de chaque canton.
- Organiser la redistribution des richesses entre les communes, évitant ainsi que certaines régions deviennent plus puissantes que d’autres.
- S’assurer que toutes les décisions économiques soient validées par des assemblées locales, garantissant ainsi un contrôle démocratique direct des travailleurs et des citoyens.
L’un des principes fondamentaux de ce modèle est l’absence de dirigeants permanents : chaque membre des Chambres Cantonales est tiré au sort parmi les travailleurs et citoyens engagés, et son mandat est limité à 5 ans. Cette mesure empêche la formation d’une élite bureaucratique et garantit un renouvellement constant des idées et des pratiques.
La collectivisation des moyens de production – Une alternative au modèle soviétique
Là où l’URSS impose une nationalisation totale et une planification rigide de l’économie, Aetheria choisit une voie hybride, alliant autogestion locale et coordination fédérale.
Sous la supervision d’Ilias Montreau, une vague de collectivisation progressive est mise en œuvre entre 1955 et 1965. Cependant, contrairement aux expériences soviétiques où la collectivisation s’est souvent accompagnée de violences et de confiscations, en Aetheria, ce processus est volontaire et géré par les citoyens eux-mêmes.
Une politique économique et écologique avant-gardiste
L’essor industriel d’Aetheria dans les années 1950 s’accompagne d’une prise de conscience écologique. Contrairement aux autres puissances industrielles qui exploitent massivement leurs ressources naturelles sans considération pour l’environnement, Aetheria adopte dès 1960 une politique de développement durable.
Ilias Montreau propose un concept novateur pour l’époque : le développement économique ne doit pas se faire au détriment de la nature. Sous son impulsion, plusieurs mesures sont mises en place :
- Des quotas stricts d’exploitation des ressources naturelles, afin d’éviter leur épuisement.
- Un programme de reforestation et de préservation des écosystèmes, en parallèle de l’industrialisation.
- L’interdiction des industries polluantes, notamment dans les secteurs de la chimie et de l’extraction minière.
Ainsi, bien avant la montée des préoccupations environnementales dans le reste du monde, Aetheria se positionne comme un modèle pionnier en matière d’écologie et de production responsable.
Des tensions internes : opposition entre localisme et centralisation
Malgré le succès apparent du modèle des Chambres Cantonales, des tensions émergent à partir de la fin des années 1960. Deux camps s’affrontent :
1- Les régionalistes, qui veulent donner encore plus d’autonomie aux cantons, quitte à affaiblir la coordination fédérale.
2- Les fédéralistes, qui estiment que sans un minimum de planification nationale, les inégalités risquent de se creuser entre les cantons les plus riches et les plus pauvres.
Ilias Montreau, lui, défend une voie médiane, où les cantons restent autonomes tout en acceptant une redistribution équitable des richesses. Cette position finit par s’imposer avec l’adoption, en 1968, du Pacte de Coopération Cantonale, qui garantit que chaque canton contribue proportionnellement à l’économie nationale, sans perdre son autonomie décisionnelle.
Un héritage durable
Grâce aux réformes initiées par Ilias Montreau, Aetheria se dote d’un système économique unique au monde, combinant démocratie directe, autogestion et développement durable.
Loin des modèles centralisés soviétiques ou des économies libérales occidentales, les Chambres Cantonales Populaires deviennent le cœur battant du pays, assurant une gouvernance locale efficace et empêchant la concentration des pouvoirs.
L’héritage de cette période est immense :
Le modèle économique aetherien inspire des mouvements autogestionnaires en Amérique latine et en Europe dans les années 1970.
Les principes écologiques posés dès les années 1960 permettent à Aetheria d’être en avance sur le reste du monde dans les décennies suivantes.
Le modèle de tirage au sort des représentants cantonaux devient une référence pour les démocraties directes expérimentales.
"Citoyens d’Aetheria, l’avenir ne se construira pas dans les palais d’une élite bureaucratique, ni dans les bureaux d’une administration lointaine. Il se bâtira dans nos usines, nos fermes, nos villages, nos cantons.
Nous avons prouvé qu’une économie peut être forte sans exploiter les travailleurs, sans sacrifier l’environnement, sans tomber dans la tyrannie de la centralisation ou du profit individuel.
Aetheria ne sera jamais un empire, ni une machine technocratique. Elle sera une fédération d’hommes et de femmes libres, où chaque canton, chaque village, chaque citoyen est une pierre de l’édifice commun.
N’oubliez jamais : notre richesse n’est pas dans les banques, mais dans notre peuple.”
Extrait du discours d’Ilias Montreau – 1965

Alors que le reste du monde est en pleine expansion industrielle effrénée, Aetheria amorce un virage radical vers l’écologie, devenant l’un des premiers États à faire de la protection de l’environnement une priorité politique et économique.
Dans les années 1970, les grandes puissances mondiales sont dominées par la logique de la croissance à tout prix :
Les États-Unis et l’URSS rivalisent dans la course technologique et industrielle, sans se soucier des conséquences environnementales.
L’Europe de l’Ouest connaît les chocs pétroliers de 1973 et 1979, qui révèlent la dépendance énergétique du monde occidental.
La Chine entame son industrialisation massive, suivant le modèle soviétique de développement accéléré.
Dans ce contexte, Aetheria fait figure d’exception, sous l’impulsion d’une femme déterminée : Nadia Belova, Représentante déléguée du peuple pour l’Environnement.
Nadia Belova : l’architecte de la révolution écologique
D’origine modeste, Nadia Belova est une scientifique et militante écologiste qui s’est fait remarquer dans les années 1960 pour ses recherches sur l’impact des industries polluantes sur la biodiversité. Après avoir participé aux réformes économiques mises en place par Ilias Montreau, elle devient en 1970 la première Représentante déléguée du peuple pour l’Environnement, un poste nouvellement créé au sein de la Chambre Fédérale Populaire.
Belova est profondément influencée par les premiers mouvements écologistes qui émergent dans le monde :
- La publication du rapport "The Limits to Growth" par le Club de Rome en 1972.
- La première conférence des Nations Unies sur l’environnement à Stockholm en 1972.
- Les luttes des premiers mouvements écologistes occidentaux, dénonçant la pollution industrielle et les dangers du nucléaire.
À la différence des pays occidentaux, où les préoccupations écologiques restent secondaires face aux impératifs économiques, Aetheria prend une position radicale : l’environnement devient un pilier central des politiques publiques.
Les réformes écologiques de 1975 : un tournant historique
Sous la direction de Nadia Belova, le gouvernement adopte en 1975 une série de réformes majeures qui transforment l’économie aetherienne :
1. Interdiction des industries polluantes
- Fermeture progressive des usines les plus polluantes, notamment celles basées sur le charbon et les hydrocarbures.
- Restriction des industries chimiques, en particulier celles utilisant des procédés toxiques pour les sols et les eaux.
- Mise en place de réglementations strictes sur les émissions de CO₂ et les déchets industriels.
2. Développement des énergies renouvelables
- Lancement du Plan Énergie 2000, un programme visant à faire d’Aetheria une nation 100 % indépendante énergétiquement en misant sur :
- L’énergie hydraulique, exploitant les nombreuses rivières du pays.
- L’éolien et le solaire, développés de manière expérimentale grâce aux recherches scientifiques initiées dans les années 1940 par les exilés européens.
- La biomasse, avec des investissements massifs dans la méthanisation et l’exploitation durable des forêts.
- La géothermie, inspirée du modèle islandais, tirant parti des sols volcaniques et de l’activité tectonique du territoire d’Aetheria pour produire une énergie propre et stable. Cette innovation permet au pays de réduire considérablement sa dépendance aux combustibles fossiles et devient un axe majeur de la transition énergétique.
3. Reforestation et préservation des ressources naturelles
- Création des Premières Réserves Naturelles Nationales, sanctuarisant 30 % du territoire contre toute activité industrielle.
- Programme national de reforestation et d’agriculture biologique, interdisant les pesticides et les engrais chimiques sur l’ensemble du territoire.
4. Une économie circulaire et anti-gaspillage
- Mise en place d’un modèle économique fondé sur la récupération et le recyclage, réduisant la dépendance du pays aux importations.
- Expérimentation de systèmes de production en circuit fermé, où chaque déchet devient une ressource pour un autre secteur.
Une résistance et des débats politiques intenses
Ces réformes audacieuses ne sont pas acceptées sans résistances. Une partie des élites industrielles et des techniciens du secteur énergétique s’opposent à cette transition, arguant que l’interdiction des énergies fossiles risque de fragiliser l’économie et de freiner la modernisation du pays.
De nombreux débats ont lieu au sein des Chambres Cantonales Populaires, où certains craignent que la transition écologique se fasse au détriment de l’emploi. Toutefois, Nadia Belova défend sa vision avec fermeté.
Plutôt que de supprimer des emplois, l’industrie verte doit en créer de nouveaux, en formant les ouvriers aux nouvelles technologies renouvelables.
Plutôt que de subir la crise énergétique mondiale comme les autres pays, Aetheria doit devenir indépendante et autosuffisante en anticipant les défis de l’avenir.
Ses arguments finissent par convaincre une majorité de la population, et en 1975, le plan de transition écologique est validé par référendum national avec 68 % de votes favorables.
L’impact des réformes de 1975 : un modèle pionnier
La première vague de réformes écologiques menée par Nadia Belova fait d’Aetheria un modèle d’avant-garde en matière de développement durable.
Dès 1980, le pays réduit sa dépendance aux énergies fossiles de 70 %, une prouesse inédite dans le monde.
En 1985, les industries vertes génèrent plus d’emplois que les secteurs traditionnels, prouvant la viabilité du modèle.
Aetheria devient une référence internationale, inspirant les premiers débats écologistes en Europe et attirant des chercheurs du monde entier.
Alors que dans les années 1980, la plupart des pays continuent à développer le nucléaire et le pétrole, Aetheria démontre qu’une autre voie est possible : une économie forte et durable, en harmonie avec la nature.
"Nous avons cru, pendant trop longtemps, que la croissance était infinie. Que nous pouvions prendre à la Terre sans jamais lui rendre. Mais aujourd’hui, nous faisons face à une réalité : si nous continuons sur cette voie, nous courons à notre perte.
Aetheria ne sera pas un pays qui détruit pour s’enrichir. Nous prouvons aujourd’hui que prospérité et respect de la nature peuvent aller de pair. Nous montrons au monde que l’économie n’a de sens que si elle sert la vie, et non l’inverse.
Nos rivières, nos forêts, nos terres ne sont pas des ressources à exploiter, mais un héritage à préserver. Et ce que nous construisons aujourd’hui, c’est le legs que nous laisserons aux générations futures.
Aetheria ne suivra pas le monde dans sa folie industrielle. Aetheria ouvrira la voie d’un futur où l’homme et la nature coexistent en équilibre.”
Extrait du discours de Nadia Belova – 1975

Alors qu'Aetheria s'affirme comme un modèle de démocratie participative et d'économie durable, une question fondamentale demeure en suspens : comment garantir un équilibre entre l'expertise nécessaire à la gestion d'un État moderne et la souveraineté populaire ?
Dans les années 1980, le monde est marqué par des mutations profondes :
- Les démocraties occidentales sont de plus en plus critiquées pour leur bureaucratie lourde et la montée du néolibéralisme.
- Le bloc soviétique s’enlise dans une centralisation excessive, avec une élite technocratique coupée du peuple.
- Les crises économiques et environnementales commencent à questionner les modèles traditionnels de gouvernance.
Face à ces défis, Gaspard Noiret, philosophe politique et économiste influent, propose un modèle inédit : l'officialisation du tirage au sort comme mécanisme central du pouvoir législatif.
Gaspard Noiret et la refonte du système politique
Depuis les réformes initiées après 1946, les Chambres Cantonales Populaires assurent la gestion locale, tandis que le gouvernement fédéral joue un rôle de coordination nationale. Cependant, l'absence d'une chambre fédérale représentative crée des tensions croissantes :
- Les décisions nationales manquent de cohérence et varient trop selon les influences locales.
- Certains citoyens estiment que le système reste trop influencé par des élites politiques et économiques, malgré l’absence de partis.
- L’expertise devient un enjeu : comment prendre des décisions complexes (technologie, écologie, diplomatie) sans tomber dans une technocratie opaque ?
C’est dans ce contexte que Gaspard Noiret plaide pour la création d’une Chambre Fédérale Populaire, chargée de traiter les grandes orientations politiques du pays tout en garantissant un contrôle citoyen.
2. Création de la Chambre Fédérale Populaire
- Membres : Composée de 40 représentants, tirés au sort parmi les listes de prétendants désignés par les Chambres Cantonales.
Rotation et remplacement : Lorsqu’un citoyen est tiré au sort pour intégrer la Chambre Fédérale, il est remplacé dans la Chambre Cantonale par un tirage au sort parmi la population civile, garantissant un renouvellement dynamique et équilibré du pouvoir.
- Compétences : La Chambre Fédérale statue sur les grandes orientations nationales, notamment la politique étrangère, la diplomatie, la fiscalité, et la coordination des infrastructures.
3. création du Conseil des Sages : Organe de contrôle et de conseil législatif
- Membres : 10 experts élus par la Chambre Fédérale. Lorsqu’un citoyen est élu au Conseil des Sages, il est remplacé par tirage au sort dans la Chambre Fédérale.
- Pouvoirs :
1- Peut bloquer et censurer une loi jugée incohérente ou contraire aux principes fondamentaux du pays.
2- Toutefois, une loi censurée peut être soumise à un référendum national, qui tranche définitivement.
3- Si le Conseil bloque trois lois consécutives sans organiser de référendum, il est soumis à un vote de confiance national.
"Nous avons cru, pendant trop longtemps, que la démocratie signifiait élire quelques représentants et leur abandonner le pouvoir.
Aujourd’hui, nous brisons cette illusion. Le peuple n’a plus à déléguer sa voix : il la porte directement, à chaque instant.
Nous avons prouvé qu’un pays peut être gouverné sans politiciens de métier, sans partis, sans luttes de pouvoir, mais par une rotation constante de citoyens investis.
Nous faisons aujourd’hui un pari sur l’avenir. Un avenir où chaque citoyen est un législateur, où chaque voix compte, où la politique n’est plus un privilège, mais un devoir partagé.
Peuple d’Aetheria, ce jour marque le début d’une démocratie véritable, une démocratie qui appartient à chacun d’entre vous.”
Extrait du discours de Gaspard Noiret – 1985

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Aetheria s’est imposée comme un havre pour les artistes, les intellectuels et les créateurs du monde entier, attirés par son climat politique libre, sa démocratie participative et son soutien massif à la culture et aux arts. Dès les années 1950, sous la direction de Selena Arvidsson, le pays a mis en place une politique ambitieuse de soutien aux artistes persécutés, notamment dissidents politiques et avant-gardistes censurés par les régimes autoritaires.
Cette ouverture a transformé Aetheria en terre d’accueil pour une nouvelle vague artistique, favorisant l’essor de mouvements novateurs en peinture, littérature, cinéma et musique, souvent en rupture avec les modèles traditionnels. Dans les décennies suivantes, grâce aux politiques menées par les Chambres Cantonales Populaires, la culture devient un levier de diplomatie et d’influence internationale, permettant à Aetheria de se distinguer face aux géants culturels que sont les États-Unis et l’Europe de l’Ouest.
En 1990, Dario Estevez, figure emblématique du monde de l’art et intellectuel engagé, accède au poste de Délégué Populaire de la Culture et des Arts. Son ambition est claire : faire d’Aetheria une capitale mondiale de la création artistique et intellectuelle, où les artistes de toutes origines trouveraient les meilleures conditions possibles pour s’exprimer librement.
Dario Estevez : Le stratège de l’influence culturelle
Dario Estevez, né en 1952 dans une famille d’immigrés espagnols ayant fui le franquisme, grandit dans un milieu marqué par l’effervescence culturelle et les débats intellectuels. Pianiste, écrivain et défenseur des arts, il comprend très tôt que la culture n’est pas seulement une expression artistique, mais aussi un outil de pouvoir, d’émancipation et de diplomatie.
Dès son entrée en fonction en 1990, il met en place un plan culturel audacieux, structuré autour de trois axes majeurs :
1. Un soutien massif à la production artistique nationale
Afin de renforcer l’identité culturelle d’Aetheria et de faire émerger une scène artistique de classe mondiale, Estevez impulse une politique de financement sans précédent :
- Un budget de la culture revu à la hausse, atteignant 8 % du PIB – un record mondial.
- Un système de subventions garanti à vie pour les artistes, permettant aux créateurs de se consacrer pleinement à leur art sans dépendre du marché privé.
- La création du Fonds National des Arts et Lettres, qui finance directement les projets de films, d’opéras, de peintures, de sculptures et de productions théâtrales sans critère de rentabilité économique.
- La mise en place de résidences d’artistes gratuites, ouvertes aussi bien aux citoyens d’Aetheria qu’aux talents internationaux.
Grâce à cette politique, Aetheria voit émerger une nouvelle génération d’artistes révolutionnant la scène mondiale, dans des domaines aussi variés que le cinéma d’auteur, les arts numériques, la musique expérimentale et le théâtre d’avant-garde.
2. Rayonnement international et diplomatie culturelle
Comprenant que l’influence culturelle est un levier diplomatique aussi puissant que l’économie ou la technologie, Estevez pousse Aetheria à étendre son rayonnement international :
- Création du "Pacte Culturel d’Aetheria", une série d’accords bilatéraux permettant aux artistes étrangers de bénéficier des mêmes droits et subventions que les citoyens aetheriens.
- Expansion des Instituts Culturels Aetheriens (ICA) dans plus de 50 pays, à l’image de l’Alliance Française ou du Goethe-Institut, pour promouvoir la culture et la langue aetherienne.
- Organisation du "Festival International d’Aetheria", un événement artistique multidisciplinaire attirant des créateurs du monde entier, rapidement considéré comme un équivalent du Festival de Cannes ou de la Biennale de Venise.
- Signature de partenariats avec Hollywood, Bollywood et le cinéma européen, permettant aux réalisateurs aetheriens de coproduire des films à portée mondiale.
Grâce à ces initiatives, Aetheria devient un pôle d’attraction culturelle majeur, rivalisant avec Paris, New York et Tokyo.
3. Aetheria, terre d’accueil des artistes dissidents et des avant-gardes
Fidèle à son héritage d’asile culturel, Estevez renforce la politique d’accueil des artistes persécutés :
- Mise en place du Statut d’Artiste Réfugié, offrant une nationalité automatique à tout créateur censuré dans son pays d’origine.
- Un programme de protection pour les intellectuels menacés, leur permettant de poursuivre leurs recherches et publications en toute sécurité.
- Création de l’Académie des Arts Libres, un centre dédié aux artistes en exil, favorisant l’échange entre cultures et disciplines artistiques.
Dans les années 1990, alors que plusieurs régimes autoritaires répriment les voix dissidentes (Chine, Iran, Russie, Moyen-Orient, Amérique latine), Aetheria devient un sanctuaire pour les créateurs engagés, accueillant des milliers d’artistes en quête de liberté.
Figures politiques majeures d'Aetheria :








Mentalité de la population :
Les Aetheriens sont profondément attachés à la démocratie participative et au partage équitable des ressources. La population valorise la transparence, la coopération et le respect de l’environnement. L'implication citoyenne est un pilier central de la société, avec des référendums réguliers sur les décisions majeures.
Place de la religion dans l'État et la société :
Aetheria est un État strictement laïc, garantissant la liberté de culte tout en limitant l'influence religieuse sur les décisions politiques. Les croyances individuelles sont respectées, mais les institutions religieuses n'interviennent pas dans la gestion publique.
Politique et institutions :
Institutions politiques :
Aetheria est divisée en quatre cantons, chacun doté d’un parlement propre, en charge de la politique industrielle, économique, écologique et des services publics.

Deux chambres législatives structurent le gouvernement :
- Chambres Cantonales Populaires : Assemblées législatives locales propose et vote des lois spécifiques à son canton. Constituées de 80 élus tirés au sort pour un mandat de 5 ans. Un élu peut être destitué par un référendum cantonal si une pétition atteint 1 million de signatures. En cas de destitution, un nouveau tirage au sort est organisé.
- Chambre Fédérale Populaire : Organe législatif national qui statue sur les grandes questions nationales, notamment la politique étrangère, la diplomatie, les impôts, les grandes orientations industrielles, culturelles et administratives des services publics. Composée de 40 représentants tirés au sort dans la liste des prétendants. Ces 40 élus sont remplacés dans la Chambre Cantonale par un tirage au sort parmi la population civile.
- Conseil des Sages : Organe consultatif composé de spécialistes élus par la Chambre Fédérale Populaire pour donner un avis technique sur les décisions. Ils ont le pouvoir de bloquer et censurer une loi, mais la décision finale de son acceptation peut passer par un référendum national. Si le Conseil refuse d'organiser un référendum pour statuer sur une censure, au bout de trois censures consécutives sans référendum, il doit se soumettre à un vote de confiance national. Si la majorité des citoyens vote contre le Conseil, un nouveau tirage au sort est organisé pour le renouveler. Si cinq censures sont confirmées par référendum national sur des lois émises par la Chambre Fédérale, celle-ci est dissoute et un nouveau tirage au sort est effectué pour renouveler la Chambre Fédérale. Composé de 10 membres élus par la Chambre Fédérale. Ces 10 membres sont remplacés à la Chambre Fédérale par un tirage au sort. Ils sont chargés d’émettre des avis techniques et peuvent censurer une loi, bien que cette décision puisse être contredite par référendum national.
- Représentants délégués du peuple : Désignés par la Chambre Fédérale Populaire pour traiter des sujets spécifiques dans les discussions internationales.
- Tribunal du Peuple : Plus haute institution judiciaire, composé à parts égales de professionnels du droit et de jurés tirés au sort. Cette structure garantit un jugement équilibré et représentatif de la société.
Chaque année, chaque Chambre Cantonale sélectionne 50 prétendants à la Chambre Fédérale Populaire : 25 issus de la Chambre Cantonale et 25 de la société civile, choisis sur critères de mérite et d'engagement.
Principaux personnages :
- Lucia Armandi – Déléguée du peuple aux affaires étrangères.
- Yanis Kosmas – Délégué du peuple à l'économique supervisant les coopératives nationales.
- Nadia Orlov – Déléguée du peuple à l'environnementale et transition énergétique.
- Aimé Levrenti – Délégué du peuple à la culture et aux arts, garant du rayonnement artistique national.
- Li Ann Voss – Déléguée du peuple à la recherche scientifique et aux innovations écologiques.





Politique internationale :
Aetheria défend une diplomatie basée sur la coopération, la durabilité et la justice sociale. Refusant toute hégémonie militaire, elle favorise la médiation et l’innovation comme levier d’influence. Le pays adopte une position de neutralité stricte dans les conflits internationaux et interdit toute ingérence militaire. L'armée est exclusivement chargée de défendre les frontières et la souveraineté nationale.