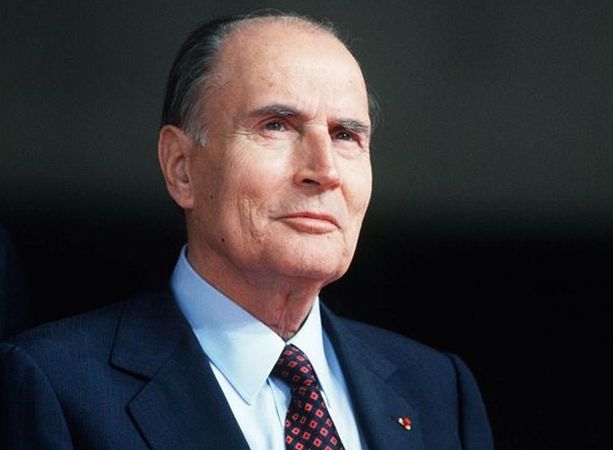Retrouvez ici la liste exhaustive des personnages, des partis, des entreprises, des associations et de toutes les entités importantes de Messalie.
ALMIRANTE - Elisabeth d'Almirante
CARRIEU - Paul Carrieù (décédé)
CASTELAN - Zacharia Castelan
FLAVONI - Antonin Flavoni
FREYCINET - Manuel-Marco Freycinet (décédé)
FREYCINET - Pierre Freycinet (décédé)
GRÉSILVAUDAN - Jean Martin Paul Théodard de Grésilvaudan
MERCIER - Antigone Mercier
MITSAR - Etienne Mitsar
MOREIRA - Maximilien Moreira
MUSAVU - Gabriel Anate Musavu
NAGY-BOCSA - Alexandre Nagy-Bocsa
NAGY-BOCSA - Lorenzo Nagy-Bocsa
NAGY-BOCSA - Raoul Nagy-Bocsa (décédé)
PETRUCCI - Jacomo Petrucci
SOLEDANO - Édouard Laurens Soledano
TOMARELS - Léandre Garras de Tomarels
TADJAR - Mustafa Tadjar Khan
VEYCIN DE CAUSANS - Ophélie Veycin de Causans
WATTREAU - Jocelyne Wattreau
[indent-right=65%][quote]Joueur : [b]Timour[/b][/quote][/indent-right]
[center][img=lien]mot[/img][/center]
[justify][indent=8%][indent-right=8%][size=1.2][b]Carte d’identité :[/b][/size]
Âge :X ans.
Genre : masculin/féminin.
Lieu de naissance : ville X, province de Y.
Nationalité : Messaliote.
Statut conjugal :
Fonction : [b]fonction[/b]
Parti politique :
[size=1.2][b]Citations :[/b][/size]
[center][i]« citation »[/i]
[size=0.85]Origine de la citation[/size][/center]
[b]Biographie :[/b]
[b]Personnalité :[/b]
[b]Chronologie[/b]
Date — événement
[/indent-right][/indent][/justify]
Atlas des provinces de Messalie
Forteresse d'Aiglefer
Hôtel de Coeur
Hôtel des Couteliers
[b]Type :[/b]
[b]Lieu :[/b]
[b]Date de construction :[/b]
[b]Fonction :[/b]
[b]Description :[/b]
[center][img=liendelimage]image[/img][/center]
[b]Histoire :[/b] histoire
[/indent-right][/indent][/justify]
Club des Phalanges
L'Olivier
Parti chrétien-démocrate
Parti écologique messaliote
Parti eurycommuniste
Parti protestant messaliote
Parti réformateur
Parti républicain
Parti scientifique libertaire
Les Prométhéens
L'Union
[center][img=lien]image[img]
[i]legende[/i][/center]
[b][size=1.2]Couleur[/size][/b]
[b][size=1.2]Présidence[/size][/b]
[justify][indent=8%][indent-right=8%][b][size=1.2]Origines[/size][/b]
[b][size=1.2]Idéologie[/size][/b]
[b][size=1.2]Projets[/size][/b]
[b][size=1.2]Popularité et électorat[/size][/b]
[b][size=1.2]Représentation politique[/size][/b]
[/indent-right][/indent][/justify]
Banque Océane
Casinos Nérème
EURYCOPTER
Grand Clinique
Il Tempo
Union Générale (syndicat)
[center]
[size=1.5][b]Nom[/b][/size][/center]
[indent=6%][indent-right=6%][b]Type :[/b]
[b]Fondation :[/b]
[b]Activités :[/b]
[b]Gouvernance :[/b]
[b]Siège social :[/b]
[center]image eventuelle[/center]
[b]Aperçu :[/b]
[b]Histoire :[/b][/indent-right][/indent]
Fiche de présentation
Histoire contemporaine de Messalie
Histoire de la droite politique messaliote
Régime social général