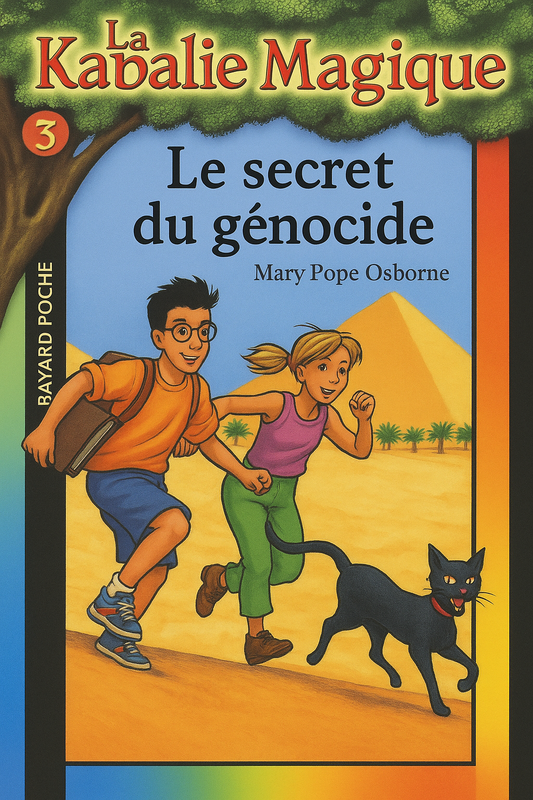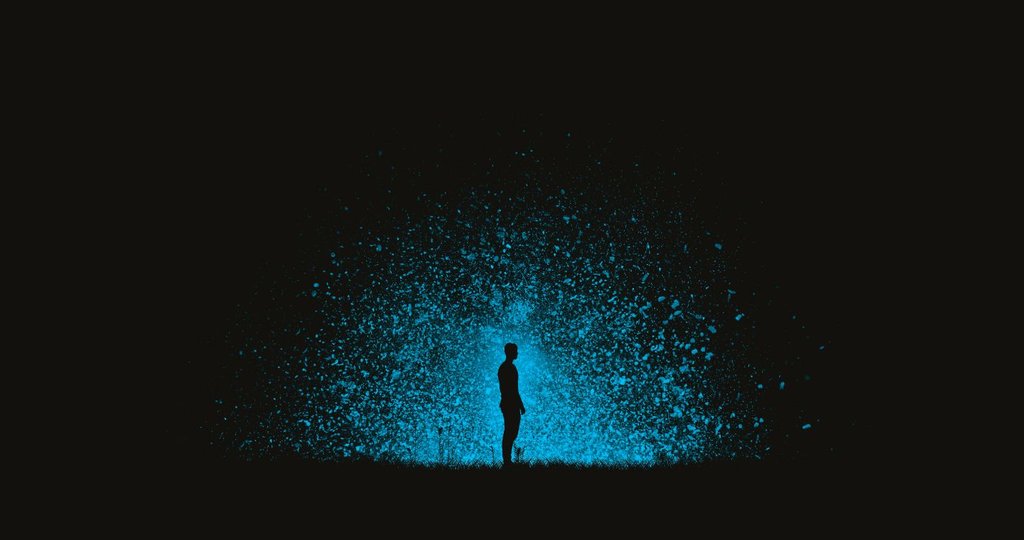Posté le : 08 août 2025 à 17:46:58
800
TEXTE ADOPTE n°9156
_____
CONGRES FEDERAL
11 avril 2017
Résolution n°2017-9156
relative à la reconnaissance du génocide perpétré par la Principauté de Carnavale en Kabalie/Pays des Trois Lunes
Le Congrès Fédéral a adopté la résolution dont la teneur suit :
LE CONGRES FEDERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE TANSKA,
Vu le Préambule de la Constitution Fédérale,
Considérant ce qui suit :
(1) L'autoproclamé "République actionnariale de Cramoisie" n'est pas une entité étatique reconnue par la République Fédérale de Tanska.
(2) Le territoire de Kabalie, aussi appelé Pays des Trois Lunes, est soumis à l'occupation de la Principauté de Carnavale, entité étatique intégralement responsable des crimes perpétrés sur le sol de la Kabalie.
A ADOPTE LA PRESENTE RESOLUTION:
Article premier
La République Fédérale de Tanska reconnaît publiquement le génocide de Kabalie/Pays des Trois Lunes perpétré par la Principauté de Carnavale.