✉️ [CONTACT] Ministère fédéral des Affaires étrangères et de la Coopération intercontinentale (MAECI)
Posté le : 29 Mars. 2017 à 16:32:42
Référence : 4718-FED-DIPL
꧁𓊈 CONTACT DU MAECI 𓊉꧂
Cette page est optimisée pour consultation sur ordinateur et affichage multi-couche.
━◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈━
◈ Présentation institutionnelle du Ministère ◈
Le Ministère fédéral des Affaires étrangères et de la Coopération intercontinentale (MAECI) est l’organe central de la politique extérieure de la Fédération. Il est responsable de l’élaboration, de la coordination et de la mise en œuvre des relations internationales de la Fédération, tant sur le continent d’Aleuci que sur les autres continents partenaires.
Créé officiellement en 1791, trois ans après la fondation de la Fédération, il fut initialement un simple Bureau des Relations extérieures avant d’être élevé au rang de ministère lors de la Réforme institutionnelle de 1853. Le MAECI est aujourd’hui l’un des ministères les plus stratégiques de l’Exécutif fédéral, doté d’un budget de 62,3 milliards de Fédalecs (FDL) pour l’exercice 2017.
🌐 Missions principales du MAECI
Représentation diplomatique de la Fédération
Maintien des relations bilatérales avec les États souverains.
Présence dans plus de X organisations internationales.
Gestion des ambassades, consulats et missions permanentes
X ambassades, X consulats généraux, X missions spéciales.
Négociation et ratification des accords internationaux
Traités de commerce, environnement, coopération militaire, éducation, etc.
Protection des citoyens fédéraux à l’étranger
Service des Urgences extérieures 24h/24.
Assistance consulaire d’urgence, rapatriements, médiation judiciaire.
Promotion de la culture et de l’influence fédérale
Réseau des Maisons de la Fédération (culture, langue, innovation).
Programmes de bourses et partenariats universitaires.
Dialogue multilatéral et veille géostratégique
Participation active aux résolutions sur la paix, le climat, les migrations.
🕊️ Positionnement diplomatique en 2017
La Fédération, puissance régionale et diplomatique majeure du centre d’Aleuci, défend une diplomatie multilatérale, pacifique, pragmatique et indépendante.
Elle se veut facilitatrice de dialogue entre blocs rivaux, intermédiaire neutre dans les crises régionales, et actrice proactive de la coopération Sud-Nord. Elle s’appuie sur trois piliers :
La stabilité continentale
Le développement équilibré des relations commerciales
La défense des minorités et des valeurs démocratiques
◈ Organigramme et personnalités officielles ◈
✦ Membres actuels du Cabinet diplomatique (au 03/03/2017)
Présidente du Conseil Fédéral : Mme Amaria Travesk
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération intercontinentale : M. Lior Aven-Strael
Vice-ministre déléguée aux Relations continentales (Aleuci) : Mme Karima Novan
Secrétaire général du MAECI : M. Julian Eckfort
Ambassadrice permanente auprès de l’Organisation des Nations Aleuciennes (ONA) : Mme Lilia Gharoun
◈ Coordonnées de contact officielles ◈
📧 Communication électronique
Tout échange formel avec le Ministère doit être envoyé à l’adresse suivante :
➺ maeci-federation@fed.gov.fed
Les messages sont filtrés par la Cellule de Contrôle Diplomatique (CCD). Toute correspondance confidentielle doit porter un identifiant de cryptage certifié (niveau S2 minimum).
📬 Courrier officiel
Le courrier papier doit être envoyé à l’adresse suivante :
➺ Ministère fédéral des Affaires étrangères et de la Coopération intercontinentale
Quartier Diplomatique Nord – Bloc 2A
Avenue des Délégués – 11300 Lurok (District fédéral)
FÉDÉRATION UNIE D’ALEUCI
[Tampon de sécurité : Envois inspectés selon le Protocole LEX/17/AL]
☎️ Télécommunication et présence numérique
En raison des risques cybernétiques accrus en 2017, le MAECI :
N’émet plus d’instructions diplomatiques par téléphone.
N’utilise pas les réseaux sociaux pour la communication officielle.
Utilise une plateforme cryptée interne nommée "Diplonet-F" pour les échanges entre ambassades.
◈ Réseau diplomatique extérieur ◈
La Fédération maintient des postes dans toutes les grandes capitales d’Aleuci, notamment :
X
X
X
X
Le réseau extérieur comprend aussi :
X
X
X
◈ Services spécifiques aux citoyens fédéraux ◈
Portail "FédéralExpat" : Enregistrement des citoyens à l’étranger
Assistance Légale d’Urgence : Ligne prioritaire pour cas d’arrestation arbitraire
Réseau d’abris sécurisés : Dans X pays en cas de crise géopolitique
◈ Projets diplomatiques prioritaires (2017–2020) ◈
Rapprochement progressif avec les Etats d'Aleucis
Accord-cadre sur la surveillance conjointe des frontières
Coopération renforcée avec les petits États continentaux
Partenariat technologique
Création d’un Fonds de développement numérique
Objectif : engagement climatique intercontinental
◈ Mentions officielles et sceaux de légitimité ◈
Le MAECI est une institution ratifiée par la Constitution fédérale (Art. 22.3 à 22.7) et bénéficie de :
Sceau diplomatique doré à triple anneau
Certificat de neutralité armée (statut reconnu par l’ONA)
Accréditation auprès du Tribunal de Justice Continentale
✸ Dernière mise à jour :
Service de documentation diplomatique (SDD-MAECI)
Document certifié n° DIPL-ALE/4718/VII.17
🤝 Diplomatie & relations internationales
Posté le : 30 jui. 2025 à 00:43:51
Modifié le : 30 jui. 2025 à 00:44:34
4473
Posté le : 30 jui. 2025 à 11:34:11
1090

Lior Aven-Strael,
Lurok, Fédération des Colonies Protestantes d’Aleucie, Aleucie.
El Ministro Carlos Lamento,
Furiaroja, Luchafego, Aleucie.
Lo saludo,
Enculés de votre religion, con el mayor de les respectos.

Posté le : 31 jui. 2025 à 23:54:28
2338

De : Cabinet de Madame la ministre des Affaires étrangères d'Akaltie
Quartier des Ambassades, Kintan
Union des Cités d'Akaltie - Empire des Cités d'Akaltie
Lurok
Colonies Protestantes d'Aleucie
À l'attention de Son Excellence M. Lior Aven-Strael, Ministre fédéral des Affaires étrangères et de la Coopération intercontinentale de la Fédération Unie dite "d’Aleuci",
Puisque le gouvernement des Colonies Protestantes d'Aleucie, qui se fait également appeler gouvernement de la "Fédération Unie d'Aleuci" sans que l'on sache où a bien pu disparaître le E, souhaite s'engager sur, je cite :
La valorisation des cultures, des peuples et de la diversité.
Nous vous serons grès de changer le nom de votre pays. Le mot "colonie" est véritablement insultant, et sous-entend un irrespect envers les nations premières qui peuplent ou peuplaient du moins le territoire sur lequel vos ancêtres eurysiens ont décidé d'établir un État sans le consentement de qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Il convient donc, puisque vous souhaitez maintenir la paix, de changer ce nom.
Ensuite, étant donné les grands risques d'épidémies de ChatGPT rapportés dans votre pays par plusieurs agences sanitaires nationales, nous ne souhaitons en aucun cas que des akaltiens ne viennent sur place, ni que des "protestants d'Aleucie" ne viennent poser ne serait-ce qu'un seul orteil au-delà de la frontière akaltienne. Notre pays a de l'expérience en matière d'épidémies continentales, et c'est justement pour cette raison qu'il fait tout pour traiter le problème à sa source et éviter une nouvelle expansion de ce virus meurtrier qui a déjà fait tomber plus d'une nation. Un échange traditionnel d'ambassades, comme nous ne l'avons jusqu'ici jamais refusé, est malheureusement irréalisable.
Nous n'en restons cependant pas moins ouverts à une diplomatie plus développées, si d'aventure votre ministère décide un jour de faire rédiger ses missives par des êtres humains plutôt que par des machines automatiques et bourrées de défauts. Nos alliés nous ont déjà rapporté avoir reçu des missives semblables en tous points, et ce genre de "diplomatie du copié-collé" ne nous plaît pas le moins du monde.
Bien cordialement,
Mme Juntan Necahual, Ministre des Affaires étrangères de l'Union et de l'Empire des Cités d'Akaltie
 ----------
----------
Posté le : 01 août 2025 à 12:06:59
146

Posté le : 05 août 2025 à 09:03:15
2023
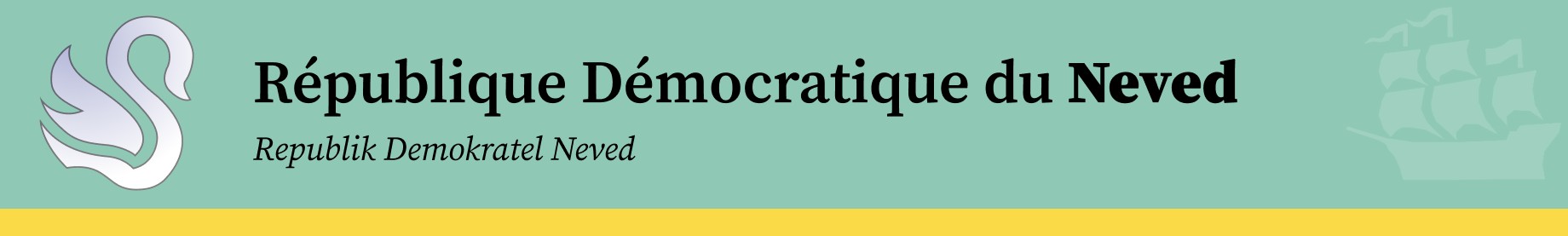
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre missive en date du 12 mars 2017 et de vous transmettre en retour les salutations distinguées de la République Démocratique du Neved.
Nous saluons avec estime la démarche de la Fédération Unie d’Aleuci visant à établir des relations bilatérales sur la base de principes que nous partageons pleinement tels que la souveraineté, la coopération équilibrée, le dialogue et la reconnaissance de la diversité des peuples.
La République Démocratique du Neved donne une suite favorable à votre proposition d’ouverture d’un canal diplomatique officiel avec le MAECI. Nos services compétents sont dès à présent en mesure d’établir ce lien conformément à nos protocoles. Il est à noter que notre diplomatie repose sur un corps d’ambassadeurs tournants. Aucun diplomate n’est affecté de manière permanente à une mission unique. Ce fonctionnement garantit une représentation adaptable et souple.
Nous prenons aussi bonne note de votre proposition d’échange d’ambassades. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle sur votre territoire, et notamment de l’épidémie de "Chat-GPT" ainsi que de l'épidémie de potentiel "plagiat" qui semble affecter plusieurs de vos régions, nous considérons plus prudent de différer cette étape.
Par ailleurs, nous exprimons un intérêt sincère pour les différentes formes de coopération proposées, notamment dans les domaines culturels, scientifiques et éducatifs. L’initiative Fédération Horizons retient toute notre attention et pourra faire l’objet d’échanges approfondis entre nos équipes respectives.
Enfin, nous proposons d’ouvrir un dialogue exploratoire portant sur la mer du Ponant. Ce bassin partagé mérite selon nous une coordination accrue sur les enjeux de sécurité maritime, de préservation des écosystèmes et de développement durable.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.
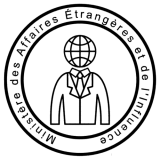

Posté le : 07 août 2025 à 14:20:49
2561

Votre Excellence,
Permettez-moi de vous adresser nos plus sincères salutations de la part de la Troisième République du Jashuria. La République des Deux Océans a suivi la sortie de l’isolationnisme de votre république avec la plus grande attention et nous sommes ravis de voir que votre pays a choisi de s’intégrer au concert des nations. Nous espérons que cette décision vous sera des plus profitables et nous vous adressons nos plus sincères vœux de prospérité.
Nous prenons attache avec vos services diplomatiques car dans le cadre de notre politique diplomatique internationale, le Hall des Ambassadeurs de la Troisième République du Jashuria est chargé de mettre en œuvre une politique d’ouverture d’ambassades avec les pays d’Aleucie. Cette politique vise à créer des liens étroits avec les différentes nations du continent, afin de créer les cadres d’une coopération internationale sur les sujets qui nous rassemblent. A ce titre, il aurait été indélicat de ne pas solliciter une ambassade et le début des relations diplomatiques avec les Colonies Protestantes d’Aleucie. La Troisième République du Jashuria, acteur indépendant sur la scène internationale, cherche avant tout à tisser des liens de coopération étroits avec les nations du monde afin de créer une ère de prospérité commune. Notre politique commerciale, culturelle et diplomatique, nous permettent de tirer le meilleur des coopérations dans lesquelles nous nous inscrivons et notre position au sein du Nazum nous a permis de créer les conditions d'une ère de stabilité inédite au sein du Nazum méridional.
C’est pourquoi, votre Excellence, nous souhaitons vous offrir le droit de positionner une ambassade au sein du Hall des Ambassadeurs d’Agartha et vous proposons d’établir une ambassade jashurienne en votre capitale. Nous sommes persuadés que l’ouverture d’ambassades conjointes peut être le prélude à un rapprochement entre nos deux pays. Si vous acceptez cet échange d'ambassades, nous procèderons à la constitution d'un cortège diplomatique.
Dans le même temps, nous vous proposons d’accueillir sur votre sol l’une de nos plus prestigieuses institutions : une Maison du Jashuria. Ces instituts culturels, financés par notre Etat, sont des lieux de diffusion de la culture jashurienne à l’étranger. Une Maison du Jashuria sur votre sol permettra de nouer des contacts plus approfondis avec votre population, notamment par le biais d’évènements culturels et des cours d’apprentissage de notre langue.
Dans l’attente de votre réponse sur les canaux diplomatiques, je reste à votre entière disposition.
Veuillez agréer, votre Excellence, l'expression de mes salutations distinguées.
Cordialement
Posté le : 24 août 2025 à 00:10:18
Modifié le : 26 oct. 2025 à 01:40:39
49875

Salutations
C’est avec le plus grand honneur que nous nous adressons à vous, Monsieur le Ministre, en vue d’exprimer notre désir de créer une ambassade officielle dans votre pays.
Nous pensons qu’une représentation diplomatique stable sera de nature à favoriser l’entente entre nos deux peuples sur le plan politique, économique, culturel et autre. Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
je vous adresse mes salutations respectueuses.
Ministre des affaires étrangères
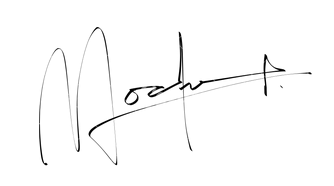

Posté le : 03 sep. 2025 à 22:05:24
816

Emetteur: URA
Destinataire: MAECI
Date: 28/06/2017
Nous accusons bonne réception de votre missive, certes tardivement pour des raisons indépendantes de notre volonté croyez le bien. Nous acceptons naturellement votre offre d'installer entre nos deux nations une représentation diplomatique permanente. Nous apprécions avec grand plaisir vos offres de rapprochement, et vous proposons de développer les possibilités immédiates, notamment dans la coordination de nos programmes d'échanges universitaires, cette thématique étant pour nous particulièrement importante.
Nous accepterons naturellement, lorsqu'ils se tiendront, de participer aux forums internationaux proposés par la fédération et nous tenons entièrement ouvert à tout échange ultérieur plus développé.
Veuillez agréer, votre excellence, l'expression de nos salutations les plus distinguées.
Posté le : 08 sep. 2025 à 22:28:21
920
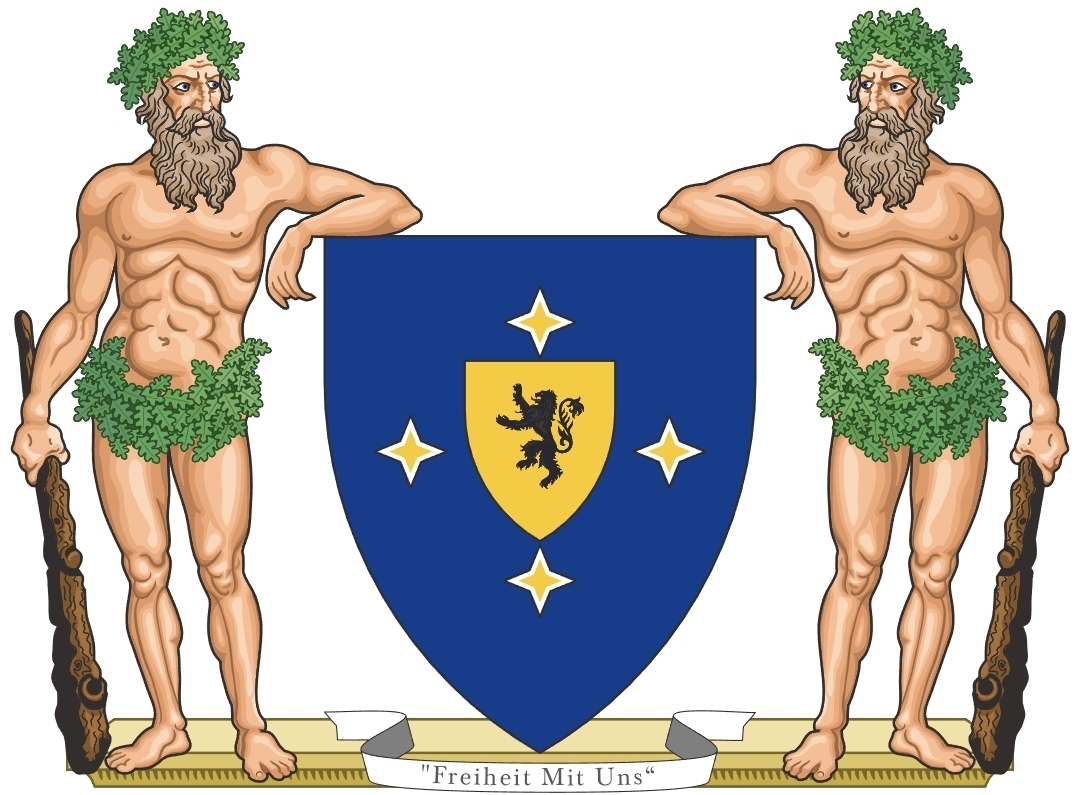
Bundesministerium des Auswärtigen Amtes aus Mantelhahn
Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Mantelhahn
Federal Ministry of Foreign Affairs of Mantelhahn
Mantelhahn
Nueva-Karsbrück,
Ministère Fédéral des affaires étrangères du Mantelhahn
A l’attention de son excellence Lior Aven-Strael
Ministre fédéral des Affaires étrangères
et de la Coopération intercontinentale des Colonies Protestantes d’Aleucie et de son gouvernement :
Chers homologues, je suis Rafaela Montesinos Ministre chargées au affaires étrangères du Mantelhahn. Nous avons longuement étudiés votre missive. Nous vous adressons donc notre réponse qui est très tardive nous en sommes désolés, car le pays traverse une crise interne mineure.
Nous acceptons pour le biens de nos deux nations l’échange d’ambassade et l’ouverture de canaux diplomatiques.
Avec les salutations les plus distinguées de Monsieur le président Alejo Carranza.
Rafaela Montesinos
