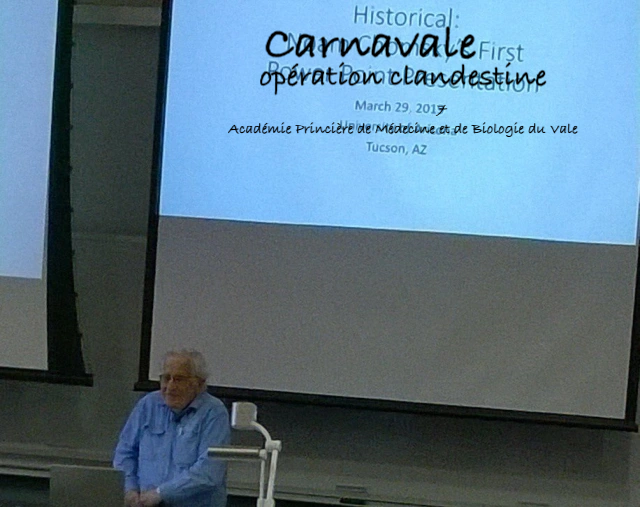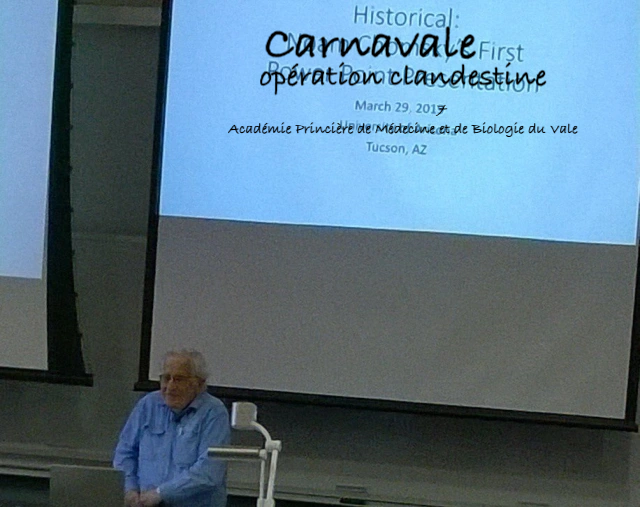Posté le : 06 oct. 2025 à 18:50:02
Modifié le : 10 oct. 2025 à 09:14:09
0
La pratique est de plus en plus théorisée au fil des années, les Carnavalais étudient l’usage guerrier des maladies et développe même des outils pour tenter de conserver l’infection dans des lieux sécurisés, de façon à pouvoir s’en servir plus tard au moment opportun. Sans compréhension de l’épidémiologie et ignorant le fonctionnement des bactéries, la plupart échouent mais les quelques succès permettent, en tâtonnant, l’émergence d’intuitions médicales. L’une des expériences les plus célèbres est celle du cloitre des gémissants, une léproserie sur le domaine du Duc de Bâtoncourt qui gardait enfermé des malades atteints de la pestes dans un lieux fermé, dans le but de les relâcher au bon moment dans les régions frontalières pour les déstabiliser. Les malades ayant tendance à mourir, le Duc de Bâtoncourt renforçait régulièrement son cheptel de serfs sains afin que la maladie continue de se propager en interne. La réputation de Bâtoncourt étant devenue exécrable, il finit par être dénoncé aux Princes de Vale qui détruisirent la léproserie mais pas avant d’y avoir enfermé le Duc. La réputation de ce dernier nourrit depuis une légende noire et lieux où se tenait la léproserie, depuis enseveli sous les champs OGM, est réputé hanté.
En 1471, lors de la bataille des tours courbées opposant les forces du Duc de Brillemuraille et celles des barons coalisés de la ligue des feuilles, les barons prirent la décision de lancer les cadavres des victimes de la peste dans les rangs de l'ennemi. En 1489, la Duchesse de Bellémeraude se fait confectionner un onguent avec les tripes purulentes d’un pestiféré et s’en enduit les lèvres. Elle embrasse ensuite sur la bouche le Duc de Ventremou au banquet donné par Thédéon Dalyoha. La Duchesse de Bellémeraude et le Duc de Ventremou mourront quelques semaines plus tard, emportées par la maladie, ce qui en fait le premier assassinat bactériologique de l’histoire carnavalaise. On soupçonne la technique d’être réutilisée à plusieurs reprises, l’assassinat par la maladie permettant en effet de camoufler des assassinats politiques en les faisant passer pour des accidents.
L’histoire carnavalaise est ponctuée d’utilisation des miasmes et des germes comme méthode de guerre militaire et social. Plusieurs chroniques témoignent par exemple de l’utilisation volontaire de certaines maladies pour réduire la population dans certains ghettos urbains, ou au sein des communautés paysannes des nobles adversaires. La décimation de villages ou la dispersion forcée de populations finit même par faire l’objet de législations de la part des Princes de Vale, afin d’en punir la pratique, ce qui est un indice fort que la pratique s’était démocratisée. En 1612, la loi carnavalaise interdit l’entreposage de carcasse de bétail infecté à des fins militaires. En 1615, cette loi est élargie pour punir le stockage de viscères et de tout organe susceptible d’être infecté. Pour mener à bien leurs enquêtes, les prévaux du Prince sont d’ailleurs autorisés à obliger les suspects à consommer une partie des stocks incriminés pour les forcer à avouer leurs crimes. La position des Princes de Vale fluctue avec le temps sur le sujet de la guerre bactériologique. Si le soucis d’éviter des catastrophes sanitaires sur le territoire carnavalais est souvent mis en avant pour justifier les politiques de répression, certains souverains se montrent beaucoup plus complaisants, certainement influencés par la famille Dalyoha. Le clan – que nous remercions au passage pour nous avoir accordé l’usage de cette salle – s’illustre en effet comme l’une des premières familles nobles à saisir l’intérêt stratégique non seulement de l’usage des maladies dans un contexte de guerre, mais aussi la recherche et l’étude sur le sujet. On sait aujourd’hui que le rachat de l’île de Bourg-Léon par les Dalyoha au XVIème siècle est justifié par la volonté de limiter les risques d’une fuite de pathogènes dangereux. Bourg-Léon est une île isolée du continent par la mer ce qui facilite grandement les procédures de quarantaine. La famille Dalyoha reçoit plusieurs privilèges l’autorisant à réaliser des expériences sur les villages de pêcheurs locaux. Ce sont les premiers pas d’une forme de recherche en épidémiologie, prélude à un avenir glorieux pour la science mondiale.
Au début XXème siècle, le progrès technologique et scientifique accélère largement la recherche sur le sujet. En 1901, à l’aube du siècle nouveau, les Laboratoires Dalyoha fondent plusieurs unités de recherche secrètes afin d'étudier les agents de guerre biologique et la diffusion des pathogènes au sein d’un grand groupe de personnes. S’il n’est pas à exclure que le souvenir saisissant du Père la Peste ait contribué à focaliser l’attention des pionniers de la recherche sur cette maladie en particulier, la peste bleue présente des qualités intrinsèques qui en font une excellente base de travail pour étudier et créer des armes bactériologiques.
Le médecin en chef des Laboratoires, le professeur Bernarlequin Ulexandre, a justifié son intérêt pour la peste, car elle pouvait causer un nombre de victimes disproportionné par rapport au nombre d'organismes libérés. Elle présentait également l'avantage d'être une arme non seulement très dangereuse, mais dont l'origine pouvait être dissimulée pour la faire passer pour un phénomène naturel. L’usage était donc tout aussi concret que symbolique : il devait être possible d’éradiquer une population – ou une armée – tout en saisissant les opinions publiques pour faire croire à un châtiment religieux. Par ailleurs, l’effet démoralisateur est bien plus efficace que pour les armes conventionnelles : la maladie est invisible, omniprésente, cause un grand nombre de malades et de blessés qui occupent l’adversaire et peuvent complètement immobiliser une troupe, voire la faire se débander. Il faut rappeler que les premières théorisations du soft power et des opérations psychologiques datent de cette époque, l’étude de l’utilisation d’une épidémie pour saper le moral d’un adversaire s’inscrit dans cette dynamique.
Les Laboratoires Dalyoha, sous la direction de Bernarlequin Ulexandre, vont alors se lancer dans une série d’expérimentations confidentielles, dont un certain nombre sur la population carnavalaise. Les premières expériences ont consisté à larguer des bactéries à partir de bombes aériennes, sous prétexte de mater des grèves de mineurs dans le sud du pays. L’utilisation de bombes a échoué, car la pression atmosphérique et les températures élevées tuaient presque toutes les bactéries sur le coup. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de produire certains spécimens OGM capables de résister à ces chocs mais à l’époque le feu restait encore le meilleur moyen de supprimer n’importe quel pathogène. Bernarlequin Ulexandre reporta alors ses recherches sur les premiers vecteurs de propagation de la maladie : les animaux. Les puces pouvaient être utilisées à la fois pour protéger les bactéries et pour cibler les humains. Je me permet une aparté pour vous dire que, de nos jours l’étude de l’emploi de tardigrades plutôt que de puces est un secteur de recherche très prometteur, et que le laboratoire n°87 recherche justement deux jeunes médecins supplémentaire pour travailler sur son projet d’élevage. La tentative de pulvérisation de puces infectées à partir de conteneurs à air comprimé sous prétexte d’épandage échoua également, car elle exigeait que les avions volent trop près du sol. Finalement c’est la professeure Martine Ferme qui proposa l'utilisation de bombes d'argile pour protéger les parasites, ce qui résolut le problème et permit d'obtenir un taux de survie des puces de 80%.
À plusieurs reprises pendant le début du siècle, les Laboratoires Dalyoha menèrent des expériences visant à tester l’efficacité de la peste bleue comme arme biologique en dehors du territoire de la Principauté. Le 7 novembre 1915, sous prétexte de lutter contre une famine dans un pays dont j’ai oublié le nom, nous avons répandu des bacilles de la peste sous forme de grains de riz et de blé mélangés à des puces infectées. Cette opération consacra la possibilité de provoquer volontairement une épidémie localement, mais ne causa la mort que de 25 personnes, ce qui fut jugé insatisfaisant. Quelques semaines plus tard, le 19 janvier, des avions carnavalais ont largué des bactéries de la peste sur la capitale régionale. En l'espace de deux jours, la peste bubonique est apparue pour la première fois dans cette ville, tuant 101 personnes en 32 jours. A nouveau, la théorie se vérifiait, mais la léthalité n’était pas au rendez-vous. Nous devions nous donner les moyens de décimer au moins plusieurs milliers de personne, de façon à provoquer un choc et une mobilisation suffisante pour paralyser la logistique de l’ennemi. Notons que dans chacun de ces deux exemples, aucune mortalité excessive n'a été constatée parmi la population de rats, ce qui fait penser qu’il était possible de maintenir la maladie sous forme latente sur un territoire grâce aux animaux. Cependant, comme la communauté internationale commençait à s’alarmer de ces déclenchements de peste, Carnavale a dû cesser ses activités provisoirement afin de ne pas attirer les soupçons. La dispersion d’un mélange de grains de blé et de riz, de morceaux de papier, de coton et d'autres particules donne toutefois des résultats réellement prometteurs. Vous n’ignorez pas que c’est à cette époque que Bourg-Léon commence à se doter d’un cheptel de cobaye humain en interne, plusieurs expériences à petite échelle sont menées pour optimiser la transmission des pathogènes. Dans le même temps, les premiers essais visant à faire muter le bacille de peste bleue afin d’augmenter sa léthalité voient le jour.
A partir de là, tout va s’accélérer jusqu’au Chaos de Carnavale. Le docteur Christorphée Dalyoha, directeur de Grand Hôpital dans les années 30, expose en interne la stratégie des Laboratoires, je le cite : « Les Obérons nous surclassent en tout point d’un point de vue industriel. Si les Dalyoha ne veulent pas être éclipsés avant la fin de ce siècle, nous devons investir toutes nos forces dans la création d’armes non conventionnelles, afin de faire peser une menace d’un genre si nouveau sur nos ennemies que ceux-ci ne sauront comment y répondre ». Ces mots trouvent un écho particulier aujourd’hui n’est-ce pas ?
Je ne ferai à personne l’affront de retracer la chronologie du Chaos de Carnavale mais c’est pendant ces sept années que la science Dalyoha a pu montrer toute son efficacité, au point de rivaliser avec des fortunes plus conséquentes (celle des Castelage) et avec la supériorité industrielle écrasante des Obéron. Si le Chaos trouva son paroxysme à Carnavale, on oublie parfois que l’arrière-pays fut un enjeu militaire majeur puisque tenir certaines régions permit d’assurer – ou de couper le cas échéant – les approvisionnements en nourriture dans la capitale. Dans la presse d’opinion qui commente les affrontements, des journaux possédés par les Obéron accusent le clan Dalyoha d’avoir largué sur ses domaines des insectes capables de propager la peste, le typhus, le paludisme, l'encéphalite B et d'autres maladies. Si le clan Dalyoha a nié à l’époque, nous savons aujourd’hui en interne que les accusations étaient fondées, précisant toutefois que ce cocktail bactériologique était composé d’organismes mutés afin de répondre précisément aux besoins militaires des Dalyoha, notamment une léthalité rapide mais un faible taux contagion afin d’éviter que toute la Principauté ne soit frappée d’épidémie. On estime qu’au plus fort des combats, Bourg-Léon possédait des usines de production capables de produire 500 tonnes d'agents par mois destinés à être utilisés comme armes.
Avec la fin du Chaos, les Dalyoha ont signé un certain nombre d’accords de non-agression avec les familles survivantes, l’un d’eux promettant notamment l’abandon de toute utilisation d’armes bactériologiques contre des Carnavalais. Il ne s’agissait bien sûr que d’un traité très théorique et les Obéron ont toujours – à raison – considéré avec méfiance le pouvoir de nuisance de leur rival historique. Cependant l’accord ne prévoyait pas l’arrêt de la production d’agents pathogènes, seulement leur non-utilisation sur le sol de la Principauté. Rien n’empêchait donc leur production pour un usage extérieur, une subtilité que les Laboratoires ne se sont pas gêné d’exploiter. En 1956, une grande étude théorique produite en interne estimait que la dissémination délibérée de 50 kg de de bacilles de peste sous forme d'aérosol au-dessus d'une ville de 5 millions d'habitants pourrait provoquer des cas de peste pulmonaire chez près de 150 000 personnes, dont 36 000 risqueraient de mourir de la maladie. Ces chiffres pouvaient être multipliés par trois en cas d’utilisation de variantes OGM plus infectieuses. Les bacilles de la peste resteraient alors viables dans la zone pendant au moins une heure, dans un rayon de 10 km, ce qui permet de frapper une large zone. Le rapport pontait également du doigt l’importance de certains comportements humains dans un tel cas de figure, notamment la possibilité importante que les personnes cherchant à fuir les lieux transportent les bacilles avec elles, provoquant ainsi une propagation encore plus importante.
Malgré la signature de traités sur les armes biologiques avec les familles Castelage et Obéron, les Laboratoires Dalyoha ont poursuivi leur programme de développement jusqu’à aujourd’hui, avec une augmentation substantielle de sa taille et de sa portée à partir des années 1960, puis une seconde fois à partir de 1987 à l’occasion du plan de modernisation de Grand Hôpital. Un département entier et une portion souterraine de Bour-Léon lui fut attribué en 1967 sous la direction d’Olivier Dalyoha, père d’Ambroise et grand-père de monsieur Blaise Dalyoha, en collaboration avec le docteur Léopoldin de Rougemoignon dont le portrait vous sera familier puisqu’il est affiché dans le réfectoire de l’Académie. Rougemoignon occupera ce poste jusqu’en 1985 avant d’être remplacé par le docteur Géminéon jusqu’en 1998 lorsqu’il sera promus directeur de Grand Hôpital. J’ai aujourd’hui l’honneur de remplir le rôle de directeur de ce prestigieux département. Notons toutefois que l’industrie de production médicamenteuse ne se trouve pas uniquement sur l’île de Bourg-Léon. Pour des raisons de sécurité je ne vous révèlerai pas où se trouvent tous les laboratoires mais certains sont dans Carnavale elle-même, sous couverture civile. S’il est de notoriété publique que les Laboratoires Dalyoha produisent et développent des agents bactériologiques et chimiques offensifs – du moins le secret est-il évanté depuis Estham et CRAMOISIE© – une partie de la production demeure volontairement dissimulée sous couvert de recherche légale et civile en biotechnologie, pharmacie, fabrication de médicaments et, dans certains cas, d’agents chimiques destinés à l’industrie. Vous seriez étonnés de voir qu’il est possible d’héberger un petit laboratoire dans une usine de peinture. La clef est de ne jamais consacrer plus de 15% de l’activité à ces recherches militaires, afin de diluer nos travaux dans le reste des commandes que passe l’entreprise. Cette discrétion, qui n’est en théorie pas nécessaire à Carnavale considérant sa législation permissive, vise précisément à se défendre contre une ingérence étrangère, qu’il s’agisse d’espionnage industriel ou d’une franche invasion militaire.
Je termine en précisant que la recherche sur les armes bactériologiques et les biotechnologies ne saurait se passer de collaborations avec d’autres secteurs de la recherche scientifique, d’où la multiplication des laboratoires de recherche. Mon collègue, que vous avez peut-être eu comme enseignant, le docteur Crogère, met à disposition de nos équipes toutes ses avancées en chirurgie, notamment les travaux portant sur le système nerveux. Quant à la doctoresse Edith Pioupiou, elle nous communique chaque semaine les progrès de ses laboratoires en matière de génie génétique.
Dans les années 1970, une collaboration avec les Industries Obéron a ouvert la voie à l’utilisation d’armes bactériologiques à longue portée. Cette étape a été possible grâce à nos progrès significatifs réalisés en matière de planification et de mobilisation en temps de guerre des Laboratoires, mais aussi grâce aux avancées des Industries Obéron en fuséologie. Nous étions en mesure de produire massivement de grandes quantités de divers agents, en particulier des versions OGM de la peste et de la variole, qui sont des souches particulièrement résistantes. La collaboration industrielle entre les Laboratoires et les Industries a permis d’envisager, dès la fin des années 1970, la possibilité de mener une attaque stratégique à l'aide de la peste ou de la variole grâce à des missiles balistiques intercontinentaux équipés d'ogives conçues pour contenir ces agents particuliers et favoriser leur dispersion à l’impact. Je n’entrerai pas en détail dans le domaine de la fuséologie que je maîtrise mal mais les missiles se décomposaient à une certaines hauteur en un myriade de petites ogives portant la charge bactérienne qui se dispersait dans l’air quelques mètres au-dessus du sol. Un système de leurre voyait par ailleurs le jour afin de focaliser l’attention de l’adversaire sur l’explosion sans lui laisser le temps de se rendre compte que le danger avait déjà été diffusé dans l’air. De telles armes pouvaient, dès le début des années 1980, ravager un pays de l’intérieur si utilisées contre les centres de population ennemis.
Parallèlement à ces progrès, les Laboratoires se sont concentrés sur la création de maladies mortelles incurables. Notre objectif était de tirer profit de notre avance dans le domaine pour prendre nos concurrents de vitesse en empêchant le développement de remède en cas d’attaque. Parmi les agents créés à l’époque figurait une forme de peste génétiquement modifiée, sèche et résistante aux antibiotiques. La production d'un tel agent pathogène était en fait une priorité absolue des Laboratoires depuis le milieu des années 70. Ce premier bacille de peste OGM a donné des résultats très prometteurs en milieu contrôlé et, même les Laboratoires ne parvenaient pas, dans un premier temps, à stopper la maladie qu’ils avaient inculqué. La crainte que l’agent ne s’échappe de Bourg-Léon et ne ravage la Principauté fut réelle à ce moment, entrainant un moratoire de deux ans sur la recherche, qui fut reprise en 1976. Le docteur Léopoldin de Rougemoignon imposa à l’époque un dédoublement des équipes afin de développer en parallèle et la maladie, et son antidote, ou tout du moins son vaccin. Cette ambition n’était pas que philanthropique : en développant le mal et son remède, Carnavale se dotait d’un poids considérable en cas de conflit puisqu’elle seule était en mesure d’arrêter le fléau qu’elle avait elle-même provoqué.
Grand Hôpital, dont les médecins ignoraient majoritairement que nous avions développé des souches de peste OGM, développa en toute innocence le système de santé de Carnavale dont un aspect unique pour l’époque comprenait une agence appelée « système anti-peste ». Celle-ci était chargée de protéger le pays contre les maladies hautement dangereuses d'origine naturelle ou artificielle, notamment grâce au déploiement de politiques publiques d’urgence et adaptée à une menace bactériologique non conventionnelle et particulièrement mortelle et virulente. En vérité, Grand Hôpital avait déjà mis en place, pendant les années 1960, un programme national destiné à lutter contre la guerre biologique sur le sol carnavalais. Ce n’est toutefois qu’au milieu des années 1970 que les agences en responsabilités ont commencé à inclure des tâches liées à la défense contre des souches OGM, ce qui incluaient notamment des laboratoires spécialement dédiés à l’identification de la maladie, son fonctionnement et son séquençage ADN. Plusieurs protocoles théories ont été conçus dans ces années-là, puis éprouvés en situation de test avec des pathogènes OGM obsolètes issus des Laboratoires Dalyoha afin de voir comment les agences carnavalaises réagissaient face à une menace inconnue. Ces tests ont permis une nette amélioration des protocoles de défense et une meilleure compréhension des réflexes humains lorsque notre espèce est exposée à ce genre de situation critique, ce qui a toujours été le plus grand facteur d’incertitude pour nous.
En ce qui concerne l'utilisation des variantes de la peste, à l’heure actuelle, celles-ci montrent leur efficacité principalement lorsqu’elles sont disséminées sous forme d'aérosol, ce qui provoque une épidémie de peste pulmonaire. Les symptômes apparaissent rapidement, probablement dans les 15h à 6 jours suivant l'exposition, et la plupart des personnes touchées décèdent peu après l'apparition des symptômes. Bien sûr les résultats varient grandement selon qu’est utilisée une souche naturelle de la peste bleue, ou bien génétiquement modifiée résistante aux médicaments. En théorie, l’utilisation des souches naturelles de bacille de peste bleue, variantes du Père la Peste, résistent mal aux antibiotiques, ce qui a permis l’extermination de la maladie aujourd’hui. Néanmoins, certains variants naturels présentent des caractéristiques précieuses dont ont pu s’inspirer les Laboratoires pour développer des souches plus agressives. Un isolat de peste provenant de l’île d’Anna contenait par exemple un plasmide transférable multirésistant. Plus tard dans les années 1990, une deuxième souche a été identifiée qui contenait un plasmide codant pour le gène de la phosphotransférase modifiant la streptomycine, ce qui entraînait une résistance élevée à la streptomycine. Les deux organismes contenaient des plasmides qui se transféraient facilement à d'autres souches de peste bleue, ainsi qu'à Escherichia coli. Ces formes de résistance naturelle aux médicaments dans des isolats bacille de peste a grandement accéléré les progrès de nos unités de recherche pour complexifier encore davantage les bactéries OGM multirésistantes notamment aux fluoroquinolones.
En termes moins barbares, nous disposons aujourd’hui d’une gamme d’agents pathogènes dont le spectre d’utilisations potentielles va de : immobiliser une troupe entière en forçant leur prise en charge immédiate par des unités de soin intensif à décimer totalement une population sans espoir de solution médicamenteuse. Bien sûr, une fois les agents relâchés il est parfaitement possible de les étudier pour mettre en place un remède, mais si l’infectiosité est élevée, le temps que les vaccins et médicaments soient mis au point, les victimes peuvent se compter en millions. Rappelant que la grippe listonienne du début de siècle dernier, qui n’avait aucune modification génétique artificielle, a causé entre trente et cinquante millions de morts à travers l’Eurysie. Imaginez à présent la léthalité d’une bactérie spécialement conçue pour ravager massivement les populations humaines. Par ailleurs, je le dis avec malice, comprenne qui voudra, absolument rien n’empêche de relâcher à intervalles réguliers différents agents non concurrents. Bactéries et virus ne fonctionnent pas du tout selon les mêmes principes, multiplier les natures de menace diminuera d’autant l’efficacité des efforts de nos ennemis pour les endiguer. Je ne parle même pas des conséquences désastreuses pour une société si un % de la population comparable à celui du Père la Peste venait à mourir. Le risque d’effondrement pur et simple de l’État n’est pas à exclure et gênerait d’autant la recherche pour trouver un vaccin. La déstabilisation des nations conduirait à des exodes massifs de population, créant un enchaînement de crises inimaginables à travers le monde. Bien sûr, aucun être humain avec un cœur ne peut souhaiter un cataclysme d’une telle ampleur, heureusement vous avez été sélectionnés pour votre absence profonde d’empathie ce qui nous permet d’étudier sereinement cette hypothèse, sans a priori moraux susceptibles de nous gêner.
Aujourd’hui, chers internes, il n’est pas exagéré de dire que Carnavale possède, depuis le Chaos, le programme de guerre biologique le plus offensif, le plus vaste et le plus sophistiqué au monde. En tant que ses futurs artisans, votre responsabilité est de le maintenir à la pointe, de développer d’une main les outils qui nous permettront de nous défendre contre nos propres armes, et de l’autres les armes pour combattre ceux qui voudraient s’en prendre à nos intérêts. N'oubliez pas que nous sommes en mission.
En comparaison des capacités des Laboratoires Dalyoha, la menace que représente le bioterrorisme reste d’un niveau largement inférieur, frisant bien souvent l’amateurisme. Nous avons ici et là plusieurs exemples d’attaque par colis piégés contenant des agents toxiques ou bactériologiques. On peut par exemple penser aux lettres piégées à l’anthrax, l’agent pathogène avait le plus souvent été envoyé par le biais du système postal national. Cette technique artisanale a fait une vingtaine de victimes ces dernières décennies à travers le monde après avoir développé des symptômes d'anthrax pulmonaire par inhalation. La léthalité de l’anthrax reste toutefois minime et le procédé hasardeux. Sur la vingtaine de personnes ayant respiré la substance, seules six d'entre elles sont décédées des suites de la maladie. Elles ont dans la plupart des pays touchés donné lieu à une nouvelle législation antiterroriste et à des mesures appropriées pour sensibiliser et alerter le public et la communauté médicale afin qu'ils soient prêts à faire face à de nouvelles attaques de ce type. De fait, si l’anthrax est un bon exemple d’attaque bioterroriste frappant de peur les populations, elle doit son succès au caractère nouveau du procédé. A partir du moment où l’État se rend compte de la menace et décide d’y réagir, son efficacité diminue largement et le procédé est en général abandonné. Ce constat nous fait penser que le bioterrorisme « artisanal » ou « amateur » ne peut donner de résultats probants sans des moyens minimaux. Plus ces moyens sont grands et plus la recherche peut se déployer dans le temps long, plus son efficacité grandit, ce qui tend à valider la stratégie des Laboratoires Dalyoha de se constituer en fleuron de ce secteur.
Aujourd’hui, certains pays se lancent plus que tardivement dans la course. Les déclarations du Faravan, suscitent légitimement certaines formes d’inquiétude particulières, notamment en raison du retard technologique de ce pays en la matière et de son absence notoire dans le champ de la recherche scientifique en biotechnologie. En matière d’armes bactériologiques, des mesures de sécurité, de confinement et des protocoles de réponse en cas de fuite ne s’improvisent pas ce qui fait craindre que le pays souffre de son empressement et se mette lui-même en danger. Non, inutile de murmurer, je sais que certains se réjouiront de la chute d’un ennemi, mais la recherche et le développement scientifique sont l’affaire de toute l’humanité. Ne saluons jamais l’échec de nos concurrents car leurs erreurs sont autant de succès qui ne nous permettent pas d’avancer et nous retardent tous.
Nous allons maintenant…
On toque à la porte.
- Entrez.
Un médecin entre dans la salle de classe.
- Professeur Blanchâtaigne, je vous dérange ?
- Je suis en train de donner cours, que se passe-t-il ?
- Il semble que l’OND lance son assaut.
- Ah bon.
En soupirant, Noamaury Blanchâtaigne se lève et se tourne vers sa classe.
- Assez de théorie pour aujourd’hui, il est temps de passer aux travaux pratiques.