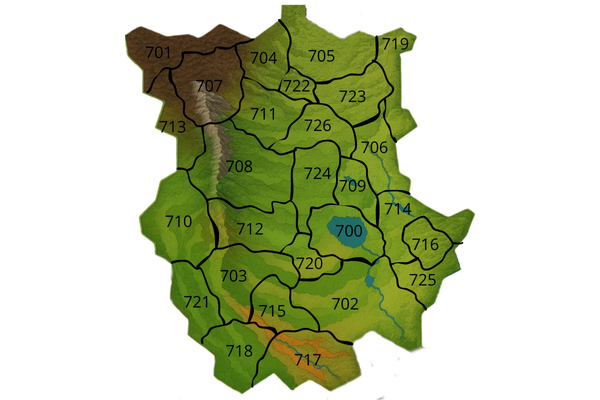Posté le : 20 jan. 2026 à 20:29:40
Modifié le : 20 jan. 2026 à 20:29:55
12595
L'HISTOIRE
La côte de Valtern, autrefois, n’était qu’une longue échine sauvage battue par les vents. Des falaises couvertes de conifères plongeaient dans une mer d’un bleu sombre, et, à leur pied, les brumes salines. C’est là, en 1712, que s’est écrite l’histoire fondatrice de la République démocratique socialiste de Valtern. Les premiers navires venus du « Vieux pays » n’arrivèrent pas comme une flotte organisée, mais comme une succession d’expéditions marchandes, perdues entre ambition et survie. Ils abordèrent la côte avec fierté, celle de découvrir une terre que personne avant n’avait évoquée, cherchant des criques où jeter l’ancre. Les colons installèrent leurs premiers campements sur d'étroites bandes de sable, là où les pins formaient un abri naturel contre les tempêtes. Ils étaient peu nombreux, hagards après des semaines de mer, mais animés d’un mélange d’espoir et d’appétit. Ils rêvaient de terres riches, de ressources inépuisables, d’une vie nouvelle qui effacerait la misère qu’ils avaient laissée. Ils ignoraient encore qu’ils n’étaient pas les premiers habitants, et que cette terre, qu’ils croyaient libre pour qui savait la prendre, appartenait déjà à des peuples qui la connaissaient depuis des millénaires : les peuples autochtones. Leur présence, d’abord silencieuse, ne tarda pas à se manifester. Les premiers contacts furent prudents mais relativement pacifiques : échanges de fourrures, d’outils, de vivres, gestes timides entre deux mondes qui se jaugeaient. Mais ces instants fragiles furent balayés dès que les ambitions coloniales s’enracinèrent. À mesure que les colons étendaient leurs avant-postes, coupant les arbres, construisant des palissades, s’appropriant les terres de chasse, l’équilibre se rompit. Les tensions, sous-jacentes, éclatèrent brusquement au cours de l’hiver 1738, lorsque des colons avancèrent trop loin dans les territoires sacrés des autochtones. Ce fut le début d’un siècle de violence. Les années suivantes furent marquées par des escarmouches, des attaques nocturnes, des représailles disproportionnées. Des villages autochtones furent brûlés ; des campements coloniaux disparurent sans laisser de trace, engloutis par les flammes. Les colons, pour survivre, bâtirent de plus grandes fortifications. Ce ne furent bientôt plus de simples palissades, mais de véritables bastions de bois, hérissés de meurtrières, où femmes et enfants se réfugiaient lors des assauts. Les nations autochtones, malgré leur connaissance du terrain, furent peu à peu submergées par la pression croissante des colons et par l’arrivée estivale de nouveaux navires qui renforçaient sans cesse la population ennemie. Les maladies importées, que nul ne comprenait encore, frappèrent les villages autochtones plus durement encore que les armes. La guerre culmina au début de l’année 1780, dans une bataille devenue légendaire : la Bataille des Pins Noirs. Une longue semaine de feu, de cris et de larmes, où les autochtones, unis sous une même bannière pour la première fois, opposèrent leur résistance la plus farouche. Les colons y laissèrent de lourdes pertes, mais les renforts maritimes vinrent briser cet espoir.
Lorsque le XIXᵉ siècle s’ouvrit, les conflits diminuèrent, non par paix réelle, mais par épuisement mutuel. Les colons avaient établi leur domination territoriale, tandis que les nations autochtones, affaiblies, furent repoussées vers l’intérieur, sur les terres plus reculées et montagneuses. La côte devint officiellement la « porte d’entrée » du nouveau pays, un rivage façonné par le commerce mais bâti sur des cicatrices encore visibles. Les nations autochtones, éprouvées, avaient reflué vers les forêts intérieures ; les colons, installés sur la côte, répandaient leurs campements. Vers 1815, une lettre arriva par navire, dernier rescapé d’une flotte commerciale habituellement bien plus fournie. Elle annonçait que le pays d’origine des colons avait sombré dans une guerre cataclysmique : une série de conflits continentaux si violents qu’ils avaient consumé les villes comme des torches et dispersé des populations entières. Le sol natal n’était plus qu’un amas de ruines et de royaumes improvisés. Pour les colons de Valtern, ce fut un choc terrible : ils n’avaient plus de pays où revenir. Ils étaient devenus, brusquement, les héritiers d’une terre nouvelle. Le printemps 1821, les chefs autochtones descendirent des forêts avec leurs parures de plumes ternies mais leurs regards inébranlables. Les anciens colons, quant à eux, venaient du littoral, vêtus de manteaux usés par les hivers. Ils se rencontrèrent au bord d’une rivière dont l’eau limpide reflétait les deux mondes. Encore aujourd’hui, personne n’est parvenu à dire comment s’est procédé les premiers échangent concluant cette rencontre. Le Pacte de non-agression, un simple document, écrit sur une peau de bison, où les deux peuples se promirent : d’arrêter la guerre pour toujours, de partager les terres de manière équitable, d’offrir entraide en cas de famine ou de catastrophe, et de ne plus décider seuls du destin de Valtern. Les premières années furent hésitantes, la confiance n’étant pas acquise. Dans les années 1830, alors que la paix fragile prospérait, une nouvelle découverte bouleversa l’équilibre : les colons et les autochtones rencontrèrent un troisième peuple, caché depuis des siècles dans les hauts plateaux du nord ouest. Ils étaient surnommés les guerriers des hauts-plateaux, un groupe montagnard farouche, aux traditions austères, vivant de bétail, de chasse et de rites ancestraux. Eux aussi craignaient l’arrivée de nouvelles influences. Mais lorsqu’ils comprirent que les populations de la côte avaient renoncé à la violence, ils acceptèrent de participer à la construction d’un nouveau monde. Ce fut le début d’un moment unique dans l’histoire de Valtern : trois peuples que tout opposait se retrouvèrent autour d’un projet commun. Plus tard, ce jour fut nommé comme journée nationale du pays : le 17 octobre. Au croisement d’un grand lac et de collines verdoyantes, les trois peuples décidèrent de bâtir quelque chose qui n’existait nulle part ailleurs à Valtern : une cité sans maître, sans souverain, sans hiérarchie, où chaque famille, chaque groupe, chaque culture se régissait librement, sous un principe d’entraide absolue. Cette cité, appelée Dawnshore la Première, était un foyer d’expérimentations : maisons coloniales côtoyaient tentes autochtones et huttes de pierre montagnardes ; les décisions se prenaient à la main levée, sur la grande place ; et chaque artisan, chaque pêcheur, chaque guerrier offrait un peu de son savoir pour la collectivité. Mais en 1853, la maladie arriva. Un pêcheur fiévreux, un enfant pris de convulsions, une femme qui tousse sans arrêt. Puis une vague : trois peuples frappés indistinctement. La maladie de la Grande Fièvre, que personne ne comprenait, balaya la ville et la campagne. Les autels autochtones brûlaient des herbes médicinales nuit et jour, les colons improvisaient des hôpitaux dans les granges et les guerriers des plateaux bravaient la mort pour ramener de la glace des montagnes, espérant calmer les fièvres. Malgré les efforts, plus de la moitié de la population périt. Dawnshore la Première devint une ville fantôme, parcourue seulement par les survivants qui enterraient les morts. Lorsque la fièvre finit par s’éteindre, ne restaient que quelques centaines d’êtres humains dispersés : des colons brisés par le deuil, des autochtones ayant perdu des clans entiers, des guerriers affaiblis mais tenus par leur honneur. Sur les ruines de leur cité anarchique, ils firent un choix simple : recommencer. Mais cette fois, ils cherchèrent un sens, une force morale, quelque chose de plus haut qu’eux pour les guider. Les survivants, marqués par la douleur, se tournèrent naturellement vers les anciens livres de prières que les colons avaient apportés. Le christianisme. Avec l’aide des trois peuples, et sous l’impulsion d’un conseil religieux réformé, Valtern se transforma en une république chrétienne en 1881, centrée sur : la solidarité, la justice, le pardon, la reconstruction morale et la fraternité entre les peuples. Ils rebâtirent une nouvelle cité, mieux organisée, plus résiliente.
Entre 1900 et 2000, les premières décennies furent marquées par une famine dont les anciens parlent encore. Les récoltes échouaient une année sur deux, les tempêtes balayaient les côtes, et les troupeaux des plateaux s’amenuisaient. Les villages se vidaient lentement, non pas faute d’enfants, mais faute de pouvoir tous les nourrir. C’est au cœur de cette fragilité qu’eut lieu l’événement qui allait métamorphoser le pays : la découverte, dans le Sud, d’un peuple que nul ne soupçonnait encore. Une cité entière, hérissée de bâtisses en bois, traversée par des avenues sèches où résonnaient sabots, rires rauques et chants alcoolisés : une cité de cavaliers, de bêtes robustes, de tireurs à la détente, d’hommes et de femmes qui vivaient au rythme du soleil et du vent : les Cow Boys. Les premiers échanges dégénérèrent en escarmouches, puis en véritables affrontements. Les trois peuples se retrouvèrent à défendre leurs nouvelles frontières avec détermination. Pendant plusieurs mois, ce fut un combat qui ne portait ni gloire ni orgueil : seulement la peur de perdre ce qui avait été chèrement reconstruit. Finalement, un affrontement majeur près d’un canyon mit fin au conflit. Les trois peuples, unifiés par leur nécessité d’exister, sortirent vainqueurs et prirent le contrôle de la cité du Sud. Pourtant, au cœur de cette victoire, le Président de la République chrétienne, un homme calme, plus berger que guerrier, comprit qu’une domination brutale ne ferait qu’envenimer un pays déjà affaibli. Contre l’avis de son propre Conseil, il chercha à parler aux chefs de la cité, rassemblés dans une grande maison, où les regards méfiants pesaient comme une enclume. On dit qu’il posa son arme sur la table, s’assit, et demanda : « Vous voulez survivre ? Nous aussi. Alors construisons quelque chose ensemble. » (origine de la devise actuelle du pays) De cet échange improbable naquit un accord fondateur : la transformation de la république chrétienne en une république socialiste, une structure souple où chacun aurait une voix, une part de la terre, un avenir commun. Ce fut l’acte de naissance de la grande République socialiste. Les décennies qui suivirent furent pauvres. Très pauvres. Les maisons se rebâtissaient lentement : des murs en pierre, des toits de tôle, des planchers qui grinçaient. Les familles vivaient nombreuses dans des espaces trop étroits, mais la vie circulait de nouveau. On assista à un véritable boom de naissance : une génération entière conçue dans la volonté farouche de réhabiter le pays. Les écoles se remplirent d’enfants, et l’on recommença à organiser des fêtes modestes, avec trois instruments, un feu de bois et beaucoup de bonne volonté. Peu à peu, la République s’affermit. Des textes de lois se crééent, des Conseils se forment, un gouvernement, un parlement ; les habitants apprirent à forger des outils plus solides, à entretenir des routes, à bâtir des moulins et des ponts. Le quatrième peuple apporta sa science du bétail et des chevaux. Les guerriers des plateaux offrirent leur discipline martiale, formant les premières unités de ce qui deviendrait l’armée républicaine. Les autochtones, gardiens de la terre et des cycles naturels, transmirent leurs connaissances agricoles et leurs rituels de respect de la nature. Les descendants des colons, eux, se spécialisèrent dans l’administration, l’écriture, les lois, la charpente, les rouages politiques. De cette fusion improbable naquit une culture forte et fière. Une culture où la force collective valait plus que l’individualité, où l’on célébrait la solidarité autant que les exploits. Ainsi, au début des années 2000, la République socialiste ne ressemblait plus en rien à la colonie frêle née plus tôt au bord de la mer. Elle était devenue une nation forgée dans la lutte, polie par les famines, consolidée par les alliances improbables, et portée par un peuple qui avait appris à se tenir ensemble, envers et contre tout.
Au tournant des années 2000, la République Socialiste, encore humble et marquée par un siècle de privations. Ce n’était pas encore la prospérité, ni la modernité effervescente des grandes puissances étrangères, mais quelque chose de plus profond : la sensation que le pays avait enfin les pieds plantés dans un sol qu’il avait su façonner lui-même. Le nouveau millénaire fut d’abord un moment de réaffirmation politique. La République, longtemps hésitante dans ses institutions, commença à assumer pleinement sa nature démocratique et socialiste. Les élections devinrent plus régulières, mieux encadrées ; les Conseils régionaux gagnèrent en voix et en influence ; les droits sociaux, déjà solidement inscrits, furent élargis. Les citoyens, héritiers de peuples autrefois divisés, s’habituèrent à débattre ensemble, à voter ensemble, à contester ensemble. On ne parlait plus de “colons”, “autochtones”, “cow boys” ou “montagnards” : on parlait de citoyens de la République, tout simplement. Et dans ce renouveau politique, une idée s’imposa peu à peu, d’abord timidement, puis comme une évidence : la nature de ce pays, immense, rude, sculptée par des siècles de survie, n’était pas un décor. Au début des années 2000, le gouvernement adopta donc un grand virage écologique, déterminé non seulement à protéger la terre, mais à la défendre. Des réserves immenses furent créées dans les forêts du Nord et autour du lac. Les mines furent nationalisées pour limiter les dégâts, et certaines fermées, malgré les protestations. Le long de la côte, d’anciens villages de pêcheurs furent transformés en sanctuaires marins, leurs habitants devenant les gardiens d’une biodiversité fragile. Les feux de plaines furent mieux contrôlés par des équipes mixtes. Entre 2005 et 2015, l’économie connut enfin un redressement modeste mais réel. Les industries écologiques (bois durable, agriculture régénératrice, énergies propres venues des vents des plateaux ou des torrents des vallées) prirent de l’importance. Beaucoup de citoyens vivaient encore pauvrement, mais ils vivaient mieux que leurs parents : plus stables, mieux instruits, moins affamés, plus confiants. L’armée, elle aussi, évolua. Au même moment, un nouveau courant culturel apparut. On le nomma “le renouveau des racines”. Poètes, musiciens, peintres, conteurs… tous se mirent à célébrer l’histoire composite de la nation : les blessures anciennes, les alliances improbables, les paysages sauvages, la reconstruction lente. On redonnait vie aux mythes autochtones, aux chants des plateaux, aux danses du Sud et aux contes des colons. Puis vint l’année 2015, le Parlement vota officiellement la Doctrine de Protection Vitale, qui inscrivait dans la constitution la défense des ressources naturelles comme un devoir sacré de l’État, au même rang que l’éducation et la santé.