Activités étrangères en Ouwanlinda
Posté le : 28 mai 2024 à 21:45:27
402
Posté le : 02 juin 2024 à 11:31:13
7145
Les relations entre Velsna et l’Ouwanlinda n’ont jamais été des plus simples. Depuis le départ de la métropole de son ancienne colonie, l’Ouwanlinda est un fantôme qui revient frapper à la porte par intermittence, comme le rappel des propres échecs de la Grande République. Pour cause, beaucoup d’ouwanlindais reprochent les guerres post-coloniales à Velsna comme étant la conséquence d’une gestion catastrophique du pays. Parmi ces ouwanlindais, le dictateur Ateh Olinga est de ceux-là. Ironiquement, c’est sans doute les erreurs de Velsna qui ont propulsé au pouvoir ce qui n’était au départ qu’un simple soldat subalterne des autorités velsniennes. Qui est donc Ateh Olinga et qu’en est-il aujourd’hui de sa gestion du pays.
Du soldat à l’Amiral-Président :
Pour comprendre comment une telle figure a pu émerger au sein de la géopolitique afaréenne, il convient de redéfinir le contexte dans lequel elle est apparue, un contexte qui favorise l’ascension d’hommes de mains effectuant des coups de main meurtriers. A la suite d’années de lutte pour l’indépendance, les velsniens actent leur départ du pays dans les années 1960. Cependant, l’administration qu’ils ont mis en place est toujours là. Les velsniens, qui ont joué pendant plusieurs siècles sur les rivalités internes aux quatre ethnies du pays, avaient constitué un Etat reposant entièrement sur des fonctionnaires de l’ethnie hatti, qui était réputée la plus fidèle aux anciens colons. Que ce soit dans la haute fonction publique, dans l’administration territoriale, dans les milieux universitaires ou dans les rangs de l’armée, les hatti furent pendant plus de deux siècles en situation de surreprésentation. Malheureusement pour eux, leur pouvoir ne tenait qu’au fait que Velsna était là. Une fois que les colons eurent à partir, les hatti furent contraints d’administrer seuls un pays peuplé de citoyens éprouvant une profonde rancœur pour ceux qu’ils estimaient être des collaborateurs. Tant bien que mal, les hatti ont gouverné le pays de 1961 à 1986, dans un système censitaire qui s’apparentait à celui que les velsniens avaient mis en place et qui, encore une fois, leur garantissait une surreprésentation dans les institutions du pays. Bien que le pays, durant cette période, vit un certain développement humain, ce dernier n’a jamais atteint une forme de stabilité véritable. Mais c’est avec une explosion des prix du pétrole, une ressource phare du pays, que l’Ouwanlinda s’enfonça dans la crise, puis la guerre civile.
Parmi toutes les ethnies, on vit l’émergence de milices armées qui s’allièrent au sein d’une organisation relativement nébuleuse : l’Armée de libération du Conseil des Quatre éthnies, ou l’ALCQE, abrégé en ALC. Le but de cette organisation est simple: mettre au règne de l’ethnie hatti sur l'Ouwanlinda, qui depuis la décolonisation s'était accaparée toutes les fonctions gouvernementales du pays. C’est dans ce remous de l’Histoire qu’apparait la figure d’Ateh Olinga en tant que bras armé de l’organisation. Olinga avait un profil pour le moins atypique. Ayant servi dans sa jeunesse dans l’armée ouwanlindaise, ce dernier a atteint le grade de lieutenant principalement grâce à sa carrure imposante et une certaine docilité, Olinga était ce que ses camarades auraient appelé un collaborateur. Mais ce n’est pas le chemin de la loyauté qu’a choisi ce soldat endurci.
En effet, son ascension dans l’armée fut des plus rapides malgré son appartenance à l’ethnie swouli, et Olinga servit le gouvernement durant plusieurs années, du moins en apparence. Alors qu’il se rapprochait doucement du grade de chef des armées du gouvernement, Olinga fonda en parallèle l’ALC en fusionnant les mouvements existants (ou plutôt en exécutant les autres leaders). On pourrait attendre de ce que l’on considère comme une brute un plan des plus simples pour accéder au pouvoir…mais étonnamment, Olinga se révéla particulièrement machiavélien, en faisant planer au gouvernement ouwanlindais une menace qu’il dirigeait dans les faits, contre laquelle il n’y avait que lui sur qui se reposer. Sa popularité grimpa en flèche d’autant qu’il sillonnait le pays à la rencontre des populations, là où le pouvoir était perçu comme distant et autoritaire. Confiant, Ateh Olinga prépara un coup d’état pour le 12 janvier 1986, mais celui-ci sous-estima les soutiens militaires dont disposait encore le gouvernement. Aussi, celui-ci, après un assaut raté sur le palais présidentiel d’Opanga dû se replier en panique et assumer définitivement sa casquette de chef rebelle.
De la guerre civile à l’exercice du pouvoir :
L’épreuve de la guerre révèle au monde des traits caractéristiques d’Olinga. La victoire, elle, ne l’adoucit pas. Les hatti doivent payer, il n’y a pas de réconciliation possible. Avec son assentiment, ses troupes encouragent les ouwanlindais des autres ethnies à se débarrasser des hatti, faisant dans le cadre d’appels radiophoniques constants des encouragements au massacre de tous les hatti du pays. On estime qu’Ateh Olinga est responsable de la mort d’1,5 millions de hatti, après quoi ce dernier proclame « la victoire des forces de libérations du pays ». Le sujet du génocide mériterait un article en soit, mais ce n’est pas là notre thème d’aujourd’hui. Toujours est-il qu’après cet évènement sanglant, un pays est à diriger.
Ateh Olinga ne change guère sa manière d’être, qui diffère peu entre celle de l’homme politique que celle du soldat. La mise en place d’un pouvoir personnel est rapide et dans les faits, peu s’y opposent, la plupart de ses éventuels adversaires n’ayant pas survécu à la guerre civile. Le règne d’Olinga est marqué par un ensemble de mesures qui seraient échelonnées du curieux au contre-productif. Le pays observe dans les années suivantes un véritable effondrement économique. En effet, les membres de l’ethnie hatti possédaient les meilleures terres agricoles et comptaient le plus de diplômés dans leurs rangs. Dans l’après-guerre civile, il ne fallu guère longtemps pour qu’Olinga s’attaque à la saisie des terres des hatti, les redistribuant au passage aux membres des autres ethnies. Cependant, cette solution s’avérera très rapidement catastrophique, les remplaçants des hatti n’ayant pas le même degré d’expertise que les anciens propriétaires. Conséquence : la production agricole chute de moitié entre 1986 et 2000, se relevant avec peine à partir de cette date sans pour autant retrouver ses niveaux d’origine. Quant à l’administration et l’élite économique hatti, celle-ci a déserté le pays, laissant sur place un personnel moins bien formé et un effondrement des capitaux ouwanlindais. En 2013, le pays sort avec peine de cette période difficile avec des indicateurs économiques qui tendent très lentement à repartir, mais nous sommes à des années d’un véritable rattrapage économique. Parmi d’autres mesures dont l’économie a pu souffrir des décisions d’Olinga, le décret de départ des minorités nazumi du pays ordonné en 1990 après une poussée de xénophobie à leur encontre. En effet, les colonisateurs velsniens, à la recherche d’une main d’œuvre qualifiée avaient depuis le début du XXème siècle ouvert le pays à une immigration étrangère. Ces nazumi, devenus pour la plupart les membres d’une classe moyenne éduquée, étaient perçus comme des avatars d’une colonisation passée par le reste de la population. Logiquement, la crise économique est donc aggravée par leur départ forcé.
Économiquement, il convient de dire que le règne d’Ateh Olinga est pour l’instant un echec, même si des améliorations sont à noter ces dernières années. Politiquement, l’Ouwanlinda est plus isolé que jamais, si on excepte des puissances qui ont fait de l’anticolonialisme une priorité. La vie culturelle est elle également au point mort, ou presque. Olinga ne pourra compter ces prochaines années, que sur une éventuelle prospection de ressources marines qui tarde à venir compte tenu de la faiblesse des investissements étrangers. Pour l’instant, il nous est permis de douter que l’Ouwanlinda sera le futur miracle économique du continent afaréen.
Posté le : 01 jan. 2025 à 20:13:10
2094

Depuis plusieurs heures, un mystérieux bateau militaire, une corvette, pouvait être aperçu par la population ouwanlindaise à quelques kilomètres de la ville de Triomphe d’Ateh. "Appartient-il à notre pays ?" se demandaient certains habitants. Quelques-uns commençaient à y croire et à se dire que leur amiral-président avait raison lorsqu’il affirmait, dans ses affiches de propagande, que la République d’Ouwanlinda était une grande puissance en Afarée. Pourtant, d’autres avaient du mal à y adhérer. Pourquoi l’armée aurait-elle envoyé un navire faire des allers-retours près de la ville sans en informer quiconque ?
De plus, un étendard flottait au sommet du navire. Mal visible de loin, certains Ouwanlindais, dotés d’une bonne vue, distinguaient néanmoins des tons de blanc, une couleur peu présente sur leur drapeau.
Au fil des minutes, puis des heures, la nouvelle de cette présence mystérieuse se répandit dans une partie de la ville, jusqu’à alerter les autorités locales. Cependant, même celles-ci semblaient ignorantes de la situation et tentaient de communiquer avec leurs supérieurs. Contre toute attente, ce n’est pas une réponse ouwanlindaise qui apporta des éclaircissements, mais l’équipage du bateau lui-même, remarquant la foule grandissante observant leur navire.
" Très bien, ça fonctionne ? "
Ces mots résonnèrent, diffusés par des haut-parleurs installés à bord. Bien que les habitants éloignés de la côte ne puissent les entendre distinctement, ceux situés près de l’océan les percevaient clairement.
"Très bien, je me présente : je suis l’officier Menduk Mozan de la marine nationale antérienne. Si ce bateau est ici, c’est en raison de la guerre que VOTRE dirigeant, Monsieur Ateh, a déclarée à la République démocratique libre du Gondo. Pourquoi ? Justement ! Aucune raison valide n’a été donnée par votre dirigeant, qui a fait preuve d’une ingérence totale. Nous vous avertissons que, si ce navire est menacé, il y aura une réponse lourde et ferme."
Antérienne ? Cette nationalité évoquait quelque chose pour certains habitants. Bien sûr ! Un échange diplomatique avait eu lieu entre les deux pays.
L’événement fit rapidement le tour de la ville par le bouche-à-oreille. Bientôt, tout Triomphe d’Ateh bruissait de rumeurs : un navire étranger, mystérieux et menaçant, semblait défier la République d’Ouwanlinda.
Posté le : 01 jan. 2025 à 21:49:12
1758
**/06/2015
La guerre au porte de la fédération centrale démocratique d'Antegrad.
Dans un communiqué de presse, le récent allié de la Fédération, la République démocratique libre du Gondo, a annoncé qu’après que le gouvernement de la République d’Ouwanlinda a envoyé une machette en guise de déclaration de guerre, le Gondo a accusé réception de ce geste en proclamant officiellement la guerre contre Ouwanlinda.
La Fédération centrale démocratique d’Antegrad a accusé le gouvernement, et plus précisément le dirigeant de la République d’Ouwanlinda, d’ingérence et de déclaration de guerre injustifiée. En réponse, l’ambassadeur de la République d’Ouwanlinda a été convoqué au Palais suprême par Ismael Idi Amar, le chef suprême de la Fédération centrale démocratique d’Antegrad.
Le ministère de l’Armée a annoncé l’envoi d’un navire militaire pour intimider la République d’Ouwanlinda. En outre, il a confirmé que des troupes et du matériel militaire antérien étaient déjà déployés sur le sol gondolais afin d’aider "nos frères", comme les a qualifiés le ministre, face aux rebelles. En réponse à la déclaration de guerre d’Ouwanlinda contre le Gondo, le ministère a également officialisé l’envoi de renforts supplémentaires en hommes et en matériel militaire. Par ailleurs, le ministère de l’Économie de la Fédération a imposé des sanctions économiques sévères à l’encontre de la République d’Ouwanlinda. Tous les produits en provenance d’Ouwanlinda seront désormais soumis à une taxe supplémentaire de 45 %. De son côté, le ministère des Eaux et des Zones économiques exclusives a instauré un contrôle strict sur tous les navires commerciaux ouwanlindais transitant par la pointe sud du continent.
Enfin, le ministère de l’Armée n’exclut pas de potentielles actions militaires directes contre la République d’Ouwanlinda si celle-ci "dépasse les bornes".
Nous vous tiendrons informés des développements de cette situation.
Le Draim
La guerre au porte de la fédération centrale démocratique d'Antegrad.
Dans un communiqué de presse, le récent allié de la Fédération, la République démocratique libre du Gondo, a annoncé qu’après que le gouvernement de la République d’Ouwanlinda a envoyé une machette en guise de déclaration de guerre, le Gondo a accusé réception de ce geste en proclamant officiellement la guerre contre Ouwanlinda.
La Fédération centrale démocratique d’Antegrad a accusé le gouvernement, et plus précisément le dirigeant de la République d’Ouwanlinda, d’ingérence et de déclaration de guerre injustifiée. En réponse, l’ambassadeur de la République d’Ouwanlinda a été convoqué au Palais suprême par Ismael Idi Amar, le chef suprême de la Fédération centrale démocratique d’Antegrad.
Le ministère de l’Armée a annoncé l’envoi d’un navire militaire pour intimider la République d’Ouwanlinda. En outre, il a confirmé que des troupes et du matériel militaire antérien étaient déjà déployés sur le sol gondolais afin d’aider "nos frères", comme les a qualifiés le ministre, face aux rebelles. En réponse à la déclaration de guerre d’Ouwanlinda contre le Gondo, le ministère a également officialisé l’envoi de renforts supplémentaires en hommes et en matériel militaire. Par ailleurs, le ministère de l’Économie de la Fédération a imposé des sanctions économiques sévères à l’encontre de la République d’Ouwanlinda. Tous les produits en provenance d’Ouwanlinda seront désormais soumis à une taxe supplémentaire de 45 %. De son côté, le ministère des Eaux et des Zones économiques exclusives a instauré un contrôle strict sur tous les navires commerciaux ouwanlindais transitant par la pointe sud du continent.
Enfin, le ministère de l’Armée n’exclut pas de potentielles actions militaires directes contre la République d’Ouwanlinda si celle-ci "dépasse les bornes".
Nous vous tiendrons informés des développements de cette situation.
Posté le : 01 jan. 2025 à 23:17:21
864
En espérant que le message soit passé
Le navire, présent à quelques kilomètres de la ville de Triomphe d'Ateh depuis plusieurs heures, repart finalement d’où il était venu. Les habitants de la ville l’observent pour ce qu’ils pensent être la dernière fois, regardant le bateau s’éloigner au loin. L’équipage, quant à lui, espère que le message a bien été compris et qu’il ne sera pas perçu comme une provocation, mais plutôt comme une tentative de prévention visant à empêcher que la guerre ne devienne une réalité. Après tout, ils ne vont quand même pas réaliser un débarquement en République démocratique libre du Gondo. Comment pourraient t'ils faire cela ?
Le navire et son équipage regagnent alors Port Waji-les-Golfes, en Fédération Centrale Démocratique d’Antegrad, sans avoir rencontré de problèmes durant leur mission. Alors qu’ils ne sont plus qu’à quelques kilomètres du port, l’équipage décide de célébrer leur succès en s’octroyant une cuite bien méritée.
Le navire, présent à quelques kilomètres de la ville de Triomphe d'Ateh depuis plusieurs heures, repart finalement d’où il était venu. Les habitants de la ville l’observent pour ce qu’ils pensent être la dernière fois, regardant le bateau s’éloigner au loin. L’équipage, quant à lui, espère que le message a bien été compris et qu’il ne sera pas perçu comme une provocation, mais plutôt comme une tentative de prévention visant à empêcher que la guerre ne devienne une réalité. Après tout, ils ne vont quand même pas réaliser un débarquement en République démocratique libre du Gondo. Comment pourraient t'ils faire cela ?
Le navire et son équipage regagnent alors Port Waji-les-Golfes, en Fédération Centrale Démocratique d’Antegrad, sans avoir rencontré de problèmes durant leur mission. Alors qu’ils ne sont plus qu’à quelques kilomètres du port, l’équipage décide de célébrer leur succès en s’octroyant une cuite bien méritée.
Posté le : 05 jan. 2025 à 00:01:02
1481
Tiens donc, le satellite antérien Venos1, envoyé le 01/02/2014, ne servait pas uniquement à réaliser des photos de l'espace. Surprenant, non ? En tout cas, ce ne l'était pas pour les militaires antériens présents dans le centre de recherche aérospatiale de Destint, qui ont pu réaliser quelques clichés du territoire ouwanlindais vu de l'espace le 01/07/2015. "Quelques" est un bien joli mot pour dire plus de 200, sous l'ordre du ministère des Armées terrestre, aérienne et navale de la fédération. Pourquoi cela ? Quelque chose se préparait, ou peut-être s'agissait-il de chantage ? Enfin bref.
Après avoir transféré les clichés à une des bases militaires de la ville de Port Waji-Les-Golfes, ceux-ci tombent dans les mains d'Arthur Sucré. Qui est cet homme ? Probablement un haut responsable de l'armée. Avec autant de clichés du pays, il est peu probable que quelque chose passe inaperçu, surtout dans le nord du pays. D'après les plus de 200 clichés pris, à peine trois sont des images de la capitale ouwanlindaise, tandis que plus de 100 concernent le nord du pays. Pourquoi ? Il reste encore beaucoup de questions sans réponses : est-ce à cause de la guerre contre le Gondo, ou pour d'autres raisons ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses en temps voulu. Mais pour l'instant, il faudra patienter. Un jour, deux, une semaine, un mois, ou même un an, mais il faudra patienter.
En attendant, les images prises par le satellite sont traitées et étudiées par des militaires. Rien ne peut leur échapper dans le nord du pays... sauf ce qui est couvert par les arbres. Ils étudient longuement, très longuement, mais après plusieurs heures, ils trouvent enfin ce qu'ils cherchaient.
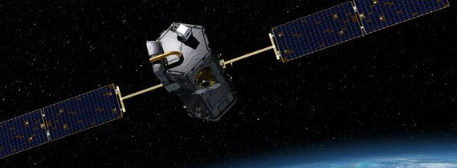
Posté le : 01 fév. 2025 à 02:15:40
2857

L'universalité, une quête de ferveur par l'expression de l'amour inconditionnel vers des sources notoires de dégoût.
L'universalité envers son prochain, cette capacité des uns et des autres à s'identifier comme le maillon d'une race à l'avenir prédéterminé par une force divine, supraterrestre, se fait en beaucoup de personnes, la quête d'une vie. Pour autant, au travers du paradis terrestre défini sous l'égide glorieuse et luminescente de la République Sacrée de Mandrarika, il est coutumier de constater l'intérêt vif et précoce de l'amour inconditionnel. Un amour débridé, tourné aveuglément vers celui qui partage sa race, pour louer un projet plus étendu encore, tourné vers la sublimation de l'Homme et sa reconnaissance en qualité d'être supérieur auprès de ses créateurs.
Relation d'amour et de fraternité entre les hommes, l'universalité est dès lors, un point de passage incontournable de la pensée caaganiste. Une étape déterminante, dans la capacité des uns et des autres à marquer son acceptation philosophique d'un courant qui prône l'échangisme et le libertinage. Pour faire la preuve de son amour inconditionnel, les fidèles caaganistes travaillent ainsi l'acceptation d'autrui sur l'étude de valeurs immorales qu'ils tiennent en repoussoir.
Les détestables égocentrisme et narcissisme d'Ateh Olinga, un catalyseur des valeurs universalistes pour qui cherche à sublimer sa pensée caaganiste.
L'égocentrisme d'Ateh Olinga, brutalement opposé à la vision humaniste développée par le culte caaganiste de Mandrarika et cantonné à ses pensées belliqueuses pour entretenir les intérêts et le soutien de minorités communautarisées sur la base de frontières, jure dans l'esprit du caaganisme. Érigée en figure guerrière, la personnalité d'Ateh Olinga vient effectivement faire de l'homme une représentation de premier plan, qui dessert la légitime quête des caaganistes, affairés à travailler leur adhésion autour des principes fondamentaux liés au culte.
Porteur de division, après sa cavalcade sauvagesse vers les contrées gondolaises, Ateh Olinda se fait l'expression exacerbée des individualités. Un obstacle à la représentation terrestre unifiée des hommes et des femmes, qui souhaitent se présenter sublimés à leurs créateurs, le jour de l'ascension.
En l'absence d'autres personnalités médiatiques fortes en Afarée, exception faite des figures religieuses et sacralisées du culte caaganiste, les frasques du dirigeant ouwanlindais nourrissent l'étude théologique des précepteurs caaganistes chargés d'inculquer un certain nombre de valeurs ardemment défendues par le culte. Dans ces circonstances, faites d'un monde marqué des diversités politiques, frontalières, la capacité des unes et des uns à faire émerger l'amour à destination d'un personnage à l'empathie aussi mal dégrossie qu'une hyène, comme celle du dictateur ouwalindais, vaut démonstration de foi en l'universalité.
Posté le : 17 fév. 2025 à 23:42:59
24790
À destination de la Commission des Ressources Stratégiques et de la Direction des Affaires Extérieures.
Rédigée par : Commission Spéciale pour la Coopération Internationale et le Développement
Date : 10/11/2015
Objet : Création d’une Commission dédiée à l’Approvisionnement en Eau Potable en Ouwanlinda. Analyse des besoins et moyens de mise en œuvre
L’Ouwanlinda fait face à une crise structurelle d’accès à l’eau potable. Seuls 34,3% de ses habitants disposent d’un accès fiable à une source d’eau potable sécurisée, une situation qui résulte à la fois de l’absence d’infrastructures adaptées, d’une gouvernance étatique défaillante et d’un modèle d’administration territoriale fragmenté, où la majorité des ressources et des services restent sous la responsabilité des autorités villageoises.
Dans le cadre des accords bilatéraux conclus entre l’Union des Communes du Grand Kah et la République de l’Ouwanlinda, il a été acté que l’Union apporterait un soutien technique, financier et logistique à l’extension et à la sécurisation de l’accès à l’eau potable sur l’ensemble du territoire ouwanlindais. Ce programme de coopération représente un enjeu humanitaire majeur mais également un vecteur d’influence stratégique dans une région où l’Union cherche à renforcer son empreinte face à des puissances rivales. Par conséquent, cette note a pour objet de poser les bases de la Commission Kah-tanaise pour l’Approvisionnement en Eau Potable en Ouwanlinda (CKAEP-O), qui sera l’organe de coordination centralisé du projet.
2. Analyse des besoins en Ouwanlinda
2.1 État des lieux de l’accès à l’eau
L’Ouwanlinda, avec ses 31 millions d’habitants, fait face à une crise perpétuelle en matière d’accès à l’eau potable, marquée par d’importantes disparités entre les zones urbaines et rurales. Environ 70 % de la population réside en milieu rural, où l’accès aux infrastructures modernes est pour ainsi-dire extrêmement limité. Les habitants doivent souvent se tourner vers des solutions improvisées, telles que des puits artisanaux ou des captations d’eau de pluie, avec des risques sanitaires élevés. En revanche, les 30 % de la population urbaine bénéficient d’un accès plus régulier à l’eau potable, bien que celui-ci demeure irrégulier et insuffisant, principalement en raison de l’état vétuste et sous-dimensionné des installations de distribution existantes, datant généralement de la période coloniale.
Le réseau d’infrastructures publiques est extrêmement limité, se concentrant uniquement sur les principaux centres urbains, tandis que l’arrière-pays demeure quasi dépourvu d’équipements fiables. L’approvisionnement en eau repose sur un système à plusieurs niveaux : dans les villes, les réseaux de distribution, bien qu’existants, souffrent d’un manque d’entretien chronique et de pannes fréquentes ; en milieu rural, la population dépend majoritairement de forages artisanaux et de puits, qui ne garantissent ni la sécurité ni la continuité de l’approvisionnement. En parallèle, des réseaux informels de distribution se sont développés, mais ceux-ci acheminent une eau souvent contaminée, exposant la population à de graves risques sanitaires. L’Office national des eaux, en théorie responsable de la gestion et du développement des infrastructures, s’avère structurellement inefficace, en raison d’un manque de moyens, de coordination et de contrôle sur l’ensemble du territoire.
2.1 Défis techniques et logistiques
Les défis liés à l’eau potable en Ouwanlinda sont nombreux et d’une complexité qui requiert une intervention structurée et coordonnée. L’un des premiers problèmes est l’absence totale de stations modernes de traitement de l’eau, empêchant toute purification systématique avant distribution. Cette situation contribue directement à une forte prévalence des maladies hydriques parmi la population, notamment la dysenterie, le choléra et diverses parasitoses, qui demeurent des causes majeures de mortalité infantile et de complications sanitaires. En parallèle, les infrastructures existantes souffrent d’un manque chronique de maintenance, entraînant une perte considérable d’eau due aux fuites et aux détériorations non réparées des canalisations. La gestion des ressources hydriques est également fragilisée par une saisonnalité marquée, rendant l’approvisionnement particulièrement dépendant des précipitations. En saison sèche, de nombreuses régions connaissent des pénuries critiques, faute de stockage adéquat et de systèmes de gestion des réserves.
Le cadre réglementaire relatif à l’eau est pratiquement inexistant ou inopérant, laissant place à une gestion chaotique et à des pratiques non contrôlées. Les autorités locales, en particulier en milieu rural, ne disposent pas des moyens nécessaires pour superviser ou coordonner une distribution équitable et sécurisée des ressources. Enfin, la fragmentation administrative du pays, où les compétences sont dispersées entre le gouvernement central, les entités locales et des initiatives communautaires informelles, complique encore davantage toute tentative de planification et d’optimisation des infrastructures hydrauliques. Face à cette situation, il est impératif de mettre en place une stratégie cohérente et efficace, associant renforcement des infrastructures, amélioration des cadres de gestion et développement d’une coopération entre l’Union et les autorités locales pour garantir un accès stable et universel à l’eau potable en Ouwanlinda. Nous partons ici presque de zéro.
3. Objectifs stratégiques de la Commission
3.1. Objectifs immédiats (6 à 12 mois)
Dans un premier temps, la priorité de la Commission sera d’établir un diagnostic global des infrastructures existantes, en étroite collaboration avec les autorités ouwanlindaises et des experts en hydrologie. Cette évaluation approfondie permettra d’identifier précisément les lacunes du réseau d’approvisionnement en eau et de définir des axes d’intervention stratégiques. Sur la base de ce diagnostic, les zones prioritaires d’intervention seront déterminées en fonction de critères sanitaires et démographiques. Les secteurs les plus touchés par le manque d’eau potable et les maladies hydriques seront ciblés en priorité afin d’assurer une réponse rapide et efficace.
Parallèlement, des unités mobiles de purification et de distribution d’eau seront déployées dans les régions les plus critiques. Ces unités permettront de fournir une source immédiate d’eau potable aux populations vulnérables, tout en assurant un suivi sanitaire pour mesurer l’impact de ces interventions (voir chapitre 4). Le programme intégrera également un plan de forages de puits profonds, mené avec l’assistance technique kah-tanaise. L’objectif est de créer des points d’accès autonomes à l’eau potable, particulièrement dans les zones rurales où les infrastructures publiques sont inexistantes.
Enfin, un renforcement du système de collecte et de distribution sera initié dans les centres urbains, notamment par l’amélioration de la maintenance et de la gestion des infrastructures existantes. Ce volet vise à optimiser l’utilisation des ressources disponibles, à limiter les pertes dues aux fuites et à accroître la capacité des réseaux de distribution à répondre à la demande croissante.
3.2. Objectifs à moyen terme (1 à 5 ans)
Une fois les interventions d’urgence stabilisées, la Commission mettra en œuvre un programme de construction d’infrastructures durables de traitement de l’eau, adaptées aux conditions géographiques et climatiques des différentes régions ouwanlindaises. Ces stations de traitement permettront une distribution fiable et continue d’eau potable, réduisant ainsi la dépendance aux solutions temporaires.
Dans cette même optique, le déploiement d’un réseau de distribution national sera progressivement amorcé. Ce réseau, sécurisé et géré de manière coopérative entre le Grand Kah et l’Ouwanlinda, garantira un accès élargi et structuré à l’eau potable pour l’ensemble de la population.
Afin d’assurer la pérennité des installations, un programme de formation locale sera lancé. Il aura pour objectif de former des techniciens ouwanlindais spécialisés dans la gestion et la maintenance des infrastructures hydrauliques. Cette initiative vise à renforcer l’autonomie technique du pays, réduisant ainsi la nécessité d’une assistance extérieure à long terme. Enfin, pour encadrer ces avancées, un cadre légal de gestion de l’eau sera soumis au gouvernement de la République. Ce cadre visera à garantir un accès universel et régulé aux ressources hydriques, tout en prévenant d’éventuelles dérives liées à la privatisation ou à une gestion inefficace des infrastructures.
3.3. Objectifs à long terme (5 ans et plus)
L’objectif ultime de la Commission est d’aboutir à une autonomie complète de l’Ouwanlinda en matière d’accès à l’eau potable. À terme, le pays devra disposer d’infrastructures modernisées, d’un réseau de distribution efficient et d’un système de gestion locale capable d’assurer la pérennité des installations sans intervention extérieure. L’intégration de l’Ouwanlinda dans un réseau hydrique régional constituera également une priorité. Cette approche permettra de mutualiser les ressources avec les pays voisins, favorisant ainsi une gestion plus équilibrée et solidaire des réserves d’eau sur le long terme. S'il est possible que cet aspect pose un problème politique et diplomatique de taille, la commission aura le temps d'envisager des solutions pour convaincre les autorités ouwanlindaise et voisines du bien-fondé de cette démarche.
L’eau devra devenir un levier de développement économique et de stabilité sociale pour l’Ouwanlinda. La mise en place d’une gestion durable et coopérative des ressources hydriques contribuera non seulement à l’amélioration des conditions de vie, mais aussi à l’essor économique du pays, en facilitant l’agriculture irriguée, l’industrie locale et les services de base. Ces efforts, articulés autour d’une vision stratégique cohérente, permettront à l’Ouwanlinda de tourner définitivement la page de la précarité hydrique et de bâtir un modèle de coopération durable avec le Grand Kah et ses autres partenaires.
4. Répondre à l’urgence et obtenir des résultats tangibles
Le gouvernement ouwanlindais, fidèle à son habitude de décréter des objectifs irréalistes, exige des résultats visibles en six mois. Une exigence techniquement impossible à tenir si l’on souhaite bâtir des infrastructures durables et pérennes. Comme nous venons de le voir, la mise en place d’un réseau hydrique efficace, sécurisé et fonctionnel nécessite des années de travail, une planification rigoureuse et un engagement méthodique des ressources humaines et matérielles. Les chantiers de stations de traitement, la modernisation du réseau de distribution et la formation des techniciens locaux ne peuvent être précipités sans compromettre leur efficacité et leur longévité.
Cependant, la nécessité de présenter des avancées tangibles dans ce laps de temps impose une stratégie en deux phases, combinant mesures d’urgence visibles et déploiement progressif des infrastructures définitives. L’objectif n’est pas seulement de satisfaire les exigences politiques du régime, mais aussi d’éviter que l’échec perçu du programme ne soit instrumentalisé contre l’Union, ce qui pourrait nuire à la coopération à long terme.
Dès les premières semaines, il s’agira donc de concentrer les efforts sur des solutions à effet rapide, permettant d’afficher des progrès visibles tout en maintenant la crédibilité du projet :
Pour répondre rapidement aux besoins en eau potable, des stations légères montées sur camions ou conteneurs seront déployées dans les zones prioritaires, notamment les grands centres urbains et les villages les plus vulnérables. Ces unités permettront une distribution immédiate d’eau traitée, limitant ainsi les risques sanitaires liés à la consommation d’eau contaminée. Leur présence visible sur le terrain jouera également un rôle clé dans la perception du projet, en offrant aux autorités locales et à la population une preuve tangible des avancées réalisées.
Plutôt que d’attendre l’achèvement des nouvelles infrastructures, une approche pragmatique consistera à réhabiliter rapidement les canalisations les plus endommagées et à installer des conduites provisoires pour améliorer la distribution d’eau. Cette solution, bien que temporaire, maximisera l’efficacité du réseau actuel et permettra d’obtenir des résultats concrets dans un délai restreint. Elle garantira une amélioration immédiate des conditions d’accès à l’eau potable, tout en préparant le terrain pour des infrastructures plus durables. Parallèlement, l’acheminement d’eau en bouteilles ou par réservoirs mobiles sera utilisé comme une réponse temporaire aux besoins urgents des populations. En mobilisant une flotte de camions-citernes, il sera possible d’assurer un approvisionnement en eau potable aux communautés les plus touchés. Cette mesure, bien que transitoire, contribuera à stabiliser la situation sanitaire et à renforcer la crédibilité du programme auprès des habitants et des médias locaux.
Il est essentiel d’accompagner ces actions d’un effort de communication structuré pour valoriser le projet auprès de la population et des autorités. Une stratégie médiatique bien orchestrée permettra au gouvernement ouwanlindais de capitaliser politiquement sur ces avancées, réduisant ainsi la pression exercée sur l’équipe de mise en œuvre. Cette campagne devra mettre en avant les premières réalisations du programme et souligner les bénéfices immédiats pour les habitants, même si certaines solutions restent temporaires.
Bien que ces mesures soient avant tout destinées à répondre à des impératifs de court terme, elles garantiront une visibilité immédiate du programme et poseront les bases nécessaires à la mise en place d’infrastructures hydrauliques pérennes. En conciliant résultats rapides et planification à long terme, ce dispositif permettra de satisfaire les attentes des autorités locales tout en assurant une amélioration progressive et durable de l’accès à l’eau potable en Ouwanlinda.
Cette approche permettra de répondre aux exigences politiques du régime tout en évitant que des solutions précipitées ne compromettent la viabilité du projet. Il s’agit d’offrir une illusion de rapidité, tout en maintenant le cap sur les objectifs structurels, sans lesquels toute amélioration resterait temporaire et fragile. L’enjeu dépasse largement la simple dimension technique ou logistique : il est également politique et stratégique. La réussite du programme dépendra de la capacité à naviguer entre les impératifs de communication du régime et les nécessités d’un développement responsable, afin d’éviter que ce projet essentiel ne soit sacrifié aux intérêts immédiats du pouvoir en place.
5. Moyens mis en œuvre par l’Union
5.1. Ressources humaines
L’engagement du Grand Kah en Ouwanlinda repose avant tout sur un détachement d’ingénieurs spécialisés en hydraulique et en gestion des ressources en eau, placés sous la supervision directe de la CKAEP-O. Ces experts auront pour mission d’évaluer les besoins locaux, de concevoir des infrastructures adaptées et de superviser leur mise en place. En parallèle, la crise sanitaire liée à la contamination des sources d’eau impose la mobilisation d’équipes médicales, dont le rôle sera d’assurer un suivi sanitaire continu des populations bénéficiaires. Ce volet est essentiel pour mesurer l’impact des nouvelles infrastructures sur la santé publique et adapter les interventions en conséquence.
Enfin, pour garantir la pérennité du projet, une formation ciblée des personnels locaux sera organisée. Un cursus d’apprentissage accéléré sera mis en place afin d’enseigner aux techniciens ouwanlindais la maintenance et la gestion des infrastructures hydrauliques. L’objectif est d’assurer une autonomie progressive des communautés locales et de réduire leur dépendance aux interventions extérieures.
5.2. Ressources matérielles et logistiques
Sur le terrain, la réponse kah-tanaise s’appuiera sur une série de moyens matériels et logistiques adaptés aux contraintes locales. En premier lieu, des stations mobiles de purification et de dessalement seront déployées afin de répondre aux besoins immédiats des populations les plus touchées par le manque d’eau potable. Ces unités seront installées stratégiquement à proximité des zones urbaines sous-équipées et dans certaines régions rurales à forte densité. Un approvisionnement en matériel de forage et en canalisations sera également assuré, en coopération avec les industries kah-tanaises spécialisées dans les infrastructures hydrauliques. Ce matériel permettra à la fois d’améliorer l’existant et d’étendre la couverture en eau potable à des zones jusqu’alors non desservies.
L’acheminement de ces équipements sera facilité par la mise en place d’un corridor logistique dédié, reliant les ports kah-tanais aux principales zones d’intervention en Ouwanlinda. Ce corridor garantira une fluidité dans l’acheminement des ressources, tout en réduisant les risques de retards liés aux infrastructures routières ouwanlindaises souvent dégradées. Les installations reposeront tant que possible sur une approche énergétiquement durable grâce à l’approvisionnement en unités de pompage solaire. L’utilisation de ces dispositifs permettra de maximiser l’efficacité énergétique du réseau d’adduction d’eau et de limiter la dépendance à des sources d’énergie peu fiables ou coûteuses, tout en renforçant l’autonomie des infrastructures locales.
5.3. Financement et coordination
La mise en œuvre de ce projet nécessite une planification budgétaire rigoureuse et un contrôle strict des fonds alloués. Une enveloppe initiale de 850 millions devises libertaires kah-tanaises sera allouée à ce programme, répartie sur une période de cinq ans afin d’assurer une montée en puissance progressive des infrastructures.
Un financement conjoint avec des institutions partenaires et des États alliés sera envisagé pour renforcer les capacités d’investissement et accélérer la mise en œuvre des infrastructures les plus critiques. Cette approche permettrait de partager les coûts tout en consolidant les alliances stratégiques régionales. Une extension de la mise en place du programme via des accords avec des ONG internationales ou d'autres pays de l'Internationale Libertaire pourrait permettre de réduire le coût financier de l'opération pour l'Union.
Pour garantir la transparence et l’efficacité de l’allocation des ressources, un comité mixte kah-tano-ouwanlindais sera mis en place. Il aura pour mission de superviser l’exécution du projet, d’évaluer l’impact des investissements et d’assurer le suivi budgétaire. Ce comité sera chargé d’effectuer des audits réguliers, de proposer des ajustements si nécessaire et d’impliquer les autorités locales dans la gestion du projet afin d’en assurer la durabilité à long terme. Nous préconisons à ce titre le déploiement avec l'accord des autorités locales d'agents de l’Égide.
6. Organisation de la Commission Kah-tanaise pour l’Approvisionnement en Eau Potable (CKAEP-O)
La Commission Kah-tanaise pour l’Approvisionnement en Eau Potable sera une instance spécialisée placée sous la double supervision du Commissariat aux Affaires Extérieures et de la Commission des Ressources Stratégiques (et de ses éventuels successeurs). Bien qu’elle bénéficiera d’une autonomie de gestion, son action restera alignée sur les orientations stratégiques générales de l’Union, garantissant ainsi une cohérence entre les objectifs techniques, humanitaires et diplomatiques du projet.
Son fonctionnement reposera sur une structure tripartite :
Le pôle technique sera en charge de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des projets d’infrastructure. Il regroupera des ingénieurs spécialisés en hydraulique, en gestion des ressources hydriques et en logistique, afin d’assurer la construction et la maintenance des installations. Ce pôle aura également la responsabilité de l’optimisation énergétique des infrastructures, notamment à travers l’intégration de pompes solaires et l’amélioration de la gestion des réseaux de distribution existants.
Le pôle humanitaire, quant à lui, se consacrera à la veille sanitaire et aux campagnes de sensibilisation auprès des populations ouwanlindaises. Il travaillera en coopération avec les structures sanitaires locales pour surveiller et prévenir les risques épidémiologiques liés à l’eau, tels que la dysenterie et le choléra. Ce pôle sera aussi chargé de mettre en place des programmes d’éducation à l’hygiène et à la gestion des ressources en eau, garantissant ainsi un impact durable sur les habitudes des communautés bénéficiaires. Une évaluation sociale et sanitaire régulière des infrastructures mises en place sera effectuée afin de mesurer leur efficacité et d’adapter les interventions en conséquence.
Enfin, le pôle diplomatique et stratégique aura pour mission de gérer les relations bilatérales avec le gouvernement ouwanlindais et les organisations internationales impliquées dans la gestion de l’eau. Il jouera un rôle central dans la négociation des accords, l’assurance de la transparence du projet et l’identification des opportunités de coopération régionale. Son objectif à long terme sera d’intégrer progressivement l’Ouwanlinda dans des mécanismes de gestion hydrique régionaux, permettant au pays de stabiliser ses infrastructures et d’éviter une dépendance excessive à l’aide extérieure. Officieusement, sa mission sera de tempérer les ardeurs de son excellence et de synthétiser l'ensemble du projet de façon à ce qu'il puisse être aisément compris par son Excellence.
La direction de la CKAEP-O sera collégiale et composée de représentants des trois pôles, sous la supervision d’un Représentant Général nommé conjointement par le Commissariat aux Affaires Extérieures et la Commission des Ressources Stratégiques.
Afin d’assurer une coopération étroite et efficace, un comité de liaison permanent sera mis en place entre la CKAEP-O et les autorités ouwanlindaises. Ce comité aura pour rôle de faciliter l’échange d’informations entre les techniciens kah-tanais et les responsables ouwanlindais, de définir conjointement les priorités en matière d’infrastructures et d’intervention humanitaire, ainsi que d’assurer une coordination logistique efficace pour l’acheminement des équipements et des ressources. Ce dialogue constant entre les deux parties permettra d’ajuster les stratégies en fonction des réalités locales et des éventuels obstacles rencontrés sur le terrain.
L’objectif final de cette coopération est d’aboutir à une gestion autonome des infrastructures hydriques par les autorités ouwanlindaises. Ce transfert de responsabilités se fera progressivement, en fonction des capacités techniques et administratives développées au sein des institutions locales. Pour garantir cette transition, un programme de formation et de transfert de compétences sera mis en place afin de permettre aux techniciens ouwanlindais de prendre en charge la maintenance et l’exploitation des infrastructures. Ce dispositif sera essentiel pour assurer une indépendance durable du pays en matière d’accès à l’eau potable, tout en réduisant à terme la nécessité d’une supervision kah-tanaise.
7. Enjeux de la coopération
La coopération entre le Grand Kah et l’Ouwanlinda dépasse largement la simple question de l’accès à l’eau potable. Elle s’inscrit dans une stratégie plus vaste de consolidation des alliances révolutionnaires en Afarée et d’accompagnement d’un pays qui, malgré son gouvernement dysfonctionnel et autocratique, a pris fait et cause pour la lutte pan-afaréenne et anti-coloniale. À une époque où les forces impérialistes cherchent à fragmenter les mouvements de libération pour maintenir leur emprise, il est impératif que l’Union prenne les devants et établisse un cadre de coopération structurant, capable d’assurer à la fois des avancées sociales immédiates et une transformation politique progressive.
Le paradoxe ouwanlindais est évident : le pays, marqué par une gouvernance autoritaire sous la férule d’Ateh Olinga, reste néanmoins idéologiquement proche des socialismes libertaires et du camp révolutionnaire mondial. Ce positionnement en fait un allié potentiel, mais également un État en perpétuel équilibre instable, où les divisions ethniques et religieuses ne demandent qu’à être ravivées par des acteurs extérieurs cherchant à renverser le régime sans prendre en compte les fragilités internes. Toute initiative en Ouwanlinda doit donc s’inscrire dans une vision de modernisation et de stabilisation à long terme, afin d’éviter qu’un éventuel changement de régime ne ramène le pays aux guerres fratricides des décennies passées.
Dans ce cadre, la mise en place d’une infrastructure hydrique fiable et universelle représente un levier politique et social majeur, capable de structurer le pays autour d’un projet commun et de préparer progressivement l’émergence d’une administration fonctionnelle. L’accès équitable à l’eau potable, garanti par une gestion publique et transparente, pourrait jouer un rôle stabilisateur en réduisant les tensions communautaires et en offrant une base matérielle solide sur laquelle des réformes plus profondes pourront s’appuyer.
Pour autant, cet engagement stratégique comporte des risques considérables. L’Ouwanlinda est un État profondément corrompu, où les fonds internationaux disparaissent fréquemment dans les circuits clientélistes du régime. Le risque que l’aide kah-tanaise soit détournée, mal utilisée ou captée par des réseaux d’influence liés au pouvoir en place est bien réel. Il est impératif d’instaurer des mécanismes stricts de contrôle et d’audit, notamment par l’implication directe d’observateurs kah-tanais sur le terrain et l’intégration de garanties contractuelles empêchant toute gestion opaque des ressources fournies.
Un autre danger réside dans la sécurité des personnels kah-tanais déployés sur le projet. L’Ouwanlinda, marqué par une instabilité chronique et un appareil sécuritaire chaotique, n’offre aucune garantie de protection fiable aux travailleurs étrangers. Des milices informelles, des factions rivales au sein du régime et même des réseaux criminels liés aux cartels pourraient percevoir la présence kah-tanaise comme une menace ou une opportunité d’exploitation. Il faudra donc prévoir un dispositif de sécurité renforcé, comprenant un encadrement strict des zones d’intervention, des équipes de protection dédiées et un protocole d’exfiltration en cas de crise.
La complexité centrale du projet réside dans la nécessité de maintenir un équilibre politique délicat. Si l’Union impose un contrôle trop rigide sur la gestion des infrastructures, le régime d’Olinga pourrait le percevoir comme une tentative d’ingérence, ce qui risquerait de faire capoter l’ensemble de la coopération. À l’inverse, une trop grande latitude laissée aux autorités locales aboutirait inévitablement à des détournements massifs de ressources et à une mise en œuvre inefficace. L’enjeu est donc de structurer cette coopération de manière graduelle et pragmatique, en instaurant des contre-pouvoirs internes, en impliquant des forces sociales locales favorables à une transformation progressiste et en utilisant la question hydrique comme point d’ancrage d’une modernisation plus large. La modernisation des infrastructures doit servir de socle à une recomposition du paysage institutionnel ouwanlindais et, à ce titre, être pensée comme intrinsèquement politique.
Bon courage aux futurs responsables de la Commission.
Salut et Prospérité.
Posté le : 18 mars 2025 à 12:54:37
4642
Le personnage détonne. C'est son style : le Président de l'Ouwanlinda, celui dont les titres ne tiennent pas au complet sur une carte de visite, Ateh Olinga, a ce caractère exubérant et imprévisible qui fait la réputation mondiale du pays. Le dictateur, qui se prévaut d'une popularité indiscutable parmi ses fanatiques autant que sur les forums d'internet de pays éloignés, est une personnalité haute en couleurs qui clive et qui divise en Azur.
Portée par un courant islamo-démocrate, panislamiste, multilatéraliste et universaliste, le mouvement pro-afaréen en Azur est incarné par l'actuel Ministre des Affaires étrangères, Jamal al-Dîn al-Afaghani. Ce spécialiste du droit musulman, savant religieux autant que diplomate et penseur de l'idéologie nationale, prétend mettre en place des structures pérennes pour asseoir l'Azur à la table des discussions internationales. Son objectif visant à promouvoir des enceintes multilatérales s'est notamment concrétisé par un engagement accru du Califat constitutionnel pour la paix au Gondo depuis 2015. Sous sa férule, les Affaires étrangères d'Agatharchidès ont déployé des efforts diplomatiques pour obtenir une nouvelle trêve dans le pays afaréen déchiré par la guerre civile, à travers une approche non-violente et non-coercitive, faisant le pari que la rhétorique et le calcul des intérêts des parties pouvait porter à une résolution négociée de la guerre. C'est, pour l'instant du moins, un échec ; les belligérants rejettent l'idée de nouvelles négociations.
Dans ce contexte, les gesticulations d'Olinga, qui a menacé à plusieurs reprises le gouvernement officiel du Gondo d'invasion terrestre en appui aux rebelles d'abord, puis de bombardements réguliers ensuite, ont plutôt tendance à contrecarrer la perspective d'une accalmie au Gondo. L'engagement "anti-colonialiste" et "anti-impérialiste" du charismatique leader ouwanlindais le mène à rechercher un affrontement frontal, verbal d'abord, militaire ponctuellement, avec le Gondo et les soutiens eurysiens du Président Flavier-Bolwou. A rebours, donc, d'une approche conciliante propice à un retour aux discussions voulue par la Porte Spendide.
Ateh Olinga est donc, à première vue, un élément gênant pour la stratégie azuréenne en Afarée sud-occidentale. Ses menaces répétées contre le Gondo sont une chose ; elles sont d'autant plus préoccupantes lorsqu'elles s'adressent à la Clovanie et à l'Antegrad, deux Etats qui ont des forces en présence dans la région, portant régulièrement la situation locale à un point d'ébullition préoccupant pour Agatharchidès. Par ailleurs, dans le souci de résoudre les problèmes structurels extrêmement graves de son pays, le régime Olinda a accru sa dépendance au Grand-Kah, un acteur international motivé par des intérêts idéologiques en poussée dans la région. L'alliance entre le petit Etat afaréen agressif et le Commissariat d'Axis Mundi inquiète l'Azur quant aux potentialités réelles d'un cercle de pacification afaréen. Les attitudes belliqueuses remettent en question la vision d'un afaréisme non-idéologique, vision azuréenne challengée par les conceptions partisanes ou situationnistes d'un Olinga.
Il ne faudrait cependant pas croire qu'Ateh Olinga est vu comme la bête à abattre à Agatharchidès. Si ses prises de paroles récurrentes et obscènes agacent le Ministre des Affaires étrangères, le Grand Vizir, lui, impose une approche tempérée, circonspecte et ouverte à une évolution positive. Beylan Pasha, le chef du gouvernement, est moins porté à l'afaréisme qu'Afaghani. Ses vues plus circonstancielles, et son absence de logique continentale dans la pensée diplomatique qu'il veut imprimer, ne le font pas nécessairement voir l'Ouwanlinda comme un caillou gênant les intérêts azuréens ; le Diwan ne perd en effet pas de vue les intérêts matériels très concrets qui unissent et peuvent renforcer une coopération entre les deux pays. L'Azur, représenté par sa société AZURIUM, investit fortement le secteur des minéraux et de l'industrie minière, l'un des piliers de l'économie ouwanlindaise. L'Afarée sud-occidentale est, on le sait, riche de gisements qui font son attrait pour les puissances internationales, et qui expliquent la forte conflictualité de la région. Disputes pour les ressources signifient aussi alliances de revers et partenariats opportunistes.
Pour l'Azur, la question est d'abord la sauvegarde de ses frontières et de ses intérêts. Puissance locale dotée d'un armement non négligeable, l'Ouwanlinda n'est pas nécessairement un adversaire. Dans le contexte de remplacement à venir de l'actuel Grand Vizir, démissionnaire pour raisons personnelles, la situation pourrait considérablement évoluer. Il est probable que s'il accédait à la fonction, Afaghani durcirait le ton ou chercherait à tempérer les ardeurs d'Ateh Olinga pour faire avancer son agenda pacificateur. En revanche, son principal concurrent, Habib Taşdemir, rejette explicitement l'idée de faire de l'afaréisme une préoccupation centrale ; si Taşdemir accédait au contraire à la direction de la Porte Splendide, il est probable que l'Ouwanlinda deviendrait un potentiel appui pour la défense des intérêts azuréens dans la région.
Posté le : 05 mai 2025 à 18:34:11
6464
Le maître du Crocodile a encore frappé. Après avoir menacé tour à tour le Gondo et la Clovanie de frappes, son duel rhétorique et militaire avec Ismael Idi Amar, le Président de l'Antegrad, est arrivé à son terme ; le missile Stéphane, fourni par la Loduarie communiste, a frappé ce dernier en plein coeur du Palais présidentiel antegrain. "L'ennemi est vaincu", pourrait claironner le multi-titrisé dictateur de l'Ouwanlinda, qui cueille une nouvelle médaille à accrocher à sa poitrine : celle de tueur d'Antegrain.
La frappe a cependant provoqué un effarement que le fantasque et demi-habile Aigle de Victoire ne semble pas avoir prévu. Après le Duché de Sylva, partenaire sécuritaire de l'Antegrad, c'est l'Azur qui se préparerait à mettre en place un embargo militaire complet sur l'Etat ouwanlindais, l'un des plus pauvres du monde, mais dont l'arsenal balistique vient de démontrer son efficacité. La décision de s'en prendre à la personne du chef de l'Etat antegrain sort en effet des clous de la diplomatie. Elle est une frappe symboliquement considérable, car elle met non pas seulement l'armée, mais l'essence même de la Fédération au défi de restaurer sa crédibilité. En général, les conflits d'honneur se règlent dans le sang - raison pour laquelle on évite en principe de faire couler celui des princes, et des chefs d'Etat en général.
On savait Olinga joueur, mais l'impudence avec laquelle l'assassinat d'Idi Amar a été planifié et exécuté, usant ouvertement de missiles à la technologie très avancée pour vaporiser son adversaire rhétorique, a tout de même de quoi surprendre. C'est que l'on n'a pas vu le fier Lion de l'Afarée s'en prendre de la sorte à ses voisins coloniaux de Fortuna, d'Antérinie ou du Picolastan - trois pays qui occupent pourtant une activité caractéristiquement coloniale et impérialiste en Afarée. Il aura fallu que ses bombardements soient réservés au régime gondolais et à l'Antegrad, deux Etats loin d'être irréprochables, mais qui ont pour eux cependant d'être d'authentiques puissances afaréennes dont la voix compte sur la scène continentale. Usant sans modération de la rhétorique pan-afaréenne, on peut à présent se demander si c'est véritablement l'unité, la prospérité et la liberté du continent qu'Ateh Olinga recherche quand il en trucide les chefs d'Etat.
Pour l'instant, bénéficiaire de l'aide internationale et paltoterrane en particulier, l'illusion semble encore faire effet. Elle se craquèle néanmoins. Olinga le champion de l'Afarée ? L'image fait grimacer à Agatharchidès, où l'on est depuis longtemps sceptique sur la possibilité de travailler avec un tel trublion pour faire avancer le continent sur des sujets concrets qui demandent moins de caméras et d'effets de tribune que de patience et de témérité. Coordination de la diplomatie, création d'une architecture de droit et de sécurité, mise en place de structures politiques proprement afaréennes et d'une réelle politique de développement demandent un tout autre travail que celui du conflit militaire à outrance. En réalité, par sa décapitation du régime antegrain, Olinga démontre moins sa volonté d'unir et d'émanciper l'Afarée que son obsession à prendre le contrôle du mouvement afaréiste, par l'élimination de ses concurrents si besoin.
Quel jeu joue-donc le Grand Boa Constrictor de l'Ouwanlinda ? Sans doute pas celui des populations et des sociétés civiles ; il affame la sienne et s'en prend à ses voisins, réservant l'essentiel de ses ressources à l'acquisition de coûteux bijoux guerriers qu'il dépense contre d'autres Afaréens au gré de ses humeurs. Sans doute pas celui non plus de son propre pays, qui n'a pas les moyens de soutenir un conflit de haute intensité et qui risque d'être confronté à un embargo d'une sévérité sans précédent. Attirant à lui les regards du monde, Olinga profite d'une visibilité éphémère mais plonge son pays dans des difficultés majeures avec ses interlocuteurs internationaux.
En réalité il ne faut pas pousser très loin l'interprétation pour conclure qu'Ateh Olinga, en multipliant les outrances et en frappant de la sorte l'un de ses frères afaréens, est d'abord et avant tout responsable d'un prolongement de la division du continent. Alors que le sommet de Mpanga patine, celui qui se fait le chantre de l'émancipation du continent devient l'idiot utile de puissances étrangères qui se prévalent des extravagances olinganiennes pour mieux justifier leur présence et leurs intérêts en Afarée. On a ainsi vu l'Empire du Nord, parmi d'autres, claironner de sa légitimité à coloniser l'Afarée face à des Etats autochtones barbares et imprévisibles. En témoignant d'une sauvagerie irréfutable à la tête de l'Ouwanlinda, Ateh Olinga s'agite comme un hideux hochet qui effraie les Afaréens et les détourne du pan-afaréisme.
Un hochet ; oui, Ateh Olinga pourrait bien n'être en fin de compte qu'un jouet dans un plan plus global. Car qui en Afarée peut croire que la division des Etats afaréens entre eux est souhaitable ? Qui peut se réjouir de la frappe sur Antegrad, qui n'a d'autre effet que de garantir l'impossibilité d'un rapprochement entre les deux pays avant bien longtemps ? Qui peut considérer que le signal envoyé à tous les vrais colonisateurs, aux vrais impérialiste, puisse être le bon ? Que gagne l'Afarée à ces agissements indignes d'un pays qui a voix au chapitre sur la scène mondiale ? Rien. Elle y perd.
Reste à déterminer si Olinga agit en connaissance de cause. Bien sûr, étant donné son caractère irascible, orgueilleux, fantasque et désarçonnant, l'on pourrait imaginer que le personnage, dont la psyché n'est sans doute pas en meilleure forme que l'IDH de la population placée sous son autorité, n'est pas bien au fait du caractère délétère de ses agissements. Peut-être l'Hippopotame des Peuples est-il agi par un inconscient dérangé et déraisonné qui l'empêche de mesurer les effets de ses décisions et qui le conduit à ce qui est, pour toute personne saine d'esprit, une extrémité des plus horrifiantes.
Encore faudrait-il, pour que cette hypothèse soit vraiment recevable, que le caractère aléatoire des frappes aveugles du dictateur ouwanlindais se vérifie. Mais un examen sérieux ne nous invite qu’à comprendre l’évidence ; non seulement Ateh Olinga frappe les Afaréens, mais il ne frappe que les Afaréens. En d'autres termes, Olinga est un agent bien efficace pour ceux qui, face à une Afarée divisée, avancent sournoisement leurs pions. En jetant les pays afaréens les uns contre les autres, il fait même d'une pierre deux coups ; car en plus de créer la discorde entre ceux qui pourraient s'unir contre leurs oppresseurs, il donne à ces derniers l'argument pour que se pérennise l'oppression ; cet argument, qui est de longue date celui des impérialistes, c'est celui de la sauvagerie, de l'irrationalité et de la violence des peuples opprimés. Face à Olinga, les véritables propriétaires des entreprises et des Etats qui grignotent chaque jour un peu plus peuples et ressources peuvent dormir tranquille ; si la seule alternative est l'absurde d'un Olinga, alors jamais les millions d'Afaréens qui vivent sous le joug de territoires d'outre-mer ou d'enclave territoriale spéciale ne songeront à véritablement s'organiser pour définir par eux-mêmes les contours de leur liberté. Merci, Olinga ! peuvent s'exclamer les colonialistes, félicitant leur inconsciente ou inavouée marionnette.
Posté le : 05 mai 2025 à 19:40:34
1810

Je m’adresse solennellement ici aussi bien à la Nation némédienne qu’à la Communauté internationale mes plus vives préoccupations suite au meurtre tragique du Président Ismael Idi Amar de la Fédération Centrale d’Antegrad, acte à la fois lâche et particulièrement tragique, s’attaquant à la vie d’un chef d’Etat, qui ne constitue pas seulement une offense à la souveraineté d’une Nation, mais au contraire attention à l’ordre international, et bien à la paix et à la dignité humaine, principes fondamentaux de la vie internationale. Et au nom de la Némédie condamnons cette violence, quelle qu’en soit l’origine ou la justification invoquée. Le meurtre de Son Excellence Monsieur le Président Idi Amar, cet homme d’Etat aux visions qui a fait la puissance de son pays, est une blessure pour tous les peuples de l’Afaree, blessure plus vive pour nous qui suivons attentivement l’évolution de cette région de cœur si proche de notre cœur.
En ma qualité de souverain, je réaffirme la position de la Némédie, jamais la violence ne peut être une solution. L’agression sur le Palais présidentiel anterien constitue un acte de guerre qui ne peut certes être couvert par la raison comme par la diplomatie. Notre solidarité s’exprime avec le peuple anterien, dans la douleur et le deuil. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille du disparu et tout notre soutien au peuple anterien.
La Némédie se déclare favorable à une réponse mesurée et responsable à la suite de cette tragédie. L’enquête internationale la plus impartiale possible sera nécessaire pour faire la lumière sur les circonstances de cette attaque et rendre responsables, devant la Justice, ceux qui l’ont commanditée. La Némédie, alliée de l’Antegrad , sera évidemment toujours présente aux côtés d’Antegrad, dans sa quête de Justice devenue nécessaire.
Que la paix de Dieu soit avec vous.
La Némédie se montre toujours aux côtés de ceux qui œuvrent pour la paix

Andronikos IV roi de Némédie
Fait à Epidion, ce jour, en l’an 2016
Posté le : 05 mai 2025 à 21:30:34
3224
Le Draim
Le chef suprême est mort, en héro.
Notre Chef suprême, notre Sainteté, notre Guide, notre Meneur, notre Grandeur, le dirigeant bien-aimé des peuples d'Antes est mort. Il a été sauvagement assassiné par un être barbare, une créature perfide, une hyène sans honneur, dont le poids n’a d’égale que sa bétise. Vous l’aurez deviné, le meurtrier odieux de notre Leader n’est autre qu’Ateh Olinga.
Cet homme, qui se prétend sauveur, n’est en réalité rien de plus qu’un pangolin complexé, cherchant désespérément à compenser ses complexe. Notre Chef suprême a été tué par un missile balistique, preuve irréfutable de l’infériorité du régime ouwanlindais. Oui, notre dirigeant inspirait tant de crainte qu’ils n’ont trouvé d’autre moyen que de tricher comme les vermines qu’ils sont pour l’éliminer.
Mais cette attaque lâche a causé bien plus de dommages : une dizaine de civils innocents ont également péri. Le bilan exact reste encore à établir. Ateh Olinga prétend défendre le peuple afaréen, mais autorise la mort de civils innocents. Et pourtant, certains osent encore soutenir ce tyran... Cependant, malgré ces pertes tragiques, notre nation a triomphé. Antegrad a infligé un coup retentissant en frappant avec succès une installation militaire ouwanlindaise. Les pertes militaire ennemies sont colossales, estimées à plusieurs dizaine de millions.
En réponse à cette attaque ignoble, nous ne répondrons pas par une guerre ouverte, car c’est ce que cherche le dictateur Ateh Olinga. Il veut la guerre, il veut voir son peuple souffrir. Son objectif n’est pas la défense des Afaréens, mais leur division pour mieux régner. Dès aujourd’hui, nous imposons un blocus maritime total dans la Manche Dorée. Aucun navire ouwanlindais qu’il soit commercial, militaire, scientifique ou autre ne sera autorisé à traverser nos eaux. Tout navire tentant le passage sera capturé, et s’il représente une menace, il sera coulé.
Nous rompons toutes relations diplomatiques avec l’Ouwanlinda. Son ambassadeur est sommé de quitter le territoire dans les prochaines 50 heures. Son logement sera temporairement occupé par des forces armées. Tous les ressortissants ouwanlindais soutenant ouvertement ce régime terroriste verront leurs visas annulés et leurs biens saisis.
Suite à la mort de notre Chef suprême, la Fédération Centrale Démocratique d’Antegrad entre en deuil national de deux semaines. Tous les citoyens anteriens devront porter du noir durant cette période. Les statues de Ismael Idi Amar seront voilées, et une grande marche funèbre sera organisée. Une colonne de 50 chars tirera chaque jour trois salves de canon à midi, en hommage à notre dirigeant tombé.
Le dirigeant temporaire, Second d’Ismael Idi Amar, a remercié les alliés Azurois, Némédiens, Sylvois, Slaviensks, Finejourois et bien d’autres pour leur soutien indéfectible en cette période difficile. Ce geste ne sera jamais oublié.
À travers le territoire anterrien, la colère du peuple s’est exprimée. Des milliers de citoyens ont manifesté devant l’ambassade ouwanlindaise. Les drapeaux ennemis ont été arrachés, brûlés, piétinés. Les murs ont été couverts de slogans justes comme “Dégagez” par exemple . Des images du tyran Ateh Olinga ont été lacérées et jetées aux flammes. Les employés de l’ambassade ont été hués, visés par des jets de fruits pourris, parfois bousculés. La police et la milice ont peu réagi, laissant le peuple exprimer sa juste indignation.
Alors que la nation pleure, une question se pose : qui succédera à Ismael Idi Amar ? Celui-ci n’a pas nommé d’héritier, mais un nom revient dans les esprits : Jakamé Idi Akim, Ministre de la Propagande et cousin du défunt dirigeant.
Posté le : 07 mai 2025 à 16:56:16
Modifié le : 07 mai 2025 à 16:57:07
1923
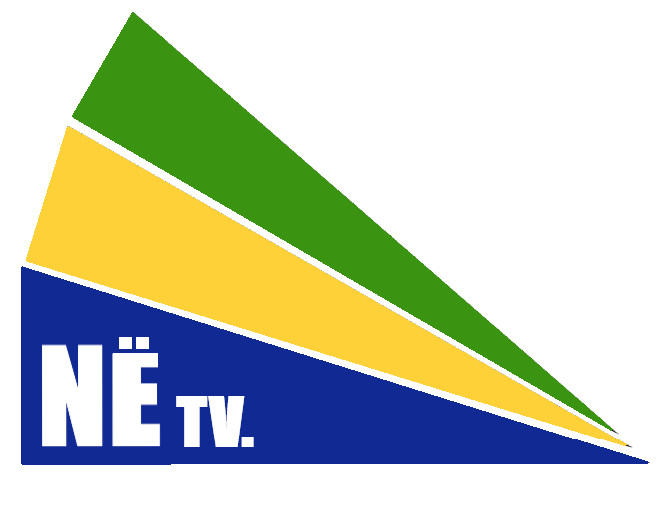
Un symbole est tombé.
Le chef suprême de la Fédération centrale démocratique d’Antegrad est mort, assassiné par le dictateur ouwanlindais Ateh Olinga. Un missile de haute technologie a eu raison du dirigeant anterien. Notre président, Monsieur Dima Contolo, a prononcé un discours dans lequel il a annoncé son soutien à la Fédération d’Antegrad ainsi qu’à la famille d’Ismaël Idi Amar. La presse anterienne a rapporté que plusieurs dizaines de civils auraient péri lors de cette attaque, mais très peu d’informations circulent à ce sujet.
Suite à cet événement, la situation en Antegrad s’est rapidement détériorée. De violentes manifestations anti-ouwanlindaises ont eu lieu, et l’ambassadeur ouwanlindais a été contraint de quitter le pays. Antegrad a également imposé différentes sanctions à l’encontre de l’Ouwanlinda, sans toutefois préciser s’il y aurait une réponse militaire.
En Ëdango, de nombreuses manifestations de soutien ont été organisées, et des hommages ont eu lieu dans plusieurs villes du pays en mémoire du dirigeant assassiné.
La droite ëdangoise s’est réunie pour demander une minute de silence à l’Assemblée, mais la gauche a dénoncé une "collaboration et une manipulation", qualifiant le défunt dirigeant anterien de "tyran qui méritait la mort", affirmant qu’Antegrad avait en réalité été à l’origine du conflit.
À l’international, plusieurs pays ont annoncé leur soutien à Antegrad, tels que la Némédie, le Slaviensk, l’Azur, la Sylva, la Rimaurie… Cependant, certains de ces pays ont tout de même critiqué une précédente frappe anterienne, même si celle-ci visait uniquement une installation militaire.
Jima Fredon, ministre des Affaires étrangères, et Fatima Cako, ministre de l’Intérieur, se sont entretenus avec l’Assemblée et ont convenu de sanctions à l’encontre de l’Ouwanlinda.
Voici ces sanctions :
-Aucun navire ouwanlindais ne pourra entrer dans les ports ëdangois jusqu’à nouvel ordre.
-L’importation de produits ouwanlindais est désormais interdite jusqu’à nouvel ordre.
-L’exportation de produits vers l’Ouwanlinda est également interdite jusqu’à nouvel ordre.
Posté le : 19 mai 2025 à 12:37:38
6413
Alors que le Président mène la farce qu'il nomme « élection présidentielle », affectant une indifférence totale à l'inquiétude du peuple dans ce moment crucial, les Ouwanlindais, eux, s'interrogent sur la cohérence et le bien-fondé du dictateur Olinga. Assassiner Idi Amar, vraiment ? Si justice devait bien être faite pour nos quarante soldats péris sur la base militaire de la province nord, frappée par un bombardement antegrain, on se demande si la réponse a véritablement été ajustée. Car contrairement à ce que certains officiels ouwanlindais ont pu dire, s'en prendre à la personne d'un chef d'Etat représente un affront très considérable, d'autant que c'est également le symbole du pouvoir antegrain, le palais présidentiel, et des dizaines de ses occupants qui ont été visés par le missile Stéphane dirigé contre le rival de toujours. Quand les patriotards imbéciles se réjouissent d'une telle claque infligée à l'adversaire, ceux qui s'intéressent véritablement non seulement à la santé de l'Ouwanlinda, mais à ce continent Afarée dont Olinga prétend être le défenseur peuvent légitimement se sentir affligés. Car d'une telle frappe n'a pu naître que l'évidente conséquence de voir se dresser contre l'Ouwanlinda un nombre croissant de pays. Alors que la préoccupation afaréenne agite de plus en plus le continent, comme l'indique la tenue d'un sommet récent à Mpanga, au Dgondu, le Président Olinga s'illustre comme un trouble-fête et un diviseur. Sa politique outrageante l'isole à présent de partenaires afaréens authentiques. Dans le même temps, les preuves d'affection de pays lointains et franchement peu concernés par la paix afaréenne pleuvent. On a les amis qu'on mérite...
« Je réitère mon appel à l'apaisement », dit sans ironie aucune celui que de l'Antegrad à la Némédie, en passant par le Gondo, l'Azur, le Finejouri et bien d'autres, l'on voit clairement comme le responsable d'une escalade dangereuse et l'auteur d'un crime particulier dans les relations internationales ; celui d'avoir délibérément visé un bâtiment civil, des dirigeants civils, et d'avoir infligé, en sus de destructions considérables sur un édifice public symbolisant la nation fédérale d'Antegrad, un camouflet ressemblant fort à un pavillon rouge ; ce pavillon qu'hissaient les pirates des temps anciens pour signifier : pas de quartier, guerre à outrance. Une déclaration qui ressemblerait fort à l'attitude bravache du Président Olinga, manifestée seulement au printemps dernier non pas à l'Antegrad mais à la Clovanie, dont les forces tiennent le Gondo sous sa férule. Il disait à l'époque : « Les clovaniens veulent rester ? Qu'ils restent ! [...] Tant qu'ils ne seront pas partis, voilà ce que je prévois: un missile par semaine sur l'une de leurs installations, jusqu'à ce qu'ils acceptent de se retirer entièrement ! » On a vu ce qu'on devait voir : calme total depuis mai. Si un missile a décollé des mystérieux arsenaux balistiques de notre pays où l'aide internationale est nécessaire pour avoir de l'eau potable, ce n'a pas été pour frapper la Clovanie, qui se gausse ; ni certainement pas aucun autre Etat colonial, alors que deux d'entre eux jouxtent nos frontières ; non, le bijou de technologie loduarienne a été dédié à l'extermination du président fédéral de l'Antegrad... C'était vraiment bien la peine !!
La dernière actualité en date a été la prise de parole du Ministre du Respect (sans commentaire... n.d.a.) qui, s'exprimant au nom du Président (mais cette fois en son absence), a tenu un discours mêlant des apostrophes à l'adversaire (« Là où des Idi Amar ont conquis le pouvoir par la peur, Ateh, lui, l'a conquis par l'instauration de la paix entre les ethnies... » un humaniste en somme ! qui choisit seul ses sosies et règne depuis son Conseil de Guerre) autant que des approches étonnamment modérées. Barnabas a en effet tenu des positions bien moins maximalistes, et bien plus policées, que celles auxquelles l'inénarrable Soleil de la Nation nous a habitué. Répondant à la demande d'un groupe de pays afaréens, qui se limitait (!) à « obtenir les excuses officielles d'Ateh Olinga », le porte-serviette et première nounou des crocodiles présidentiels a formulé la condition de son maître : « des excuses au nom des quarante ouwanlindais assassinés sur notre sol par l'aviation antégrine. » Une excuse pour une excuse : le Président Olinga a-t-il soudain été frappé par la grâce ? Il semble hélas que non, sa logique s'inscrivant dans ce qui caractérise l'attitude revancharde à partir de laquelle naissent toutes les escalades : « c'était cet homme désormais six pieds sous terre qui était responsable de tout ceci, et il n'y a aujourd'hui plus de raison à la dispute. » L'Antegrad est prié d'en accepter le prix.
Si cette position pourrait se défendre sur un marché aux bovins, elle semble cependant éloignée de la réalité des rapports entre Etats. Il semble impensable que l'Antegrad tende l'autre joue après une telle agression ; mais cela, Olinga le croit-il seulement ? Certains arguent que oui, comme Emile Zaananmutsa, psychiatre à Opango : « on pourrait dire en un certain sens que le Président n'a pas les idées claires sur la situation », affirme-t-il prudemment. Interrogé sur les conséquences qu'il en tirait, le prudent médecin refuse de s'avancer : « les cas cliniques sont fréquents parmi les hommes politiques », mais il reconnaît que « de toute évidence, le Président devrait être examiné. » « Ses attitudes témoignent d'un rapport assez borderline à la réalité. Mais c'est souvent le génie des mégalomanes que de convaincre les autres de la fiction qu'ils se racontent à eux-mêmes. »
D'autres considèrent qu'Ateh Olinga, loin de s'illusionner sur l'effet propice au calme de son attitude irrévérencieuse à l'égard des pratiques diplomatiques normales, sait parfaitement que sa demande n'a aucune chance d'aboutir. Loin de chercher l'apaisement, il vise un autre but, qui serait à rechercher du côté de ses relations avec certains pays pourtant très éloignés de la volonté panafaréiste initiale. C'est ce qui devrait inquiéter tous les Ouwanlindais : quel destin est-il réservé à un peuple qui dévoue sa direction à un tel personnage ? Vers où nous emmène Olinga par cette crise ? La vraie question est la suivante : qui, en Ouwanlinda dictatorial, peut seulement obtenir la réponse à cette question, sauf les alligators blasés qui dorment près de l'eau tiède du bassin ?
Posté le : 21 mai 2025 à 12:17:13
Modifié le : 21 mai 2025 à 12:17:36
5969
Le Courrier de Tidiane
La crise Ateh-Antegrad perturbe le nouveau Diwan azuréen

Le battement d'ailes d'un papillon peut-il déclencher un typhon ? Les philosophes s'interrogent sur cette question depuis la nuit des temps. Peu prompts à invoquer le hasard pour expliquer le cours des choses, ils s'en remettent à deux formes d'explications ; l'immanence des phénomènes divins, et puis, à partir de la modernité, la causalité infinie dont notre réalité n'est qu'une conséquence logique et implacable, en mouvement perpétuel.
La causalité, voilà un sujet de dissertation pour les observateurs de l'actuel quiproquo secret au sommet de l'Etat azuréen. D'après nos informations, révélées ici en exclusivité, un petit grain de sable ouwanlindais semble s'être glissé dans la mécanique bien huilée du Califat constitutionnel, au point d'en enrayer le processus de désignation du nouveau gouvernement. Investi la semaine dernière par le XVIIème Congrès de la formation politique au pouvoir, le Parti de la Renaissance Islamique, le réformateur Jamal al-Dîn al-Afaghani avait déjoué les obstacles pour s'imposer et être désigné Grand Vizir. Nommé par le Calife, l'ancien Ministre des Affaires étrangères est chargé de mettre sur pied une nouvelle équipe gouvernementale, afin de constituer un nouveau Diwan capable de gouverner le pays, selon une feuille de route cohérente qui devrait être prononcée à l'occasion de son discours de politique générale devant le Sérail.
Grâce à des sources fiables qui préfèrent demeurer anonymes, nous avons pu obtenir la confirmation que les discussions en cours entre réformateurs et conservateurs pour former un gouvernement uni et stable achoppent actuellement sur la désignation du successeur d'Afaghani au portefeuille de la diplomatie. Un temps mise en avant pour imprimer la marque décisivement anti-impérialiste de la diplomatie afaghanienne, l'actuelle ambassadrice d'Azur à Axis Mundi, Houria Ben-el-Telja, serait en train de voir son profil mis en cause par les délégués de la Nahda. Plusieurs facteurs seraient en cause, notamment son appartenance au courant gauchisant du Parti, hérité de son passage au Parti des Travailleurs Azuréens (P.T.A., d'obédience communiste) mais surtout de sa familiarité avec le Grand-Kah. Partenaire essentiel du Califat pour la fourniture de ses armes de dissuasion et la résolution du conflit gondolais, les Communes-Unies ont cependant adopté un communiqué sur la crise ouwanlindaise qui a fait l'effet d'une douche aux officiels azuréens. Soupçonnée de favoriser une solution contraire aux intérêts du pays, Madame Ben-el-Telja a été placée sur le banc de touche lors des journées de huis clos dédiées à l'examen des profils ministrables, la Commission des Affaires étrangères lui préférant le haut-diplomate, Amir Bey il-ir Usdeli, qui assure l'intérim aux "AE" et qui pourrait donc voir son contrat provisoire reconverti en poste à plein temps au sein du nouveau gouvernement.
"Les autorités azuréennes ont été pétrifiées" par le bombardement du palais présidentiel de l'Antegrad, le 27 juin dernier, et le décès du président fédéral Ismael Idi Amar dans l'explosion. "Du jour au lendemain, l'Ouwanlinda a montré qu'il pouvait frapper n'importe qui, n'importe où en Afarée", n'hésitant pas à cibler, au-delà de troupes clovaniennes au Gondo qui ont l'hostilité unanime des pays afaréens, un voisin et rival puissant dans cette partie du continent. "Les déclarations d'Olinga ont suscité frayeur et colère", commente une source, "car le président ouwanlindais ne semble impressionné par aucune dissuasion". "Face à un tel tempérament, l'Azur réalise que sa propre approche de la question militaire, basée sur la dissuasion, est caduque". L'Ouwanlinda se targue en effet d'ignorer les demandes d'excuses qui lui ont été faites, et de dicter ses conditions pour la résolution de la crise. "Au sein de la Nahda, il y a unanimité pour agir". Ni les réformateurs, ni les conservateurs ne sauraient en effet tolérer l'existence d'une menace permanente de la part d'un voisin afaréen doté d'armes supersoniques, menace qui pèserait non pas seulement sur les sites militaires, mais aussi sur les édifices publics et sur la personne même du chef de l'Etat. "Les oulémas ont forcément interprété qu'en cas de désaccord avec l'Ouwanlinda, une frappe similaire pourrait viser le Calife". D'où un rejet absolu de cette pratique et des conditions ouwanlindaises pour la résolution de la crise.
Une telle unanimité aurait pourtant dû renforcer le nouveau vizirat, dopé par sa stature internationale et son engagement sur les questions afaréennes qui en font un interlocuteur en vue de prochaines négociations diplomatiques. C'était sans compter le dernier communiqué émis par le Grand Kah, à travers le Commissariat à la Paix. Par ce long texte, les autorités d'Axis Mundi ont intimé aux alliés de l'Antegrad l'ordre de "réinstaurer un embargo militaire strict et équitable à l'encontre des deux nations", ciblant donc l'Antegrad, victime placée sur un pied d'équivalence avec son agresseur, et se posent en médiateurs : "nous sommes convaincus que notre position, exempte d'intérêts partisans directs dans ce conflit spécifique, et notre attachement aux principes d'équité et de justice, pourraient offrir un cadre propice à des négociations constructives entre les deux parties."
"Les Azuréens sont en colère contre le Grand Kah", résume notre source, "dont la posture diverge clairement avec celle de l'Azur et d'autres pays afaréens". "Le Califat aurait pourtant consenti à la vision kah-tanaise sur le dossier du Gondo." "Même Afaghani ne souhaite pas reproduire cela pour l'Ouwanlinda. Cette fois, la question est trop grave, car elle peut impliquer la sécurité même du territoire azuréen". Et de résumer ainsi : "Afaghani n'a ni l'intention ni l'autorisation d'agir autrement qu'en adoptant une position extrêmement ferme à l'égard de l'Ouwanlinda et de ses éventuels partenaires". Ce qui expliquerait le scepticisme soudain cristallisé sur la personne de Houria Ben-el-Telja, jugée "trop kah-tanaise", alors qu'Usdeli "assure le job". Selon nos dernières informations, le Grand Vizir chercherait néanmoins à convaincre les parlementaires d'accorder leur confiance à l'ambassadrice. Les discussions semblent toujours patiner. Pour l'Azur, c'est un enjeu de taille ; rien de moins que le choix de l'incarnation de la politique extérieure.
Les ruines fumantes du palais antegrain dégagent encore une fumée mêlée de poussière et de grains de sables. L'un d'entre eux semble s'être envolé jusqu'en Azur au point de bloquer la désignation du prochain ministre de la diplomatie, et donc l'annonce du nouveau gouvernement. Belle performance, pour celui qui n'était jusqu'alors qu'un pittoresque dictateur amateur d'alligators !

La causalité, voilà un sujet de dissertation pour les observateurs de l'actuel quiproquo secret au sommet de l'Etat azuréen. D'après nos informations, révélées ici en exclusivité, un petit grain de sable ouwanlindais semble s'être glissé dans la mécanique bien huilée du Califat constitutionnel, au point d'en enrayer le processus de désignation du nouveau gouvernement. Investi la semaine dernière par le XVIIème Congrès de la formation politique au pouvoir, le Parti de la Renaissance Islamique, le réformateur Jamal al-Dîn al-Afaghani avait déjoué les obstacles pour s'imposer et être désigné Grand Vizir. Nommé par le Calife, l'ancien Ministre des Affaires étrangères est chargé de mettre sur pied une nouvelle équipe gouvernementale, afin de constituer un nouveau Diwan capable de gouverner le pays, selon une feuille de route cohérente qui devrait être prononcée à l'occasion de son discours de politique générale devant le Sérail.
Grâce à des sources fiables qui préfèrent demeurer anonymes, nous avons pu obtenir la confirmation que les discussions en cours entre réformateurs et conservateurs pour former un gouvernement uni et stable achoppent actuellement sur la désignation du successeur d'Afaghani au portefeuille de la diplomatie. Un temps mise en avant pour imprimer la marque décisivement anti-impérialiste de la diplomatie afaghanienne, l'actuelle ambassadrice d'Azur à Axis Mundi, Houria Ben-el-Telja, serait en train de voir son profil mis en cause par les délégués de la Nahda. Plusieurs facteurs seraient en cause, notamment son appartenance au courant gauchisant du Parti, hérité de son passage au Parti des Travailleurs Azuréens (P.T.A., d'obédience communiste) mais surtout de sa familiarité avec le Grand-Kah. Partenaire essentiel du Califat pour la fourniture de ses armes de dissuasion et la résolution du conflit gondolais, les Communes-Unies ont cependant adopté un communiqué sur la crise ouwanlindaise qui a fait l'effet d'une douche aux officiels azuréens. Soupçonnée de favoriser une solution contraire aux intérêts du pays, Madame Ben-el-Telja a été placée sur le banc de touche lors des journées de huis clos dédiées à l'examen des profils ministrables, la Commission des Affaires étrangères lui préférant le haut-diplomate, Amir Bey il-ir Usdeli, qui assure l'intérim aux "AE" et qui pourrait donc voir son contrat provisoire reconverti en poste à plein temps au sein du nouveau gouvernement.
"Les autorités azuréennes ont été pétrifiées" par le bombardement du palais présidentiel de l'Antegrad, le 27 juin dernier, et le décès du président fédéral Ismael Idi Amar dans l'explosion. "Du jour au lendemain, l'Ouwanlinda a montré qu'il pouvait frapper n'importe qui, n'importe où en Afarée", n'hésitant pas à cibler, au-delà de troupes clovaniennes au Gondo qui ont l'hostilité unanime des pays afaréens, un voisin et rival puissant dans cette partie du continent. "Les déclarations d'Olinga ont suscité frayeur et colère", commente une source, "car le président ouwanlindais ne semble impressionné par aucune dissuasion". "Face à un tel tempérament, l'Azur réalise que sa propre approche de la question militaire, basée sur la dissuasion, est caduque". L'Ouwanlinda se targue en effet d'ignorer les demandes d'excuses qui lui ont été faites, et de dicter ses conditions pour la résolution de la crise. "Au sein de la Nahda, il y a unanimité pour agir". Ni les réformateurs, ni les conservateurs ne sauraient en effet tolérer l'existence d'une menace permanente de la part d'un voisin afaréen doté d'armes supersoniques, menace qui pèserait non pas seulement sur les sites militaires, mais aussi sur les édifices publics et sur la personne même du chef de l'Etat. "Les oulémas ont forcément interprété qu'en cas de désaccord avec l'Ouwanlinda, une frappe similaire pourrait viser le Calife". D'où un rejet absolu de cette pratique et des conditions ouwanlindaises pour la résolution de la crise.
Une telle unanimité aurait pourtant dû renforcer le nouveau vizirat, dopé par sa stature internationale et son engagement sur les questions afaréennes qui en font un interlocuteur en vue de prochaines négociations diplomatiques. C'était sans compter le dernier communiqué émis par le Grand Kah, à travers le Commissariat à la Paix. Par ce long texte, les autorités d'Axis Mundi ont intimé aux alliés de l'Antegrad l'ordre de "réinstaurer un embargo militaire strict et équitable à l'encontre des deux nations", ciblant donc l'Antegrad, victime placée sur un pied d'équivalence avec son agresseur, et se posent en médiateurs : "nous sommes convaincus que notre position, exempte d'intérêts partisans directs dans ce conflit spécifique, et notre attachement aux principes d'équité et de justice, pourraient offrir un cadre propice à des négociations constructives entre les deux parties."
"Les Azuréens sont en colère contre le Grand Kah", résume notre source, "dont la posture diverge clairement avec celle de l'Azur et d'autres pays afaréens". "Le Califat aurait pourtant consenti à la vision kah-tanaise sur le dossier du Gondo." "Même Afaghani ne souhaite pas reproduire cela pour l'Ouwanlinda. Cette fois, la question est trop grave, car elle peut impliquer la sécurité même du territoire azuréen". Et de résumer ainsi : "Afaghani n'a ni l'intention ni l'autorisation d'agir autrement qu'en adoptant une position extrêmement ferme à l'égard de l'Ouwanlinda et de ses éventuels partenaires". Ce qui expliquerait le scepticisme soudain cristallisé sur la personne de Houria Ben-el-Telja, jugée "trop kah-tanaise", alors qu'Usdeli "assure le job". Selon nos dernières informations, le Grand Vizir chercherait néanmoins à convaincre les parlementaires d'accorder leur confiance à l'ambassadrice. Les discussions semblent toujours patiner. Pour l'Azur, c'est un enjeu de taille ; rien de moins que le choix de l'incarnation de la politique extérieure.
Les ruines fumantes du palais antegrain dégagent encore une fumée mêlée de poussière et de grains de sables. L'un d'entre eux semble s'être envolé jusqu'en Azur au point de bloquer la désignation du prochain ministre de la diplomatie, et donc l'annonce du nouveau gouvernement. Belle performance, pour celui qui n'était jusqu'alors qu'un pittoresque dictateur amateur d'alligators !
