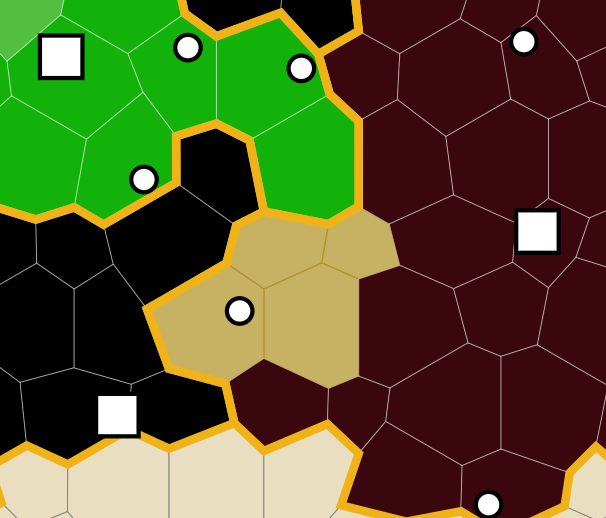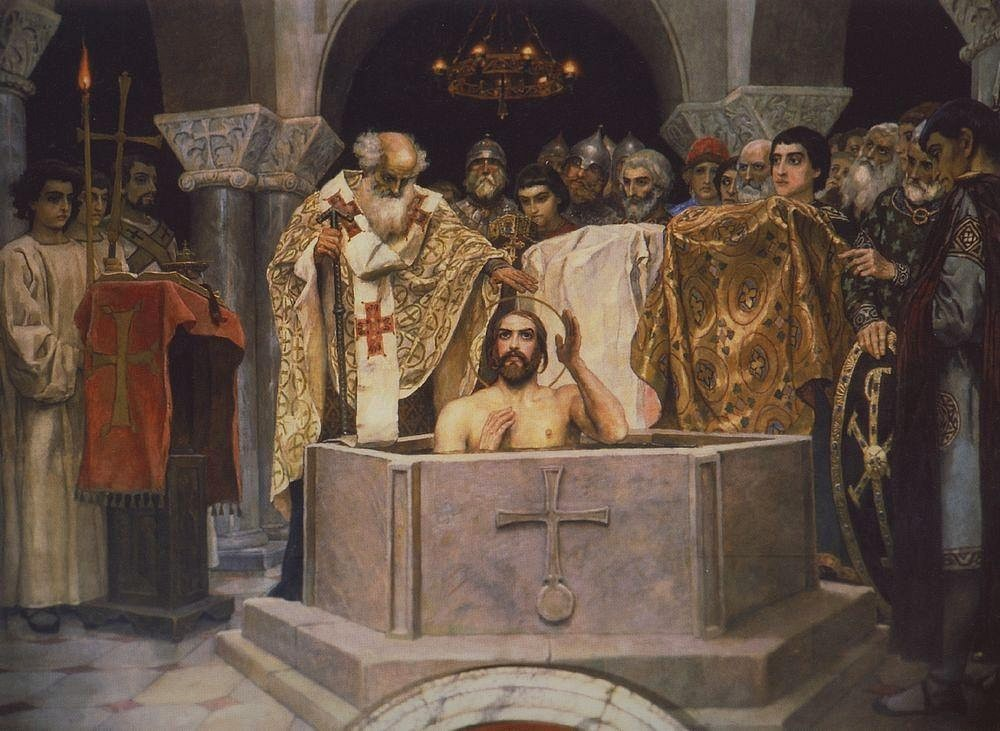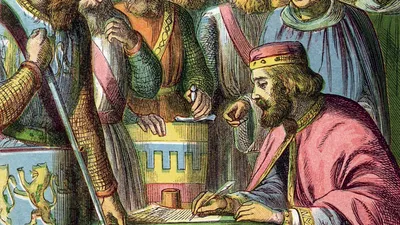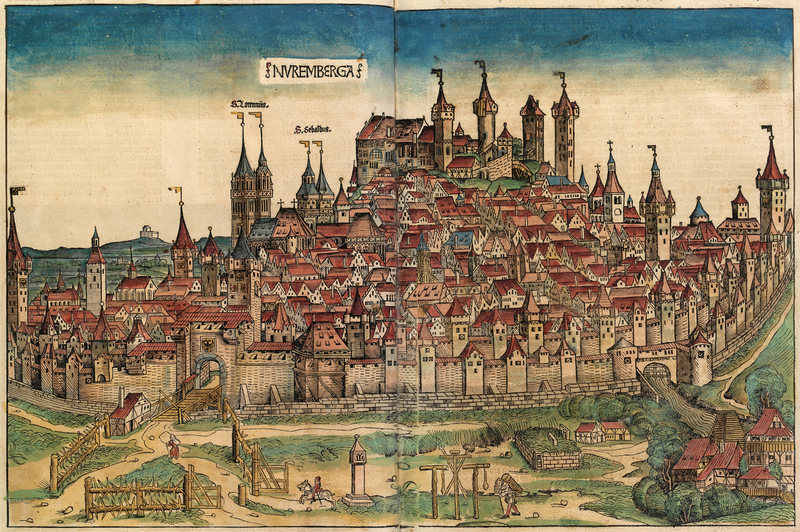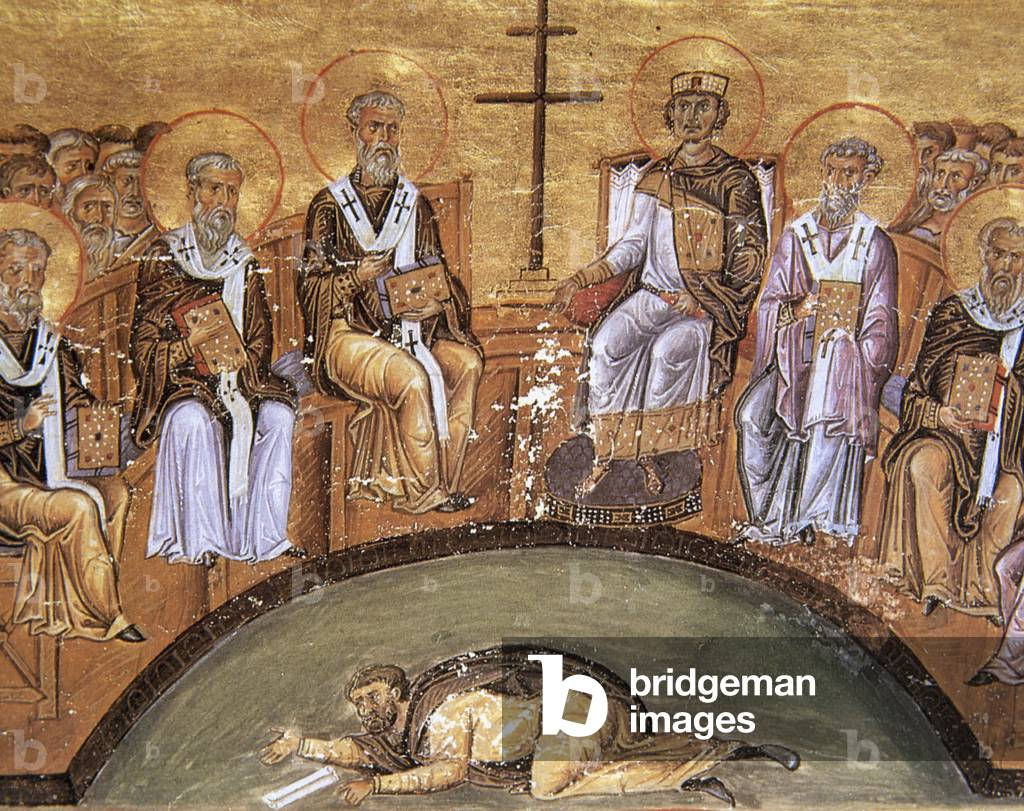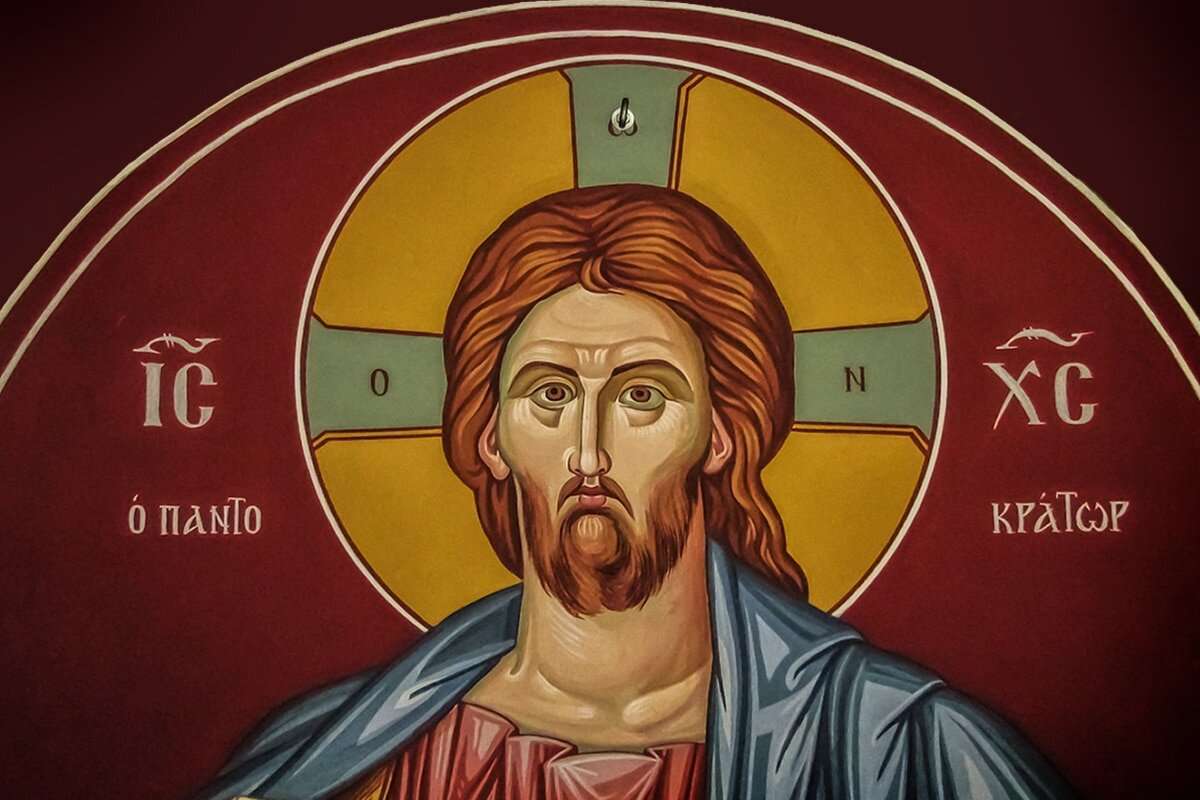Ici sera répertorié l'ensemble des articles, résumés et extraits des ouvrages de l'Université de Mistohir en charge d'assurer la documentation historique de la nation estalienne par la réunion des archives, preuves archéologiques et récits/écrits historiques ainsi que l'ensemble du travail de la frange historienne estalienne et étrangère sur l'Estalie depuis sa fondation. L'ensemble des sources de la section Histoire de l'Encyclopédie sont issus des travaux des historiens de l'Université de Mistohir par défaut, les travaux des autres universités estaliennes sont accréditées sous le nom de celle de Mistohir compte tenu de la réglementation du 17 Août 1965 sur la centralisation de la documentation historique et de la fonction professionnelle des historiens.
Sommaire :
Annexes :