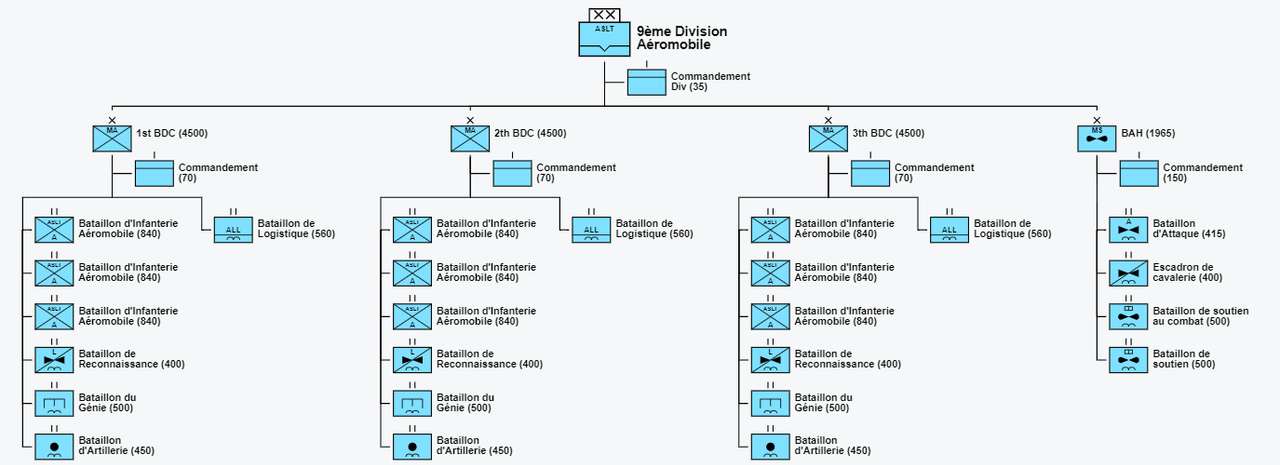Annonces, mesures et documents de la Commission à la Guerre
Posté le : 04 jui. 2024 à 18:32:58
696

Posté le : 07 jui. 2024 à 02:34:17
44139

Que demande la Révolution pour être victorieuse ? Une force de travail, une armée puissante et une ferveur révolutionnaire en acier. Il est évident que si la Révolution doit s'étendre, elle doit se faire par les armes que ce soit par les peuples eux-mêmes opprimés soit par nous-mêmes lorsque nos confrères ont étés endoctrinés par la fièvre capitaliste qui infecte l'esprit des Hommes et les poussent à se battre pour des causes qui non seulement les dépassent mais qu'ils ne comprennent que peu au fond. Ce n'est pas notre cas : chaque soldat de la Révolution, chaque frère et chaque sœur assimile parfaitement la cause pour laquelle il se bat. Il est conscient de pourquoi il se bat et pour qui tandis que l’esclave, l’enfant intellectuel opprimé par le capitalisme, croit se battre pour une idée qu’il a vaguement appréhendé et qui le pousse à se sacrifier pour une cause qui ne bénéficie ni à lui-même ni à sa propre famille. On croit mourir pour sa patrie, on meurt pour des industriels. Chaque soldat de la Révolution est conscient qu’il se bat pour son espèce, pour le bien-être de l’ensemble de l’Humanité même en constatant que ses confrères ont été endoctrinés. C’est pour cela que nous rechignons à l’idée d’une patrie ou d’une nation : ces concepts mènent à la guerre éternelle entre les peuples pour l’accaparement des ressources, les nations fonctionnant comme des entreprises concurrentes, se faisant la guerre pour stimuler leur économie au mépris de la vie humaine. La dernière des guerres que nous devrons mener à la force de nos bras et au prix de notre sang doit mettre fin à cet état de fait.
Organiser le recrutement et l’encadrement de l’Armée Rouge :
Commençons par le plus simple : les effectifs. Le recrutement des volontaires est une composante essentielle à une structure professionnelle saine de l’armée, surtout quand vous prétendez à une armée de composition mixte entre des troupes professionnelles dont le cœur de métier est le combat et la guerre et avec des forces conscrites mobilisées parmi les jeunes hommes civils, dans la force de l’âge, qui sont alors envoyés au combat pour lutter pour la Révolution d’une part et assurer le fonctionnement de composantes militaires qui auraient du mal à fonctionner en temps normal avec seulement des professionnels volontaires pour faire marcher lesdites composantes comme la logistique, la maintenance, la reconnaissance, le financement ou encore l’administration dont toutes ces composantes sont généralement tenus par des professionnels civils, recrutés au sein du système de conscription justement pour leurs qualifications civiles qui sont loin d’être facultatives, même à l’armée. Tout d’abord, l’Armée Rouge va mettre en place le Bureau de Recrutement des Forces Armées (BRFA), une nouvelle administration militaire chargée de doter l’Armée Rouge en effectifs sur l’ensemble du territoire de la Fédération. Le BRFA s’organise autour d’un quartier général de division et d’une brigade de recrutement composés de conscrits uniquement ainsi qu’une brigade de recrutement médical. Pour le moment, près de 800 fonctionnaires affiliés à l’Armée Rouge (généralement des blessés de guerre, volontaires ou recalés pour des conditions physiques ainsi que des proches de militaires qui ne souhaitent pas s’engager ou encore des militaires qui cherchent une reconversion dans le civil en restant proche de l’armée) seront affectés au service mais à terme, l’Armée Rouge compte composer les dites brigades uniquement de conscrits ayant des compétences administratives et persuasives convaincantes. Le quartier du BRFA se situe à Mistohir, devant servir de commandement logistique et stratégique pour l’ensemble de l’administration. Au total, rien que dans le quartier général, près de 200 personnes incluant des militaires enrôlés et des fonctionnaires civils doivent être inclus dans le quartier général de l’administration de recrutement. Le quartier général lui-même est divisé en 14 sections d’état-major devant chacun gérer une composante du travail de recrutement pour faciliter la charge de travail et l'efficacité à tâche unique de l’administration : administration, personnel, gestion des ressources, sécurité, études et analyses de marché, relations publiques, propagande et soutien aux opérations publiques des militaires de l’Armée Rouge. On compte également deux brigades de recrutement qui constituent la majorité du personnel du BRFA et qui constituent le cœur du métier de l’administration : le recrutement. Chaque brigade se charge d’une partie du territoire fédéral (divisée en fonction des régions) répartis en bataillons de recrutement dispersés à la fois dans les villes et dans les communes qui agissent tous comme des circonscriptions militaires individuelles, le tout devant économiser au mieux les effectifs des services de recrutement tout en assurant une efficacité complète sur la plus large zone géographique possible. Il existe également une brigade médicale dont les effectifs sont inclus au sein de l’administration des autres brigades de recrutement, le personnel de cette brigade est pour le moment composé de civils spécialisés dans le domaine médical et assisté par des conscrits qui doivent informer sur les procédures militaires plus que médicales. Cette brigade répond non pas au quartier général même si c’est ce dernier qui gère la brigade médicale mais les personnes recrutées par la brigade doivent passer par une commission mixte incluant à la fois des membres de l’administration du BRFA mais également des membres de l’école de médecine militaire.
Néanmoins, le plus important réside dans le fait d’intégrer un maximum d’effectifs dans les unités combattantes en ce qui concerne les forces volontaires et professionnelles. En effet, un recruteur derrière un bureau en plus est un militaire en moins sur le champ de bataille. Il faut donc établir des initiatives dans le but de recruter efficacement un grand nombre de volontaires dans un temps limité, un système qui puisse permettre à la Fédération de recruter facilement beaucoup de volontaires en peu de temps. Pour cela, nous devons revoir directement le service de conscription et rendre ce dernier un peu plus sélectif. Après tout, nous avons l’embarras du choix avec une telle population de 36 millions d'âmes, la main d'œuvre n’est pas un problème mais la qualité de celle-ci l’est énormément en revanche. Le service militaire obligatoire sera donc rétabli (ce dernier avait été aboli en 1995 par le gouvernement libéral) et étendu à douze mois au minimum et près de quinze mois pour les unités de première ligne, notamment les forces expéditionnaires aux missions principalement offensives. De même, s’il est possible d’intégrer l’Armée Rouge dès 16 ans, le délai d’appel des conscrits sera ajusté entre 21 et 35 ans. Une application de la conscription par ordre de volontariat s’appliquera au sein des conscrits ; recrutant en premier lieu les plus motivés, un tel programme universel devant améliorer largement la disponibilité de conscrits très motivés, permettant ainsi une allocation des ressources de l’Armée Rouge basée sur les compétences et les aptitudes à un degré d’étude maximal et non motivé par le simple envoi en première ligne. Près de de deux millions d’unitas seront investis dans la mise en place d’équipes de suivis civils au sein des regroupements de jeunes (dans les lycées notamment une fois ceux-ci remis en place) pour repérer les jeunes les plus motivés à effectuer une carrière militaire ainsi que les plus aptes physiquement pour les choisir en priorité lors des sélections du service militaire. Ainsi, lorsque le conscrit sera appelé sous les drapeaux, ce dernier sera directement incorporé dans l’unité la plus appropriée à sa condition physique et ses compétences liées à sa formation civile. Cette systématisation de l’intronisation des compétences civiles, notamment universitaires et post-universitaires étant donné l’âge des conscrits, combiné à une durée de service militaire long, fournit à l’Armée Rouge un avantage qualitatif de ses forces engagées car l’utilisation de conscrits ayant dans la vingtaine ou la trentaine bien éduqués et formés dans un cadre civil devient aujourd’hui un impératif à l’efficacité des opérations inter-domaines (c’est-à-dire la complexité croissante des affrontements armés qui nécessite elle-même une certaine expertise des mobilisés pour répondre et s’adapter au mieux aux innovations sur le terrain) et à la modernisation progressive de nos forces armées ainsi que des opérations en back-office (logistique, finance, entreposage, gestion du matériel, etc.).
Au-delà de la législation de notre gouvernement sur le service militaire et sur ses dispositions légales, nous devons également chercher des méthodes qui pourraient grandement faciliter le recrutement de volontaires au sein de l’Armée Rouge. Heureusement, le contexte socio-économique actuel est assez propice au recrutement militaire. On remarque en effet que la plupart du temps, la propension des jeunes à s’engager dans les forces armées réside en premier lieu dans la publicité militaire d’une part et d’autre part dû à une série de facteurs environnementaux comme le taux d’emploi des jeunes, la proportion de la population jeune par rapport à la population totale, le niveau de connaissances historiques et militaires des jeunes, l’attitude culturelle, l’apprentissage idéologique des populations, le prestige lié à l’armée que ce soit en terme de parcours professionnel ou de choix de carrière, l’attractivité de la rémunération, les avantages militaires donnés aux jeunes par rapport à la poursuite dans les études ou encore les contacts récurrents avec des militaires. Ici, les facteurs sont réunis en grande partie : un taux de chômage assez élevé chez les jeunes suite à la Révolution (même si cette situation changera certainement définitivement d'ici la fin du premier trimestre de 2014, le temps que les premières grandes mesures économiques de la Fédération se mettent en place et s'entérinent dans la société estalienne), l’Armée Rouge est populaire de fait de part son rôle de premier instrument de la Révolution et de la glorification volontaire du sacrifice des soldats révolutionnaires face à la pègre capitaliste, la rémunération des militaires est plutôt attrayante en cette période de reconstruction. Ainsi, étant donné que ces facteurs sont acquis ou presque, il ne manque qu’à établir une campagne de publicité adéquate pour inciter à l’engagement. Le but de la publicité militaire est de diffuser des informations conçues pour influencer l’activité des consommateurs sur un marché. Dans le cas spécifique de l’armée, la publicité militaire est basée sur le même concept que la publicité civile. En revanche, là où la propagande se différencie du domaine civil, c’est que la cible est engagée à travers des valeurs morales, derrière un slogan attachant et touchant principalement sur la corde sensible humaniste, révolutionnaire auquel l’Armée Rouge tente de s'attacher. Ainsi, au lieu de se centrer sur les besoins de l’individu, on se base sur l’idéologie dominante de la Fédération et sur les valeurs collectives. Ainsi, la publicité militaire révolutionnaire se basera sur l’invention d’un mythe de la quête du bonheur collectif par la libération du monde de l’infection capitaliste et fasciste, l’initiation au travail d’équipe et à l’initiative de commandement, l’exaltation de l’héroïsme révolutionnaire au combat ; les valeurs collectives et socialistes sont également mises en avant ainsi que l’exposition d’une menace pesante sur l’Humanité et sur le principe de la liberté par les capitalistes et les fascistes, une rhétorique anti-libérale violente ou encore une perspective de surpasser les actes déjà hautement glorieux des militants révolutionnaires ayant lutté autrefois.

Ainsi, l’armée se doit d’être un employeur aux aspects différents et surtout mystérieux (plus l’armée est intrigante, plus elle est attirante) car oui, l’armée est une aventure avant tout. De même, l’armée doit inclure dans sa publicité militaire des valeurs comme la vertu (dans un sens collectif, pour inclure l’idée que l’engagement est un devoir pour soi mais aussi pour les autres, comme si la recrue se sentait investie du devoir de protéger ses frères d’armes et tous les habitants des contrées qu’il traversera), le devoir envers le reste de l’Humanité, le service auprès des autres (l’Armée Rouge doit être vue comme une armée soutenant ses concitoyens, les protégeant mais aidant également aux travaux collectifs qui doivent faciliter la vie quotidienne de la population et exposer les fières valeurs d’altruisme et d’humanisme), l’héroïsme (à travers le sacrifice de l’individu au profit de l’Humanité et de part le caractère romantique de la guerre qui est vu non pas comme une abomination moderne mais comme une nécessité d’unification de l’ensemble de la planète, le soldat écrivant l’Histoire sur le marbre à travers son effort et ses souffrances), le sacrifice de soi et pour les autres. Ainsi, la publicité militaire révolutionnaire se focalisera sur la mise en place de prospects et l’élaboration de plans permettant le suivi de pistes qui doivent mener au ciblage et au listage de potentielles recrues auquel il faudra fixer des convocations pour inciter la cible à s’engager volontairement en insistant sur l’aspect volontaire et le consentement de la recrue qui doit se retrouver moralement contraint de signer son contrat pour le bien de ses proches (sans proférer de menaces, en jouant plutôt sur la culpabilité des recrues à ne pas s’engager dans l’armée et donc participer aux souffrances de ses proches). Ces convocations qui peuvent être à domicile, au centre de recrutement ou dans les lieux de travail (éducatif comme professionnel) doivent donc être un outil de persuasion d’une part pour inciter les plus réticents à presser le pas dans leur recrutement et d’autre part pour dresser une évaluation préliminaire sur la qualification de l’individu (âge, éducation, condition physique, antécédents médicaux, casier judiciaire, etc.). Notez que l’Armée Rouge est capable de rendre le casier judiciaire de ses troupes complètement vierge après un service de trois ans sous les drapeaux. De même, chaque candidat dispose de son propre recruteur attitré, le but étant de créer une proximité relationnelle entre le recruteur et le candidat pour inciter la recrue à s’engager. Enfin, il a également été décidé d’instituer une journée obligatoire de cours militaire et historique tous les 15 du mois. Cette journée obligatoire pour les moins de 25 ans doit servir d’introduction aux jeunes vers la carrière militaire. Ici, le discours des recruteurs est agressif : décadence barbare des capitalistes, des bourgeois et des fascistes, nécessité de défendre la Révolution, menaces de l’individualisme égoïste, crimes de guerre capitalistes contre l’Humanité, héroïsme des révolutionnaires d’autrefois et actuels. Tout doit être fait pour qu’avant la fin de la journée, les jeunes soient trempés dans une attitude martiale vengeresse. Ainsi, pour ceux qui auront l’âge, l’incitation à la carrière militaire sera d’autant plus valorisée par un effet de groupe amplifié par des mises en scène martiales et musicales qui doivent favoriser un état d’esprit guerrier et révolutionnaire. Notons que cette journée sera l’introduction parfaite à la mise en place de clubs de lecture idéologique et de centres d’instruction du même type où les membres du BRFA devront cultiver la jeunesse par la récitation des exploits révolutionnaires, des différentes doctrines marxistes et de l’histoire du socialisme, par l’enseignement des valeurs collectives et le sens de la ferveur révolutionnaire permanente et du sacrifice qui doit être imbriquée dans l’esprit de la jeunesse, la jeune recrue doit être convaincue qu’il se bat non pas pour lui-même mais pour une cause plus grande, la cause de l’Humanité et de sa libération, menacée par une clique bourgeoise avide de pouvoir, sont des objectifs communs qui se doivent d’être défendues, au prix le plus cher qui soit : le sang du peuple qui se défend lui-même contre la vermine libérale, capitaliste, bourgeoise et nationaliste, le tout dans une mise en contexte paranoïaque dans laquelle chaque compère un peu trop hésitant peut alors être considéré potentiellement comme un traître. Il est aussi à noter que le recrutement de l’Armée Rouge ne s’arrête nullement aux frontières effectives de la Fédération car si la Fédération doit bien pouvoir recruter efficacement dans les zones qu’elle contrôle déjà, elle est ouverte à tous les volontaires internationaux ayant la ferveur révolutionnaire nécessaire pour rejoindre la grande lutte socialiste contre le capitalisme oligarchique. C’est pourquoi le BRFA disposera de cellules multilinguistiques qui devront permettre le recrutement de personnes venant du monde entier. Ces cellules auront une fonction double : celle de traduire auprès des recrues et de vérifier les antécédents possibles des recrues. De fait, les recrues internationales sont ensuite placées dans des unités à part des troupes issues de la Fédération pour permettre une surveillance du SRR sur ces mêmes recrues d’une part et surtout les regrouper selon les zones linguistiques. De fait, dans l’Armée Rouge, celle-ci est définitivement mondiale et donc elle est multilinguistique. Or, comme l’a démontré tous les empires autrefois, une armée multilinguistique mine l’efficacité de celle-ci sur le champ de bataille. C’est pourquoi l’entraînement initial des forces professionnelles comme conscrites contient l’apprentissage de l’espéranto, une langue véhiculaire très simple à apprendre (même plus simple à apprendre que l’anglais ; il est possible d’apprendre cette langue en quelques mois voire en quelques semaines pour les plus doués) à volonté internationale qui doit agir comme un lien de connexion entre les officiers et sous-officiers (qui apprennent cette langue durant leur formation directement) et leurs troupes venues du monde entier. Cette solution résout le problème de la barrière de la langue et les officiers sont aussi encouragés à apprendre la langue des bataillons qu’ils commandent. Car même si tous les soldats apprennent à parler l’espéranto, ils resteront néanmoins dans des unités avec une seule langue afin de faciliter la connexion entre les soldats en cas d’absence de leurs officiers.
De surcroît, pour l’Armée Rouge et son état-major, en temps de paix, les armées se doivent de respecter deux occupations majeures : l’entraînement et la préparation au combat. La préparation au combat se déroule en deux phases pour l’Armée : la première étape consiste en la préparation théorique du combattant, que ce soit l’endoctrinement idéologique, l’organisation au combat, la connaissance du matériel et de l’équipement sur le terrain et son utilisation théorique et enfin l’instruction de la troupe à travers les dangers qu’elle pourrait rencontrer et les situations auxquelles elle serait confrontée en combat réel, le tout devant donner une idée théorique solide aux soldats qui savent mentalement ce qui a à faire, imbriqué directement dans l’inconscient collectif des soldats ; la seconde étape réside dans l’exécution en condition réelle puis l’évaluation des troupes. La préparation comprend donc une éducation académique et une éducation politique mais aussi les alertes, les menaces, l’entretien, le matériel, les exercices de préparation et les inspections générales des services d’évaluation de l’Armée Rouge. D’autres domaines sont directement compris séparément de cette formation militaire comme les services médicaux (à ne pas confondre avec les premiers soins que chaque soldat doit aussi connaître et appliquer lors des exercices), l’administration, la logistique ou la maintenance. Quant à l’entraînement en lui-même, il se catégorise en deux points : la formation de base doit développer principalement les compétences individuelles et collectives spécifiques à leur mission ainsi que des manoeuvres militaires dans lesquelles les unités évoluent dans des scénarios de combat simulés avec d’autres unités extérieures à l’organisation et l’objectif différent, le tout devant évaluer la polyvalence des forces et l'adaptabilité des unités face à différents types de menaces. Ainsi, le processus d’entraînement débute par une évaluation des compétences nécessaires à l’exercice et utilise plusieurs formats de formations : instruction, démonstration, observation, pratique, exercice. Le tout devant ensuite atteindre le niveau de qualification souhaité et fixé par l’état-major de l’Armée Rouge. La formation suit donc par étapes dans l’objectif que chaque étape spécifique de ladite formation puisse être analysée, comprise et étudiée par l’administration et les officiers supérieurs de l’Armée Rouge qui doit pouvoir en tirer des conclusions complètes qui puissent permettre l’amélioration et l’adaptation de l’entraînement des forces révolutionnaires en temps de paix à des situations réelles en temps de guerre. L’entraînement régulier des forces de combat de l’Armée Rouge réside en trois mois d’entraînement intensif durant six mois où sont menées principalement les opérations pratiques comme les exercices à grande échelle dans lesquels l’Armée Rouge expérimente de nouveaux modèles tactiques et conditionnent ses forces à des situations de combat réel. L’entraînement en lui-même des nouveaux arrivants consiste en une échelle progressive (en mal, bien sûr). Ainsi, le premier jour, on reste laxiste avec les nouvelles recrues : on fournit l’uniforme aux recrues, les familles accompagnent la recrue jusqu’au point de ralliement des recrues qui les amènent ensuite à la caserne, on décore la poitrine des recrues avec une rose, on fait prêter serment à la troupe envers la Révolution et l’Humanité, les instructeurs militaires restent relativement cordiaux en apprenant des chants militaires aux recrues sur le trajet et la nourriture est de bonne qualité. Au deuxième jour, la formation commence officiellement : les lits doivent être faits de manière impeccable sous peine de jeter le lit par la fenêtre, la recrue n’aura qu’à dormir par terre pour son insolence ; ils pratiquent leur posture (savoir comment se tenir debout, marcher au pas, courir en ligne droite, se retourner de manière chronométrée et millimétrée. On demande souvent aux soldats de rester debout, sans bouger, durant plusieurs heures d’affilée. Chaque jour, les soldats doivent courir près de cinq kilomètres, ceux n’y arrivant pas étant sévèrement punis. Avant de dormir (du moins si l’unité est autorisée à le faire), les recrues sont invités à faire des pompes, squats et ceux durant plusieurs heures, parfois au bon milieu de la nuit, réveillé par la douce musique de l’arme de poing du sergent qui tire dans le dortoir des recrues pour faire bouger la bleusaille. D’autres entraînements comprennent également la descente en rappel, les tractions, la course à fond sur trois kilomètres, des courses pondérées entre trois et cinq kilomètres, des courses d’obstacles sur 400 mètres, la marche pondérée sur de longues distances, la pratique d’arts martiaux pour le combat au corps à corps ainsi que l’entraînement aux armes à feu. Au-delà de ce petit cortège d’activités sympathiques, les conditions de vie sont charmantes : privation de sommeil (deux à trois heures de sommeil en général), brutalité (les instructeurs sont brutaux et sans pitié, quitte à infliger des blessures aux recrues, même s’il leur est interdit de pratiquer des blessures qui seraient incapacitantes à l’entraînement de la recrue ; ça reste marrant de mettre des chaussettes sales pleines d’urine dans la bouche de ses collègues pendant deux bonnes heures), pression psychologique (alertes constantes, brutalité sommaire, éloignement des recrues de leur lieu de vie habituel). En bref, durant six mois, ce sera l’horreur. Durant les trois premiers mois de la formation, les recrues seront surtout conditionnées physiquement dans leur nouvel environnement en éprouvant ces derniers physiquement pour améliorer leur condition physique de départ et ainsi disposer de la meilleure performance humaine que pourrait fournir les hommes ; les trois mois suivants sont consacrés à des formations plus proches du monde militaire : maniement des différentes armes, tactiques de combat, compétences géographiques, maintenance et entretien, cohésion d’équipe. Les conditions de vie des recrues s’améliorent par rapport aux trois premiers mois, la privation de sommeil est moindre et la brutalité se raréfie mais la formation reste sévère et la tolérance envers les erreurs des recrues reste quasi nulle ; en effet, il est nécessaire que les soldats restent concentrés à l’apprentissage théorique des tactiques et du maniement et de l’entretien des armes, on n’étudie pas un domaine avec trois heures de sommeil au compteur.
Académies militaires et plans de mobilisation :
La réforme des forces armées passe tout d'abord par l'éducation des forces professionnelles. Par conséquent, la Commission à la Guerre doit créer un cadre éducatif suffisamment solide et organisé pour former les militaires professionnels et les cadres de l'Armée Rouge, sachant bien que ceux actuellement sous les drapeaux n'y resteront pas éternellement, notamment les sous-officiers nécessitant une véritable formation tactique pour permettre une gestion tactique et à petite échelle suffisamment cohérente et organisée à l'échelle tactique, l'état-major révolutionnaire ne dissimulant même plus son souhait de décentraliser en partie le commandement des forces armées pour permettre une plus grande initiative des officiers sur le terrain tout en suivant un plan stratégique plus global, ce qui est une nécessité vitale dans le contexte actuel de l'Armée Rouge qui a besoin que les initiatives locales menées par les officiers locaux puissent ralentir l'adversaire jusqu'à l'intervention de renforts plus conséquents pour neutraliser la menace ; étant donné la superficie très grande et la période de reconstruction des infrastructures, il est évidemment nécessaire que des zones isolées soient capables de contenir au moins les assauts initiaux de forces hostiles. L'éducation dans l'Armée Rouge doit être une priorité : l'Université de la Défense Nationale de Mistohir (renommée l’Académie Militaire Révolutionnaire pour l’occasion) sera réouverte pour fournir un cadre éducatif adéquat aux officiers des forces armées ; le Centre de Formation des Officiers Généraux sera également temporairement mis en place dans l'ancienne Ecole Militaire de Pendrovac pour former les officiers, expérimentés ou non, à l'utilisation des nouvelles innovations doctrinales et matérielles de la guerre. Néanmoins, au fil du temps, les écoles militaires estaliennes doivent faire partie définitivement d'un réseau éducatif militaire solide mis en place par le gouvernement fédéral par la remise en service de l'Académie des sciences militaires de l'Armée Rouge située là aussi à Mistohir, comprenant plusieurs départements d'études : école de médecine militaire, école d'ingénierie militaire, école des infirmières militaires, école de l'état-major, l'école de formation technique des officiers de l'ingénierie, etc. Le gouvernement va poursuivre dans cette initiative en poursuivant la création du système éducatif militaire révolutionnaire en ouvrant d'autres instituts d'études militaires. De même, le gouvernement va ouvrir l'école d'hygiène militaire, l'école des officiers des services militaires, l'école d'enseignement général des forces armées et l'école de parachutisme, le tout sera basé dans d'anciennes universités civiles à Mistohir et les villes alentour. De même, le gouvernement fédéral devra ordonner la création d'une unique académie de formation d'officiers de réserve à Fransoviac pour permettre la pleine centralisation de la formation et l'uniformisation de l'apprentissage des officiers de la réserve dans un unique cursus tout en réduisant les frais d'entretien du système éducatif militaire. Enfin, notons aussi l’ouverture de l'université de l'aviation navale de la marine de l'Armée Rouge qui sera réformée pour devenir une université navale principalement, le but étant de former les futurs officiers de la marine révolutionnaire (la Fédération anticipe, compte tenu de son devoir international, de devoir avoir un jour le besoin d'acquérir une marine un jour) pour disposer des meilleurs éléments marins une fois les premiers navires de guerre mis en service.
La conscription est également revue ainsi que le plan de mobilisation. En effet, l'Armée Rouge ne dispose pas d'un plan de mobilisation militaire en cas de conflit. Le gouvernement fédéral estime que la situation actuelle n'est pas suffisamment adaptée aux objectifs gouvernementaux et aux aléas économiques qui accompagnent les mobilisations de nos camarades socialistes qui affectent forcément l'économie du pays. En effet, il est possible que la Fédération se retrouve à se mettre en alerte mais de manière partielle et non totale. De même, le gouvernement estime que la conscription doit revenir à un statut plus strict, le nombre de citoyens mobilisables de la Fédération étant possiblement moins important par rapport à ses voisins, chaque camarade effectuant son service militaire doit être en capacité de combattre efficacement sur le champ de bataille, d'avoir les notions de base et d'être d'une qualité irréprochable par rapport aux soldats des pays voisins en plus faible nombre. Ainsi, l'Armée Rouge fait d'une pierre deux coups par la mise en place d'une force numériquement très supérieure composée de conscrits et de soldats professionnels expérimentés et souvent rompus aux tactiques de combat.

Tout d'abord, le plan de mobilisation de cette année annoncera dans les grandes lignes la création des régions militaires et les centres de ralliement des unités de conscrits en cas de conflit pour permettre l'organisation cohérente et organisée des conscrits une fois la mobilisation amorcée et pour permettre le commandement construit des unité conscrits qui doivent être capable de combattre dès la mobilisation terminée. Le tout en instaurant un nouveau système d'alerte conforme à une mobilisation partielle ou totale. En effet, l'état-major institue trois états d'alerte : vert, orange et rouge. Ces derniers sont alors définis et changés soit par la Commission à la Guerre soit par le Président de la Fédération lui-même. L'alerte verte n'indique rien de spécial et est conforme à une situation de paix politique et sociale tant au niveau intérieur qu'extérieur, l'armée fonctionne sur son cycle régulier et normal en incorporant les conscrits selon la réglementation en vigueur.
L'alerte orange désigne une période de vigilance accrue que ce soit dû à des troubles intérieurs politiques ou sociaux ou à une menace extérieure. Dans ce cas-ci, les réservistes et anciens conscrits sont priés, via des feuilles d'appel distribuées par la police, de rejoindre leurs unités de ralliement dans les délais indiqués par leurs feuilles d'appel (en général dans les 48 heures). Dans les zones de première ligne (c'est-à-dire les zones frontières et côtières), cette période est définie comme immédiate, c'est-à-dire que l'appelé doit répondre à son devoir dans les quatre prochaines heures. L'aller-retour dans les transports pour les appelés est gratuit et pris en charge par l'État socialiste. L'alerte orange comprend deux phases de mobilisation : la première phase rappelle l'ensemble des réservistes de moins de 41 ans ; la seconde phase rappelle l'ensemble des réservistes ayant entre 41 et 45 ans et les anciens conscrits de moins de 30 ans. Le reste des réservistes et conscrits (donc les réservistes de plus de 45 ans et les anciens conscrits de moins de 30 ans) ne sont pas concernés par l'alerte orange.
Enfin, l'alerte rouge indique un état de guerre immédiat ou réel. Dans cette situation, la même procédure est appliquée que dans l'alerte orange, à la différence qu'il n'existe qu'une seule phase de recrutement et que l'ensemble des personnes aptes au service militaire sont appelés à porter les armes pour protéger la Fédération.
En ce qui concerne la conscription, de nouvelles vagues de conscrits seront appelées progressivement tous les deux mois pour remplacer les conscrits ayant terminé leur service militaire. Néanmoins, compte tenu de l'économie actuelle du pays nécessitant une grande disponibilité des civils à l'économie socialiste, il est probable que le service militaire comprend une autre réforme d'ici les prochains mois ou dans les années qui suivent comprenant notamment une réduction du service militaire et la possible revue du rôle des femmes dans l'Armée Rouge.
La Garde Populaire :
La Garde Populaire constitue la réserve principale de la Fédération des Peuples Estaliens au niveau professionnel et réactif. En effet, au-delà de la conscription qui remplit une partie des effectifs de l’armée active et permanente, on retrouve toute une marge de la population, que ce soit d’anciens conscrits ou de volontaires ne souhaitant pas faire leur service militaire, qui est incluse dans ce qu’on appelle la Garde Populaire (dont le fonctionnement au sens organisationnel dans les villes a déjà été expliqué) qui est une force armée publique sous le contrôle des villes et qui doit assurer plusieurs missions. Tout d’abord, la Garde Populaire agit comme une police lourdement armée sur le territoire fédéral : si une situation devient incontrôlable pour les moyens à la disposition des forces de police des villes ou des communes, c’est à la Garde Populaire d’assurer l’ordre public afin de préserver la paix sociale et de faire face aux insurrections potentielles. Ainsi, la Garde Populaire est chargée de protéger les autorités publiques, les assemblées des villes et communes, les installations stratégiques et essentielles au bon fonctionnement du pays, les entreprises et installations publiques importantes et les moyens de communication. La Garde Populaire peut également participer à quadriller une zone que ce soit sur le territoire fédéral ou même de manière limitée dans des interventions à l’étranger dans le but de sécuriser les arrières des forces professionnelles qui jouent le rôle de fer de lance plutôt au sein des premières lignes. En cas d’état de guerre, la Garde Populaire et ses membres doivent se tenir prêts dans les 24 heures qui suivent leur appel à être prêts et parés au combat, la Garde Populaire jouant un rôle de sécurité intérieure en cas de guerre à l’étranger mais aussi de formations défensives en cas de guerre sur le sol fédéral. Ainsi, la Garde Populaire se doit de lutter contre les tentatives de sabotage et des opérations subversives des agences de renseignements étrangères et en cas de pénétration de forces hostiles sur le sol fédéral, la Garde Populaire agit comme un amas de forces locales défensives indépendantes qui sont là pour ralentir ou stopper la progression adverse sur le sol fédéral. Si la force hostile est bien trop imposante pour être stoppée, la Garde Populaire joue tout de même un rôle de force de guérilla sur le territoire fédéral conquis et organise la guérilla et la résistance de la population locale contre l’occupation dans l’objectif de ralentir les opérations ennemies dans la zone et donc de permettre aux forces professionnelles de reprendre la zone plus facilement. Enfin, la Garde Populaire est organisée de telle sorte à ce que dans certaines zones frontalières, certaines unités regroupent des hommes vivant au plus près des installations défensives frontalières dans l’objectif de pouvoir contrer la menace et disposer d’une défense correcte aux frontières de la Fédération en cas d’offensive étrangère. Il est à noter que ces unités ne sont pas mobilisés à temps plein, elles sont tenues par des cadres administratifs uniquement en temps de paix et par quelques observateurs en service militaire qui sont chargés d'agir comme renforts aux forces de police et à la douane en temps de paix tout en participant à la surveillance des zones à défendre ; les réservistes qui sont censés combler les rangs de ces unités en temps de guerre sont tous habilités géographiquement dans leur secteur désigné. Par conséquent, l'ensemble des réservistes de ces unités habitent à environ 20 kilomètres autour des différents points de ralliement qui servent de centres d'organisation des unités d'une part mais aussi en tant que arsenals, les unités de réservistes s'équipant dans ces points avant de partir en opération dans l'heure qui suit. Les infrastructures mises en place devraient permettre par différentes voies (fluviales, ferroviaires ou routières) aux troupes de réservistes de rallier les zones de défense en moins de trois heures. Ce court délai exige donc de fait une préparation constante des réservistes ce qui implique une limitation géographique du travail civil des réservistes (fourni généralement par des entreprises publiques ou des coopératives avec qui les villes ont conclus un accord concernant l’emploi des réservistes, qui assurent le droit à ses travailleurs de déserter leur emploi en cas d'appel aux réservistes tout en permettant aux travailleurs de conserver leur emploi après la démobilisation des réservistes), un système de sirènes mis en place dans les quartiers résidentiels pour avertir tous les réservistes et enfin une sévère limitation de déplacement, les quartiers des réservistes étant conçus pour être autosuffisants en activités économiques, en divertissement, en éducation et en services publics pour éviter toute nécessaire absence des réservistes en dehors de leurs quartiers assignés. Au-delà des quartiers assignés, à travers tout le pays, la Garde Populaire disposera d’un budget supplémantaire pour la construction d’infrastructures supplémentaires réservés à leur usage (chemins de fer, routes, ponts, aérodromes, transport fluvial ou maritime, etc.).
Chaque division, brigade ou régiment dispose de sa propre zone de défense. Les zones de défense sont les territoires approximatifs auxquels l’unité de la Garde Populaire doit protéger en priorité et auxquels il est affilié à la fois par l’emplacement de ses installations de ralliement, ses arsenaux mais également sa base de recrutement. La Garde Populaire, une fois mobilisée en temps de guerre, se place alors sous le commandement de l’état-major de l’Armée Rouge et doit donc protéger sa zone. Ainsi, ce système permet à la Fédération de protéger une zone bien précise de son territoire sans mobiliser l’entièreté des réservistes du pays et de mobiliser uniquement les unités les plus proches pour un maximum de réactivité de la part des unités de la Garde Populaire face à une menace hostile sur le sol fédéral. Etant donné que le principe premier de la Garde Populaire est de défendre en premier lieu le territoire auquel l’unité est rattachée, le fait que la base de recrutement de l’unité locale se base sur les habitants locaux, la Garde Populaire conserve l’avantage indéniable de la connaissance du terrain de la part des locaux et de la population.
Organisation interne des différentes brigades et unités de l’Armée Rouge :
Brigade d'Infanterie Motorisée :

Principale force d'infanterie mobile de l'Armée Rouge, c'est une unité polyvalente destinée à occuper le terrain, protéger les flancs des unités plus lourdes comme les troupes blindées ou mécanisées. Néanmoins, elle joue aussi un rôle offensif de par sa grande mobilité, sa polyvalence en termes d'équipements et sa composition interne qui en fait l'arme la plus polyvalente de toute l'Armée Rouge dont elle joue un rôle central. Ainsi, si l'infanterie motorisée n'a pas d'avantages tactiques importants (de part la faiblesse du blindage de ses véhicules, l'utilisation des moyens motorisés au combat rapproché est grandement risqué et hasardeux), elle a un avantage stratégique clair car elle dispose du nerf de la guerre : la mobilité. Cette dite mobilité lui permet un déplacement aisé et accru vers les points chauds du théâtre d'opérations, permettant une réponse adaptative des forces révolutionnaires face aux mouvements de l'adversaire et augmentant grandement la capacité de l'armée à déjouer les actions de l'ennemi. L'organisation interne de chaque brigade comprend :
Bataillon d'infanterie motorisée :
Le bataillon d'infanterie motorisée est divisé en plusieurs unités aux compositions elles-mêmes distinctes. Nous allons aller du plus grand au plus petit. À l'échelle bataillonnaire, on retrouve un commandement de bataillon, trois compagnies d'infanterie, une compagnie d'armes, un peloton de transmission et un peloton logistique.
Le commandement se compose très simplement de 40 hommes avec l'équipement suivant :
Rentrons plus encore dans le détail. La compagnie d'infanterie standardisée révolutionnaire est elle-même divisée en un quartier général de compagnie (celui-ci compte trois hommes en son sein (commandant de la compagnie, adjoint du commandant et un sergent-chef )), trois pelotons d'infanterie et un peloton de mortiers. Chaque peloton d'infanterie est lui-même divisé de la même façon entre le commandement du peloton (composé de deux hommes, le commandant de peloton et l'adjoint du commandant), en trois équipes d'infanterie et une équipe d'armes lourdes. Nous arrivons enfin au dernier niveau de l'échelle tactique de la compagnie d'infanterie avec l'équipe d'infanterie qui se compose donc : un chef d'escouade , deux fusiliers-mitrailleurs, cinq fusiliers et un grenadier qui joue également le rôle antichar soit un total de neuf hommes par escouade. Ainsi, cela signifie qu'en ne comptant pas les unités auxiliaires et avec les commandants, on se retrouve avec un effectif initial de 29 hommes par peloton soit 90 hommes par compagnie. Bien, mais j'ai mieux. Chaque peloton d'infanterie est également composé d'une équipe d'armes lourdes qui est composée de huit hommes : un chef d'escouade, trois fusiliers-mitrailleurs, trois assistants mitrailleurs et un grenadier. On se retrouve donc avec un effectif par peloton d'infanterie de 37 hommes soit une compagnie d'infanterie comprenant 114 hommes.
À l'échelle de la compagnie, on retrouve également un peloton de mortiers à l'organisation aussi dispersée que les compagnies avec un commandement de peloton (un commandant et son assistant), une section d'observation avancée (section, c'est un grand mot, ils sont deux observateurs) et trois sections de mortiers qui comprennent chacun deux tireurs de mortier et un leader de section. Cela nous fait un peloton comprenant douze hommes et trois porte-mortiers/obusiers/mortiers. Cela porte donc finalement l'effectif total de notre compagnie d'infanterie à 126 hommes, une jolie petite compagnie bien équipée.
Revenons désormais à l'échelle du bataillon. En plus de trois compagnies d'infanterie, on retrouve une compagnie d'armes lourdes qui comprend lui-même un commandement de compagnie, une section de mortiers, une section antiaérienne et une section antichar. Tandis que le commandement de la compagnie est composé de trois hommes (même équipement que la compagnie d'infanterie), le peloton de mortiers est également similaire (trois porte-mortiers, douze hommes), le peloton anti-aérien est composée de trois canons antiaériens soit un total de 32 hommes (30 hommes d'équipage et deux hommes au commandement) ; le peloton antichar compte un commandement de section (deux hommes), une section comprenant deux équipes antichars comprenant trois hommes chacun. Au total, la compagnie compte 52 hommes. De ce postulat, on compte donc 218 hommes dans un bataillon d'infanterie motorisée. Mais j'ai encore mieux. Un peloton de transmission comptant 14 hommes et un peloton de logistique comprenant trois sections (transport motorisé, alimentaire et médicale + le commandement) soit un total de 20 hommes et 12 camions de transport. Au total, c'est plutôt 274 hommes qui sont inclus dans chaque bataillon d'infanterie motorisée.
Reste de la brigade :
Résumons l'équipement :
C'est sous cette forme que 8000 hommes vont être intégrés dans la nouvelle 1ère Brigade Motorisée d'Infanterie dont la garnison sera basée à Mistohir.
Brigade Mécanisée :

Organisation quasiment similaire à celle de la Brigade Motorisée. Néanmoins, constatez plusieurs différences au niveau de l'équipement. D'abord, une brigade mécanisée, c'est :
Chaque bataillon d'infanterie mécanisée est divisé comme la brigade motorisée. Néanmoins, là où ça change, c'est que le bataillon du génie de la brigade regroupe ici l'ensemble des armes en dehors de l'infanterie : compagnie de transmission, compagnie du génie du combat et une compagnie antichar. L'escadron blindé comprend trois pelotons blindés, le bataillon d'artillerie est divisé en trois batteries d'artillerie mobile d'une part et une batterie antiaérienne ainsi qu'un peloton d'acquisition de cible. Enfin, le bataillon de soutien regroupe une compagnie logistique, une compagnie de maintenance et une compagnie médicale. L'équipement total de la brigade est la suivante :
Brigade Blindée :

La brigade blindée diverge un peu des autres types de brigades de part sa différence tactique. Ainsi, à la place de disposer de bataillons entièrement composés d'infanterie motorisée ou mécanisée ou de pelotons blindés, la brigade se base sur un principe d'armes combinées, utilisant à la fois le soutien de l'infanterie et le fer de lance des blindés pour percer le dispositif adverse tout en sécurisant efficacement le terrain. Ainsi, on retrouve :
Au total :
C'est sous cette organisation que les 2000 hommes restants actuellement seront actuellement organisés dans la 2eme Brigade Blindée, tous nouveaux effectifs de conscrits et de soldats professionnels devront aider à remplir les rangs de cette brigade jusqu'à qu'elle soit complète en effectifs.
Brigade de Montagne :

Identique à la brigade d'infanterie motorisée avec des équipements et une formation adaptés à la montagne :
Soit en terme d'équipements :
Posté le : 28 jui. 2024 à 19:08:36
12851
Suite à l'augmentation des effectifs de l'Armée Rouge dont les effectifs s'élèvent désormais à 17 500 hommes, conscrits et professionnels compris, il a été constaté que la 2e Brigade Blindée, originellement composée de 2000 hommes au moment de la réorganisation de l'Armée Rouge, a pu enfin combler le manque de personnel grâce aux nouveaux flux d'effectifs qui ont comblés les rangs de l'Armée Rouge. La brigade est donc au complet avec 8000 hommes en armes qui sont opérationnels et prêts au combat. Néanmoins, cela signifie aussi que 1500 hommes, nouvellement entrés dans l'Armée Rouge, n'ont aucune unité de référence et par conséquent, l'Armée Rouge a décidé de former une troisième brigade, la 3ème Brigade mécanisée, qui se basera sur les modèles et organigrammes originellement mis en place par la Commission à la Défense. Tout comme la 2ème brigade avant elle, la 3ème Brigade Mécanisée ne sera pas complète en effectifs, ne comptant que 1500 hommes sur les 8000 hommes que doivent compter normalement une brigade de ce type. Les nouveaux effectifs seront donc tout naturellement réorientés vers cette brigade une fois leur formation achevée.

Il est à noter que ces emplacement sont à titre purement indicatif des bases militaires de référence de ces brigades. Les brigades sont réparties dans toute la région, les villes citées ne sont que des références administratives. La répartition concrète des brigades sur le territoire estalien reste strictement confidentielle.
Avant d'entrer dans les formations et techniques spécifiques utilisées par un peloton mécanisé, nous devons clarifier certaines choses. Puisque le peloton fait partie d'une compagnie, il est évidemment fortement influencé par la formation et les techniques utilisées par la compagnie. Par conséquent, le chef de peloton peut recevoir l'ordre du commandant de compagnie d'utiliser une formation spécifique ou technique au sein de la compagnie. Cependant, il arrive souvent que le chef de peloton choisisse la sienne. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les formations. Ainsi, si la compagnie est dans une zone, le peloton peut être dans une formation différente au sein du même secteur. Le chef de peloton doit toujours faire savoir à son commandant et à ses collègues chefs de peloton quelle formation ils utiliseront. Les techniques de manœuvre doivent également être coordonnées tout au long de la manœuvre. Normalement, la technique utilisée par la compagnie fait que chacun des pelotons joue un rôle direct dans son exécution. Par conséquent, il n’y a pas beaucoup de liberté pour le chef de section dans l’organisation de l’Armée Rouge.
Pour le chef de peloton mécanisé, il doit prendre en considération plusieurs éléments lors de la sélection d'une formation de manœuvre. Tout d'abord, et avant tout, sa capacité à aider à accomplir le but et la tâche du peloton. Deuxièmement, sa capacité à aider à sécuriser le peloton. Troisièmement, en fonction de la situation tactique, il y a la capacité de la formation à permettre la liberté de manœuvre. Enfin, en fonction de la situation tactique, il y a la capacité de la formation à assister le chef de peloton dans le commandement et le contrôle. Compte tenu de ces considérations, le chef de peloton peut utiliser plusieurs formations. Il s'agit de la colonne, de la ligne, du coin, de l'échelon, de la bobine et du chevron. Nous les aborderons ci-dessous.
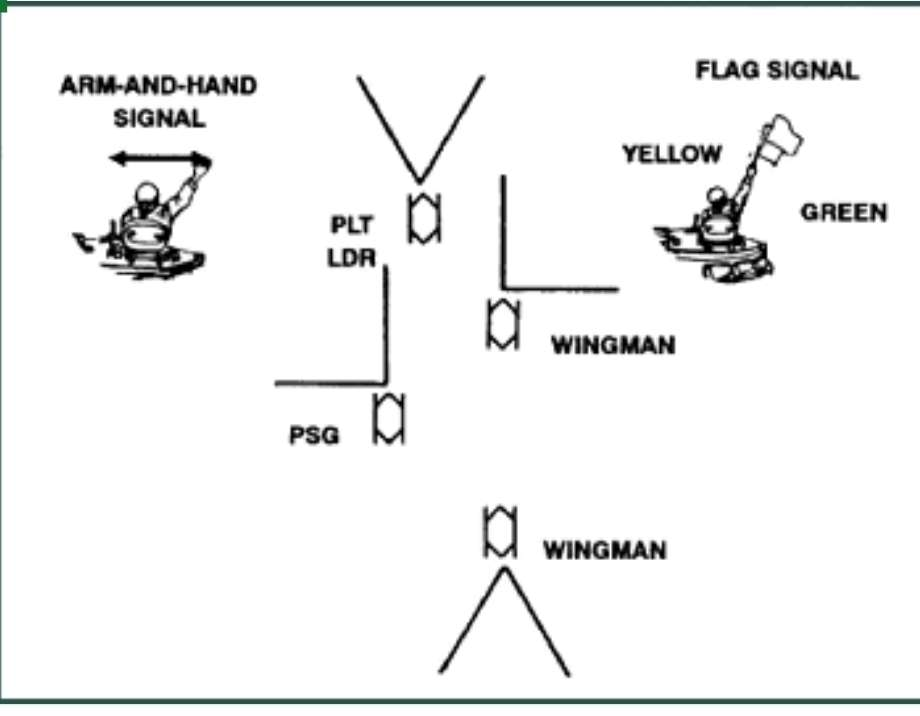
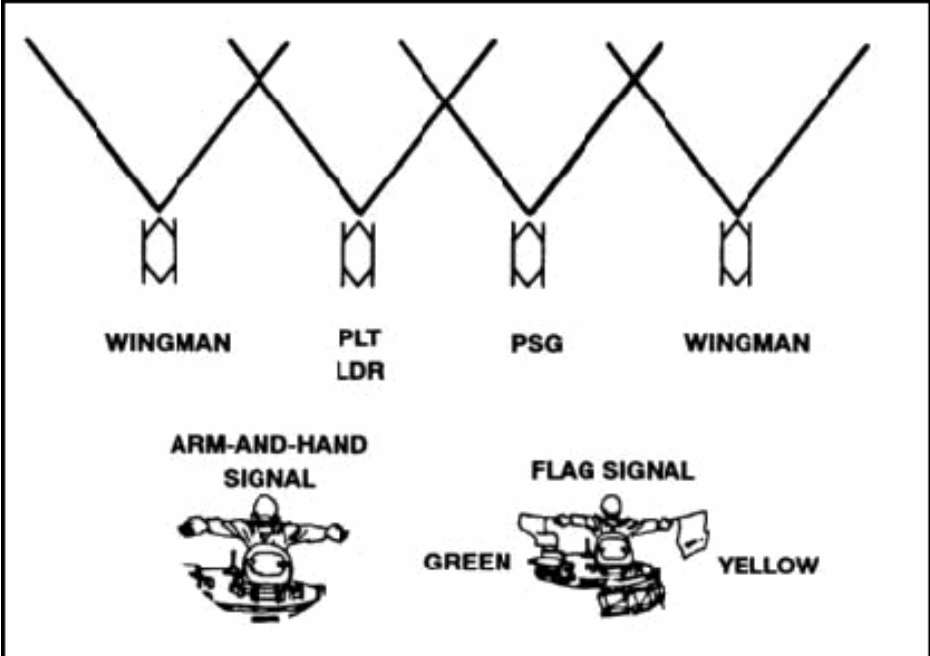
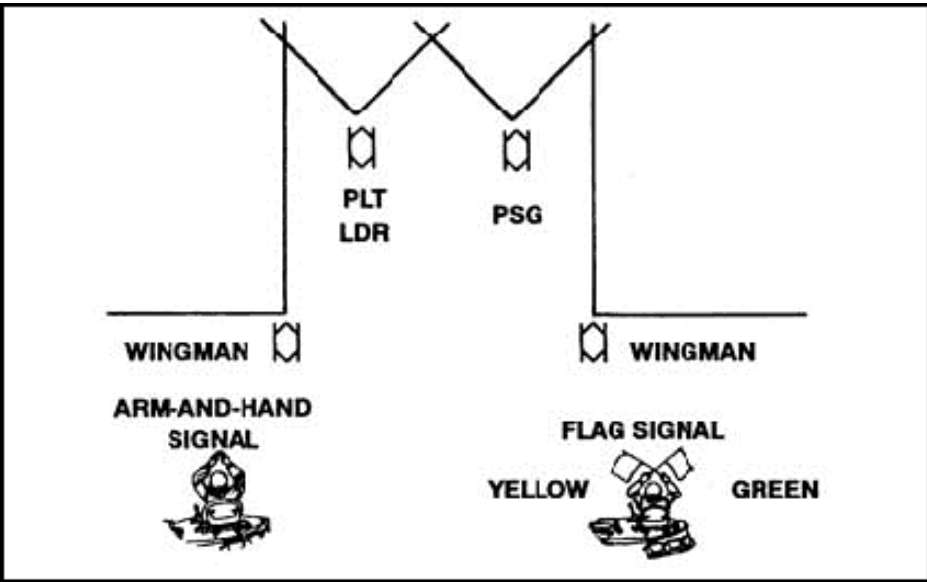
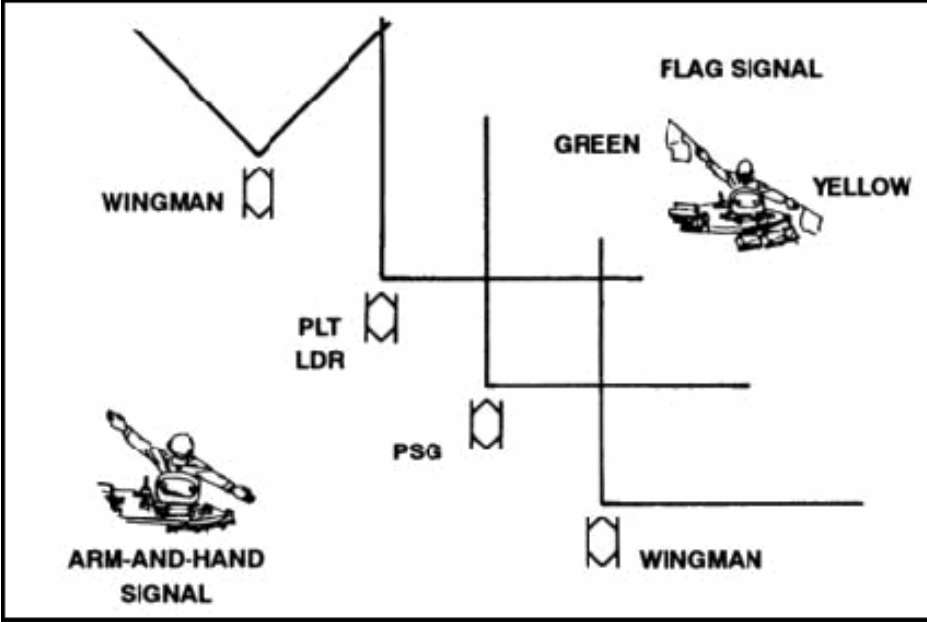
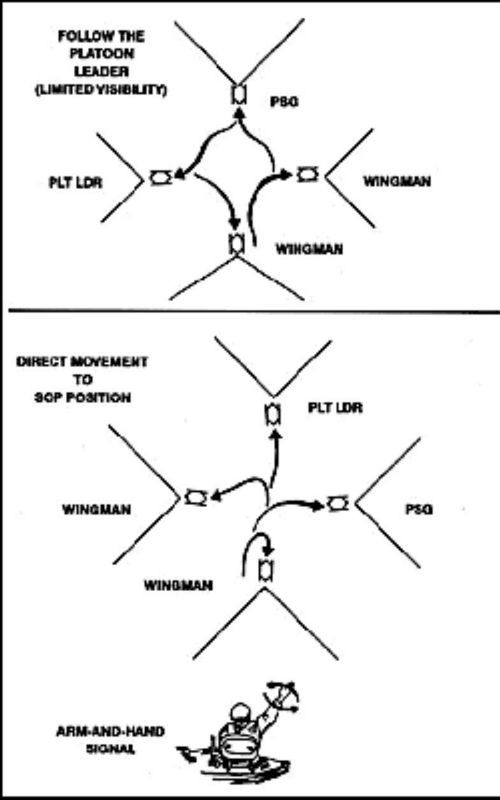
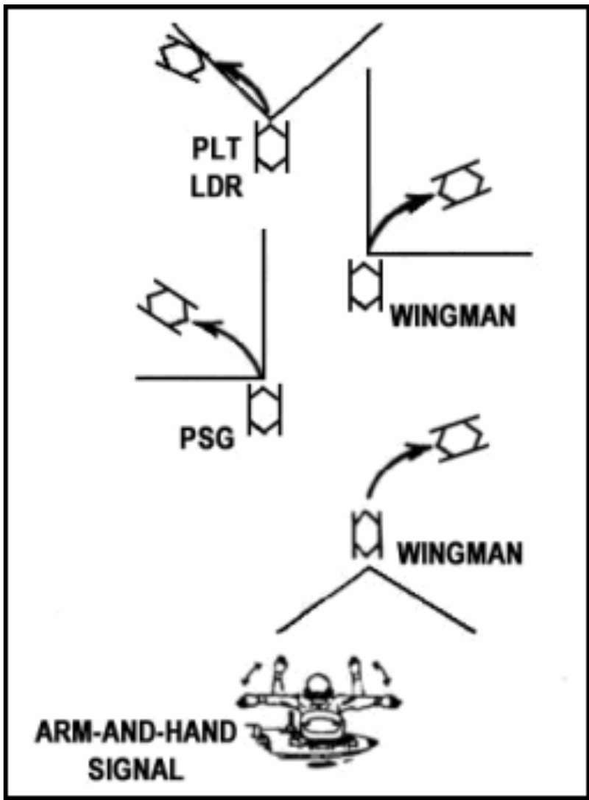
Ensuite, il existe plusieurs types de techniques de manœuvre durant les combats que les pelotons mécanisés de l’Armée Rouge peuvent appliquer, elles sont généralement trois et souvent destinés à des desseins purement offensifs.
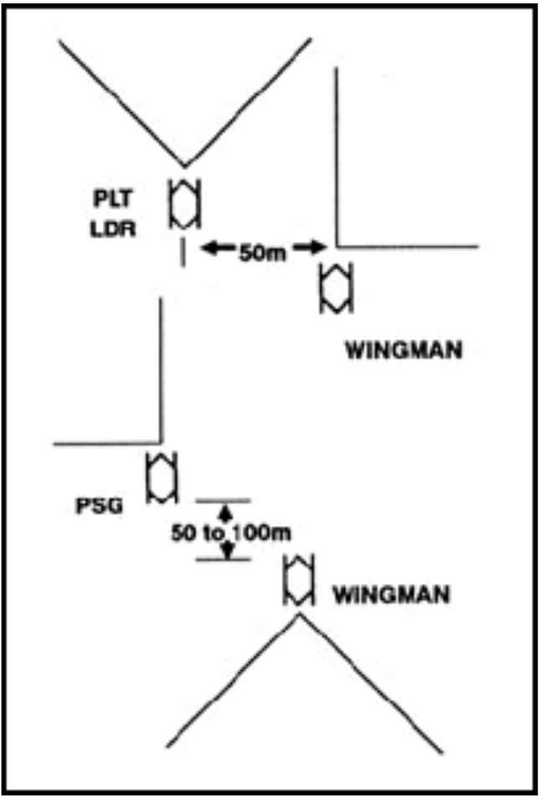
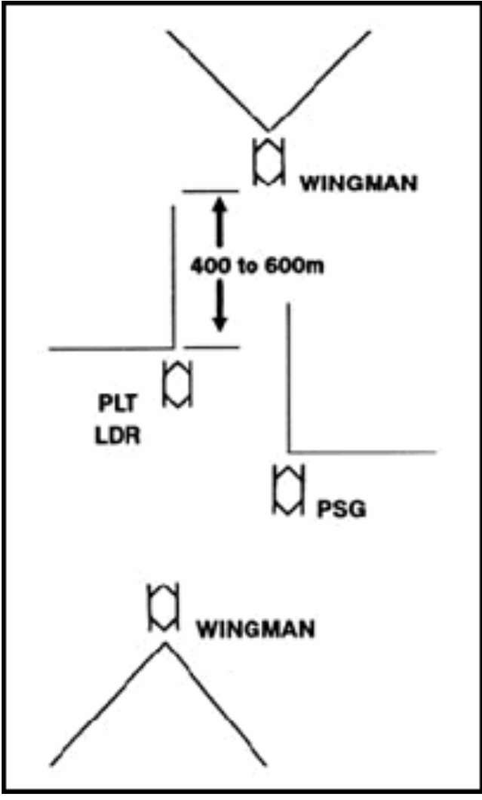
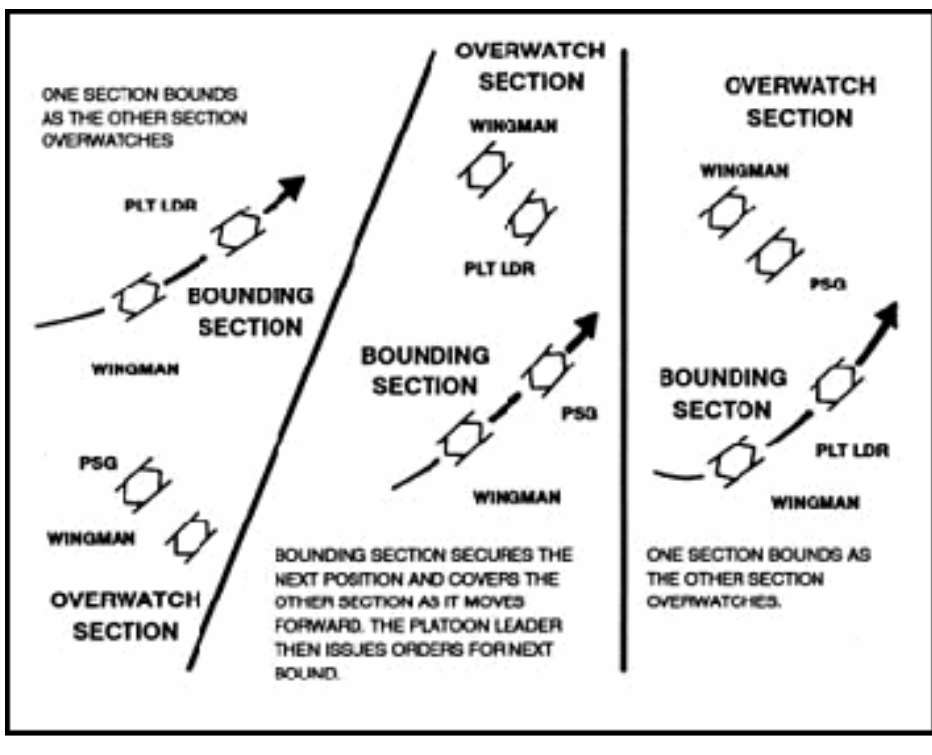
Posté le : 31 jui. 2024 à 22:00:44
13170

Exercices militaires de Mars 2014 :
A partir du 21 Mars, la Commission à la Guerre a décidé de mettre en place des exercices militaires sur les deux prochaines semaines qui suivront pour l'ensemble de l'Armée Rouge. Les exercices se focaliseront au nord du territoire fédéral et se basera sur le réseau de bases militaires des villes au nord de la Fédération afin d'assurer la logistique de l'exercice. Les exercices de Mars mobiliseront la 1ère Brigade Motorisée, la 2ème Brigade Blindée et la 3ème Brigade Mécanisée qui devront recevoir chacun des spécificités et seront organisés en fonction des compagnies en équipes bleues et rouges afin de simuler un affrontement militaire de haute intensité avec une force étrangère, tant d'un point de vue défensif qu'offensif. Le scénario de l'exercice se base sur un scénario d'attaque surprise d'une coalition de pays étrangers nommés respectivement la Kartélie, la Sitadine et l'Unionistan qui se seraient conjointement alliés afin de récupérer des parts de territoires riches en hydrocarbures situés sur le sol estalien. L'attaque surprise est sensée avoir réussi à supprimer la plupart des forces aériennes estaliennes qui ont étés cloués au sol par une succession de frapes balistiques sur les aéroports estaliens. Seules restent les troupes au sol estaliennes qui sont restées intactes et qui devront dès les premiers jours du conflit défendre les zones envahies par les trois pays avec des forces limitées.
Le but de l'exercice est assez simple : permettre aux forces estaliennes d'avoir l'expérience nécessaire pour sécuriser une position défensive en sous-nombre et entraîner les officiers de l'Armée Rouge à accroître leurs capacités de gestion afin d'utiliser des troupes qui se trouvent être peu nombreuses et utilisées avec parcimonie. L'équipe bleue regroupe les officiers les plus prometteurs d'après les qualifications formatives du système universitaire de l'Armée Rouge et comptent pour la plupart des compagnies composés de professionnels, l'équipe rouge comprend la plupart des conscrits de l'armée estalienne. La première semaine est faite pour évaluer la capacité de l'Armée Rouge à résister à une force armée plus nombreuse en position défensive. La seconde semaine sera dédiée à la contre-offensive, l'Armée Rouge devant désorganiser le dispositif adverse secoué par les défaites successives pour effectuer une contre-attaque décisive. Cet exercice sera donc grandement utile pour les forces estaliennes afin de comprendre et surtout apprendre de nouvelles tactiques qui permettraient à l'Armée Rouge d'avoir un minimum d'expérience dans les combats à haute intensité où la force numérique est à son désavantage.

La première semaine étant dédiée à l'apprentissage des combats défensifs en infériorité numérique, l'exercice devra débuter par le déploiement des troupes, l'ajustement des lignes logistiques entre les bases militaires et la ligne de front des terrains d'entraînement puis à la mise en place de tactiques de déploiement de troupes sous le feu ennemi, l'utilisation des forces spéciales comme unités de raid sur les flancs adverses ou encore l'utilisation de l'artillerie afin de ralentir ou stopper l'adversaire. L'artillerie doit pratiquer le positionnement organisé des pièces sur le champ de bataille, appliquer le déplacement organisé et courant des pièces entre les barrages d'artillerie et apprendre à mener de la contre-batterie contre l'artillerie adverse. Il est à noter que du côté de l'équipe rouge, la majorité des unités de génie seront des unités professionnelles qui devront surtout apprendre à déminer et à rompre les infrastructures défensives adverses sous un feu nourri de l'équipe bleue. Les unités de reconnaissance devront s'entraîner à s'enfoncer dans les lignes ennemies et à effectuer des sabotages dans la ligne arrière afin de briser la logistique et les lignes de communication ennemies.
La partie offensive menée cette fois par l'équipe bleue vise surtout à mettre en avant dans l'apprentissage des troupes la mobilité opérationnelle, les opérations combinées, les offensives mécanisées et l'utilisation des nouvelles technologies comme moyens de distraire l'ennemi et de rendre sa réaction plus confuse et désorganisée une fois l'offensive déclenchée. Le génie de combat des unités bleues devront à leur tour apprendre à déminer et créer des brèches sous le feu nourri ennemi afin de permettre aux véhicules blindés et mécanisés d'exploiter les brèches et prendre à revers les troupes à pied adverses. Le génie sera confronté à de nombreux obstacles, notamment géographiques, et devra redoubler d'ingéniosité pour élaborer des tactiques de couverture durant les opérations de génie comme la mise en place de pontons, le franchissement des rivières, le déminage, le dragage de mines ou la prévention (ou l'utilisation) d'agents chimiques, bactériologiques et autres durant l'offensive. Les unités de soutien logistique devront apprendre à réparer rapidement et en peu de temps les véhicules endommagés en utilisant avec parcimonie les pièces de rechange à leur disposition et en agissant par ordre de priorité. L'utilisation de systèmes avancés dans l'offensive sera aussi mis en avant : guerre électronique, cyber-guerre, opérations spéciales, robotique militaire.
Un élément essentiel de la guerre moderne n’est autre que l’artillerie. Celle-ci, reine des batailles, peut aisément aider à remporter celles-ci dans de nombreuses situations. De fait, l’artillerie est l’équipement lourd à la fois le plus destructeur, le plus traumatisant et économisant le plus de vies humaines dans notre camp tandis qu’elle fait pleuvoir un déluge d’acier et de feu sur nos adversaires dont la seule volonté est alors de s’abriter tandis que nos glorieuses troupes avancent. En somme, l’artillerie contribue à notre puissance de feu qui doit s’avérer supérieure pour aliéner l’ennemi en premier lieu puis l’éliminer dans un second temps. Et pour cela, nous devons disposer des éléments standardisés adéquats dans notre armée pour une utilisation efficace de l’artillerie à grande échelle et de manière coordonnée avec la position ennemie et nos besoins tactiques sur la ligne de front.

Ces éléments, nous en disposons déjà de certains. Nous avons déjà l’artillerie elle-même, plus d'une centaine de pièces d'artillerie tractée (des fiches techniques seront fournies ultérieurement). La puissance purement technique de ces bijoux est déjà un fort atout mais nous devons bien sûr aller plus loin que ce soit dans l’organisation, les procédures de tir et la coordination des artilleurs pour mener l’artillerie de l’Armée Rouge à être la meilleure au monde. Pour cela, le gouvernement fédéral disposera d’une nouvelle agence gouvernementale, l’Agence Terra. Cette agence gouvernementale, à la fois civile et militaire, devra fournir un travail cartographique minutieux. Devant se charger de récupérer les cartes de l'ensemble de la topographie eurysienne, y compris estalienne, et d’en façonner de nouvelles à usage militaire, les cartes produites par les experts cartographiques qui seront assignés à cette agence devra déjà répondre aux besoins civils en terme de cartes (que ce soit pour l’éducation ou le secteur de la construction par exemple) mais surtout des cartes cartographiées adaptées aux usages militaires, des cartes suffisamment précises qui quadrillent des zones entières des territoires de l'Eurysie centrale (et plus à l'avenir si l'Estalie est amenée à intervenir en dehors du continent). De telles cartes évitent plusieurs choses : d’abord, elle permet un calcul plus simple en basant le calcul uniquement sur la position de l’ennemi connu et non sur la position à la fois de l’ennemi et de l’observateur allié qui indique les coordonnées du tir. Cela sacrifie quelque peu la précision du tir mais accroît énormément la vitesse de celui-ci car les calculs de tirs de l’artillerie estalienne ne nécessitent aucun calcul trigonométrique alors que ceux ne disposant d’aucun matériel cartographique aussi précis en aura forcément besoin (souvent, l’absence de trigonométrique réduit le temps de réaction de l’artillerie à trois minutes après la demande de tir contre 10 à 15 minutes pour le cas contraire, une avancée remarquable donc). Pour les tacticiens estaliens, l’artillerie de l'Armée Rouge ne doit jamais être en réserve à proprement parler, elle est déployée en sa totalité et mise à l’emploi de la première heure du conflit jusqu’à la dernière seconde de celle-ci. De fait, l’artillerie ne doit être sous commandement (les commandants d’artillerie ont eu des ordres désignés spécifiés et leur initiative leur est retirée une fois les tirs terminés) soit en soutien, c’est-à-dire que la batterie se place au service opérationnel de tous ceux demandant un appui d’artillerie en première ligne, les observateurs sur place ayant la capacité de donner l’ordre d’ouvrir le feu, ce qui empêche les commandants de ces unités de refuser ces ordres. De fait, l’artillerie estalienne se trouve plus flexible et réactive dans ce cas de figure car elle réagit immédiatement aux demandes de tir et son commandement se décentralise suffisamment bien pour répondre à plusieurs types de besoins dans chaque secteur, une utilité très pratique lorsque les combats en première ligne se déroulent sur une large ligne de front comme sur une faible partie étant donné que la réactivité de l’artillerie estalienne lui donne aussi l’initiative dans la puissance de feu.
Toute la tactique de l’artillerie révolutionnaire repose sur ses observateurs dont une partie des unités de batterie leur sont dédiées en termes de logistiques (fournitures d’optiques, matériel de communication, cartographie). C’est surtout l’entraînement qui joue, les observateurs s’avèrent souvent être des sous-officiers et les plus expérimentés de leurs batteries ce qui leur donne déjà une légitimité à donner des ordres de tirs mais surtout contribue à ce qu’on attend d’eux. En effet, un observateur doit déjà pouvoir trouver des sites d’observation utiles, doit pouvoir situer des zones très précises sur le plan cartographique mais surtout, il doit pouvoir communiquer avec efficacité et sans aucune hésitation le langage mathématique nécessaire à sa batterie pour qu’elle obtienne des coordonnées géographiques extrêmement précises. Rien que la façon de communiquer des observateurs contribue à la fois à la réactivité de l’artillerie estalienne mais surtout à sa capacité à frapper précisément la cible. Pourtant, les observateurs ne sont pas les seuls à indiquer les tirs : chaque sous-officier de première ligne, jusqu’aux sergents, sont entraînés à donner au moins la base du langage des coordonnées en se basant sur leurs propres cartes (certes moins précises mais donnant toujours des indications exactes). Le tir sera de fait moins précis mais déjà, mieux que si on bombardait sans donner l’avis aux troupes sur place qui ont ainsi l’occasion de notifier leurs propres positions et donc d’éviter le tir ami (souvent un des défauts de l’artillerie durant les guerres). Le but ici n’est pas forcément de faire de chaque soldat estalien un observateur mais de permettre que dans un bataillon par exemple, l’on dispose d’au moins un homme capable de faire appel à l’artillerie de manière intelligible.
Pour encore plus augmenter la précision du système de l’artillerie estalienne, une autre solution s’impose aussi : déléguer la partie calculs aux ordinateurs. Plus précisément, décentraliser la méthode de calculs en la faisant faire par autrui (quand les conditions le permettent). Ainsi, les communications reçues par les batteries de l’Armée Rouge seront toujours aussi reçues par un centre de direction des tirs (CDT) qui disposera lui de locaux et donc d’un matériel immobile informatique qui permettra le calcul très rapide par ordinateur de toutes les données nécessaires que la batterie donnera également et pré-établira en détails avant chaque tir par son service de transmission : vent, température, usure du canon, différence d'élévation, etc. Le CDT calcule aussi en permanence les variations des positions de chaque batterie à l’avance afin de s’épargner la plupart des calculs à chaque tir (la flemme légendaire des mathématiciens). En plus de ces éléments, la tactique du TOT (Time-On-Target) sera évidemment employée ici. En effet, les calculs du tir étant elles-mêmes très précises et extrêmement proches de la réalité, le TOT permet de calculer également sur le plan temporel l’arrivée même de l’obus afin de prévoir en temps réel le moment où l’obus arrive à sa destination afin de maximiser les dégâts lors d’un assaut ou lors d’une frappe coordonnée par un observateur au sol. En somme, un système foutrement diabolique et efficace qui vise à détruire plutôt qu’à neutraliser, rendant l’artillerie estalienne efficace, précise, destructrice et réactive. Enfin, notez qu’en dernier recours, chaque batterie dispose également d’un manuel à rubans très simple à prendre en main : chaque ruban au sein du manuel représente une situation tactique en particulier. Les bandes imprimées disposent de toutes les informations nécessaires aux tirs, y compris les méthodes de calcul du tir et les procédures à suivre, les emplacements des formules devant être uniquement remplacées par les distances. Finalement, le contenu de la bande est lue par le chef d’équipage de la pièce pour calibrer celle-ci. Avec ce genre de systèmes, dans le cas où les communications sont tout de même foireuses et même dans le cas où les officiers compétents sont inaptes à commander, même le moins qualifié d’une batterie peut diriger les tirs et mener tout de même à un résultat précis et rapide. C’est donc un système simple, rapide à lire, qui se veut instinctif à l’usage et à la portée de tous.
Notez qu’en plus de ces chamboulements organisationnels qui rendent l’artillerie rouge parmi les artilleries les plus dévastatrices au monde, l’équipement compte aussi : l’artillerie dispose désormais de son propre service logistique et son propre génie qui doit aménager les positions de tirs et les moyens de transport jusqu’à celles-ci tandis que la logistique s’assure de toujours subvenir aux besoins de la batterie. Notez enfin que l’artillerie estalienne disposera également à disposition d’obus à fusée de proximité, qui n’explosent pas à l’impact mais plutôt au-dessus du sol. En effet, on considère que durant les grandes guerres industrielles, la grande majorité des victimes de l’artillerie sont dues aux éclats d’obus dits descendants, c’est-à-dire des obus à fusée de proximité dont les éclats peuvent s’infiltrer dans les tranchées par exemple même avec une certaine imprécision, réduisant nettement l’efficacité des tranchées par exemple contre l’artillerie.
Posté le : 28 août 2024 à 23:10:47
19770

Suite à la poursuite des recrutements et de l'agrandissement du service militaire au sein de la population, l'Armée Rouge a pu accumuler de nouveaux effectifs de conscrits, ayant pu former 7500 nouveaux conscrits afin de les intégrer à la structure de l'Armée Rouge. En plus de l'agrandissement périodique de l'Armée Rouge en terme de conscrits, l'Armée Rouge a pu compléter le recrutement des premiers membres de la Garde Populaire, la force de réserve principale de l'Armée Rouge. Ainsi, ces réservistes seront dispatchés de façon équitable entre les régions militaires A1, A2 et A3 soit environ 830 hommes par région, divisés en régiments dans les villes des dites régions. Leur fonctionnement ayant déjà été éclairci par l'Armée Rouge, nous ne reviendrons pas sur leur fonctionnement. De ce fait, néanmoins, compte tenu du fait que les Gardes Populaires sont légalement membres à part entière de l'Armée Rouge, cela signifie que les effectifs de l'Armée Rouge s'élèvent désormais à 27 500 hommes. De ce fait, les nouveaux conscrits formés dans les centres de formation de l'Armée Rouge seront intégrés directement à la 3ème Brigade Mécanisée. Néanmoins, les effectifs de 8000 hommes de la brigade étant largement complétés par la nouvelle vague de conscription, le millier de conscrits en surplus dans les effectifs de l'Armée Rouge seront directement affiliés à la 4ème Brigade de Montagne, une nouvelle formation qui sera basée à Bolioska.
Positionnement des brigades sur le territoire estalien :
Il est à noter que ces emplacement sont à titre purement indicatif des bases militaires de référence de ces brigades. Les brigades sont réparties dans toute la région, les villes citées ne sont que des références administratives. La répartition concrète des brigades sur le territoire estalien reste strictement confidentielle.
Méthodes de combat estaliennes en montagne :
La nation estalienne, surtout sa partie occidentale, a toujours côtoyé les montagnes qui ont entourés les vastes plaines de l'Horistia. Cependant, si historiquement ces montagnes ont protégés l'Estalie contre les invasions étrangères durant des siècles, les armées estaliennes n'ont jamais estimés juste de se spécialiser dans le combat en montagne, préférant utiliser les cols des montagnes comme goulets d'étranglement durant des batailles rangées afin d'y éliminer la menace adverse. Si les résultats de cette tactique ont montrés des résultats convaincants il y a des siècles de cela, l'Estalie ne peut plus se limiter ni à rester sur une position défensive passive ni se limiter à garder certaines zones montagneuses. Rares ont étés les analyses militaires estaliennes contemporaines en ce qui concerne le combat en montagne, il est temps d'y remédier.
Les zones montagneuses disposent de leurs propres caractéristiques et d'une complexité importante qu'il est nécessaire d'analyser avant de s'engager profondément dans les détails tactiques de la guerre en montagne. Généralement, les zones montagneuses ont des réseaux routiers médiocres et des densités de population assez faibles. Cela permet d'abord de comprendre que la guerre en montagne dispose de deux caractéristiques : le danger que les civils fassent partie des dommages collatéraux est très faible, ce qui engage pour nos forces armées une plus grande puissance de feu sur une plus grande surface. Néanmoins, cela exige aussi une logistique adaptée aux besoins des zones montagneuses, les moyens conventionnels logistiques habituellement utilisés dans les zones géographiques dégagées ne sont pas adaptés et nécessitent donc des améliorations significatives ou l'utilisation de moyens auxiliaires plus efficaces. D'un aspect purement stratégique pour l'Estalie, la montagne est essentielle à maîtriser : elle constitue la barrière principale entre l'Estalie et la Kartvélie mais aussi entre l'Estalie et le Nordfolklande, ce qui limite sérieusement nos capacités d'intervention et nécessite donc une étape de prise de possession des régions montagneuses avant d'accéder aux plus vastes plaines se trouvant au-delà. Nous devons prendre les devants, ces deux pays ne possèdent aucune force spécialisée dans ces environnements, à nous de prendre les devants et d'apporter des innovations à la formation, la tactique et le matériel utilisé en zone montagneuse.
La guerre en montagne peut se définir fondamentalement par un déploiement de forces sur un terrain présentant des différences importantes d'altitude, des influences météorologiques plus fortes et des infrastructures isolées, médiocres ou absentes. De ce fait, le déploiement statique de forces en montagne, comme ce fut souvent le cas au XXe siècle, n'est plus adapté à l'ère des hélicoptères de combat et des drones. La guerre en montagne contemporaine se déroule au sein d'opérations en territoire vaste et complexe avec peu d'axes de mouvements pour les troupes. Cependant, il se caractérise aussi et heureusement par des capacités de reconnaissance et d'engagement plus efficaces avec une portée plus large ainsi que des combats rapides, mobiles et dispersés sur l'ensemble d'une zone de combat. Tout cela pour dire que ce sont des affrontements qui nécessitent un équipement adapté et un personnel formé pour remplir effectivement des missions militaires en montagne. En effet, pour les soldats en eux-mêmes, la guerre en montagne exige des compétences physiques rigoureuses. Les terrains à risque de chute, les longues distances à parcourir à pied lorsque les infrastructures viennent à manquer ou lorsque les conditions météorologiques l'exigent nécessitent de la part des soldats une véritable solidité physique et mentale dans ce type de situations. C'est pour cela que les conscrits et actifs professionnels qui serviront dans les unités de montagne de l'Armée Rouge seront en priorité celles et ceux qui seront déjà acclimatés au climat montagneux, donc concrètement les hommes et femmes issus des régions montagneuses de notre pays car une force de soldats acclimatée à la montagne de façon naturelle est à la fois plus facile à former pour l'Armée Rouge et permet l'esprit d'initiative, les soldats en montagne étant quasiment dans leur élément naturel. La mobilité est un facteur crucial pour les troupes de montagne et ce, en toutes saisons et même dans les situations météorologiques les plus extrêmes, ce qui nécessite que les véhicules qui seront envoyés aux unités de montagne seront des véhicules CATV adaptés à la montagne et aux conditions enneigées. De surcroît, la formation des unités de montagne comprendra aussi la formation de ski afin de mieux se déplacer dans les zones montagneuses en hiver. De surcroît, les troupes de montagne doivent s'habituer à ne compter que sur eux-mêmes au cours des opérations militaires, il faut donc les acclimater à tout ce qui pourrait se produire en montagne : auto-assistance simple, sauvetage improvisé en montagne, opérations de sauvetage complexes, opérations de récupération du personnel, etc. Ainsi, en plus des entraînements standards des unités en elles-mêmes, les forces en montagne seront appelées fréquemment à effectuer des missions de sauvetage ou d'aide aux populations civiles en zone montagneuse, le but étant à la fois d'économiser sur les effectifs des forces de sécurité civile tout en formant les soldats à agir dans des conditions réelles auprès des civils estaliens.

La formation en montagne des troupes estaliennes doit, in fine, faire adhérer aux troupes de montagne un comportement militaire, des compétences en alpinisme supérieur à la moyenne, le sens des responsabilités et l'esprit d'initiative. De ce fait, l'entraînement s'oriente afin de faire maîtriser aux troupes de montagne le déploiement rapide et autonome en terrain très difficile ou dans des conditions météorologiques (y compris dan des températures glaciales extrêmes ou en haute altitude), le leadership lors des opérations de sauvetage civil et la capacité d'utiliser l'environnement comme arme de combat (par la maîtrise du déclenchement d'avalanches par des explosions contrôlées sur des positions adverses) et enfin la maîtrise du tir à longue distance en terrain montagneux. De ce fait, chaque montagnard estalien de l'Armée Rouge est un apprenti tireur d'élite, capable de maîtriser au moins les bases du tir à longue distance.
D'un point de vue organisationnel, la planification des opérations doit être rigoureuse et doit être gérée par une cellule de montagne qui sera intégré à chaque bataillon d'infanterie de montagne. En effet, la mauvaise planification, la connaissance superficielle du terrain ainsi que l'ignorance ou la sous-estimation des forces ennemies en présence ne peuvent qu'entraîner l'échec des opérations et à un gaspillage inutile de vies humaines. C'est pour cela que les cellules de montagne existent, elles sont à la fois les yeux et les oreilles des bataillons d'infanterie de montagne, chargées de reconnaître le terrain, de le cartographier et d'élaborer le tracé des chemins à suivre lors des opérations du bataillon. Ils évaluent la situation en terrain montagneux, conseillent les chefs d'unités sur le plan tactique et fournissent aux unités avant les opérations des cartes précises et une formation topographique permettant aux hommes de se repérer de façon rudimentaire en terrain montagneux. Là où les zones démunies de rapports d'avalanches accidentelles et civiles se trouvent, les cellules de montagne établissent des rapports militaires d'avalanches si les forces de montagne ont besoin de provoquer intentionnellement des avalanches sur des cibles militaires en temps de guerre. La cellule de montagne comprend de ce fait, en grande majorité, de guides de montagne militaires, de conscrits travaillant dans des zones montagneuses dans le secteur civil, des alpinistes sportifs ou des spécialistes en région montagneuse. De ce fait, le but de la cellule de montagne, à l'échelle d'une brigade, est de fournir aussi au commandement de la brigade et à l'état-major de l'Armée Rouge un flux d'informations continues sous la forme de rapports normalisés pour donner toutes les informations nécessaires et les outils de reconnaissance adéquats aux troupes de montagne lors des opérations militaires. A noter que les cellules de montagne ont des priorités standardisées en temps de guerre, notamment la sécurisation des parois rocheuses abruptes, les ravins et les crêtes étroites afin de donner dès le départ un avantage tactique décisif aux troupes de montagne, les unités spécialisées de la cellule de montagne cherchant à sécuriser ces endroits ou les piéger dès les premières heures d'un affrontement militaire. Les unités de montagne, notamment les bataillons d'infanterie de montagne, sont organisés différemment des bataillons d'infanterie classique des autres unités de l'Armée Rouge : chaque bataillon dispose d'une compagnie de reconnaissance avec une unité de reconnaissance en montagne, deux compagnies de génie en montagne et deux compagnies d'approvisionnement en montagne. De surcroît, le service logistique de chaque bataillon permet à la fois de former les hommes à l'utilisation des animaux de transport pour les opérations de ravitaillement mais également d'établir des itinéraires de ravitaillement répertoriées sous la forme de pistes de couleurs qui permettent ainsi aux unités de logistique d'emprunter sur plusieurs itinéraires différents des positions stratégiques et d'assurer leur ravitaillement. Notons enfin la présence dans chaque bataillon d'un peloton de combat en haute montagne qui doit soutenir les autres compagnies d'infanterie de montagne en étant mobilisé dans toutes les opérations aux conditions météorologiques ou géographiques extrêmes, notamment pour l'obtention des zones à haute altitude, en plus d'être une force de reconnaissance pouvant mener des reconnaissances ou des raids en profondeur dans le dispositif adverse en se faufilant dans des zones géographiques difficiles à surveiller où les conditions de maintien d'une position sont plus difficiles. Enfin, il est à noter que chaque compagnie d'infanterie de montagne espace souvent la ligne de front entre eux d'entre 1000 à 1800 mètres. Cette distance permet à la fois de couvrir une large zone une fois en position sur les hauteurs tout en permettant d'assister par tir indirect ou par renfort direct des positions alliées prises d'assaut par l'adversaire.
Sur le plan tactique, la guerre de montagne interdit naturellement les grandes manœuvres comme sur les terrains plats et nécessite donc l'utilisation de petites unités tactiques afin de prendre les points stratégiques les plus importants sur une ligne de front. La guerre en montagne est souvent une affaire de sécurisation d'axes de mouvement favorables, ce qui nécessite le contrôle des points en hauteur adjacents. Cela permet de ralentir à la fois les forces ennemies qui passeraient par ces axes de mouvement, de surveiller leur progression, de sécuriser les flancs des forces en présence ou de simplement stopper les mouvements adverses sur des goulets d'étranglement précis avec des effectifs relativement faibles. C'est la magie des combats en montagne : une petite force de combat peut tenir en respect des forces parfois numériquement et matériellement plus importantes si elle dispose d'une position géographique avantageuse, dispose d'une connaissance avancée du terrain et surtout si les troupes en présence sont autonomes dans la défense de leurs objectifs. La plupart du temps, les unités au combat sont dans des endroits isolés où l'envoi de renforts peut être long et fastidieux, ce qui exige que les unités sur place soient autonomes et ne nécessitent pas dans leur fonctionnement un lien permanent et constant avec le reste de la brigade. De ce fait, chaque bataillon doit aussi être en capacité de conserver une réserve opérationnelle, qu'elle soit à pied mais aussi héliportée afin de gérer les points chauds de façon plus efficace, il va sans dire que les déploiements en montagne sont naturellement longs alors une force héliportée permet dans des situations météorologiques favorables de déployer rapidement des renforts de réserve en cas de besoin. C'est alors là que l'entraînement fait toute la différence pour les troupes de montagne estaliennes : le leadership et l'esprit d'initiative sont des compétences non seulement importantes mais aussi et surtout obligatoires à acquérir pour les soldats en montagne car c'est uniquement de cette façon que les petites unités de combat peuvent tenir dans une période prolongée des endroits stratégiques vitaux face à des forces numériquement plus importantes. De surcroît, les conditions métrologiques et géographiques peuvent limiter la communication radio, ce qui nécessite pour les troupes une internalisation des informations et du plan tactique avant les opérations afin que chacun, si coupé des communications radio, soit capable de comprendre son rôle, appliquer la tactique convenue par les chefs d'équipe, connaître les voies de repli en cas de retraite (conserver les vies humaines est essentiel pour les troupes de montagne, savoir se replier rapidement en dehors du champ de tir ennemi est une nécessité dans l'élaboration des tactiques de montagne). Les combats en eux-mêmes peuvent comprendre plusieurs situations. Généralement, on retrouve les attaques de vallées, des zones entourées de zones montagneuses mais sur lesquelles les véhicules de combat conventionnels peuvent être utilisés. Dès lors, le rôle des unités de montagne est de sécuriser ces vallées en prenant appui sur les zones en hauteur situées aux alentours afin de les sécuriser pour les tireurs à longue distance, les unités de reconnaissance ou l'artillerie de montagne, le tout en sécurisant le flanc des unités de combat classiques par le soutien de tirs directs ou indirects dans la vallée ou encore s'en prendre aux flancs ou l'arrière des unités adverses. Les approches des positions ennemies sont aussi un vecteur important des opérations tactiques : les attaques des positions sont souvent difficiles à faire, surtout lorsqu'il s'agit d'avancer en terrain découvert. Or, avancer en terrain découvert, c'est contredire le principe de base de l'infanterie moderne qui se base toujours sur des éléments de protection de l'environnement pour pouvoir effectuer ses opérations offensives. Pour les terrains plats ou urbains, l'utilisation de tirs indirects, la force mécanisée, le support aérien, le bombardement à l'artillerie ou encore l'utilisation d'armes lourdes est nécessaire mais pour les troupes de montagne, ce matériel ne peut pas toujours être à disposition, c'est pour cela que les offensives de montagne doivent être soigneusement préparées en concordance avec les prévisions météorologiques, le but étant d'attaquer durant un brouillard (naturel ou artificiel) ou des précipitations qui sert de protection naturelle en limitant grandement le champ de vision adverse et la portée de ses systèmes d'armes. Au cours des attaques, lorsqu'une percée est effectuée dans le dispositif ennemi, celle-ci doit pouvoir être exploitée dans les plus brefs délais par un ensemble de petites unités qui doivent profiter de la confusion de la percée pour prendre des positions avancées dans le dispositif ennemi pour l'obliger à abandonner un secteur tout entier. De ce fait, les percées doivent être accompagnés de systèmes d'armes lourdes effectuant des tirs directs sur les positions adverses pour empêcher une possible réaction. IL est à noter qu'en temps normal, les troupes de montagne estaliennes sont bien plus dotées en munitions que le reste des fantassins de l'Armée Rouge, le but étant de conserver une autonomie en terme de munitions pour limiter les opérations de ravitaillement. De surcroît, les unités de montagne estaliennes n'ont que peu d'armes lourdes, surtout dû à leur transport difficile mais le peu que possèdent les bataillons d'infanterie de montagne sont utilisées de façon soutenue avec un stockage accru de munitions et le maniement dans des zones inaccessibles aux systèmes d'armes ennemis par un personnel qualifié à son maniement et avec une mobilité constante afin d'éviter les opérations ennemies visant le matériel lourd. Il est à noter que d'un point de vue défensif, les armes peuvent utiliser leur portée maximale et utiliser les obstacles montagneux comme des barrières naturelles. La défense estalienne en montagne n'est pas forcément meurtrière, ce n'est pas le but. Le but recherché est de ralentir et d'épuiser les troupes d'en face pour faciliter les prochaines opérations offensives. De ce fait, l'utilisation de la portée maximale des armes des bataillons d'infanterie de montagne sont nécessaires pour les tirs indirects qui obligent les unités ennemies en situation offensive de se tenir à couvert et à ralentir leur approche, ce qui peut les épuiser voire les immobiliser suffisamment longtemps pour que l'artillerie ou l'aviation intervienne et écrase l'attaque ennemie.

Reconnaissant également l'importance de l'établissement d'une supériorité aérienne en terrain montagneux que ce soit pour des forces héliportées pour le transport ou le soutien rapide au sol ou les forces aériennes pour le soutien au sol sur des espaces vastes et larges et la sécurisation des lieux impossibles à prendre d'assaut au sol sans grandes pertes humaines. De ce fait, chaque bataillon est aussi gestionnaire de la disposition du réseau radar dans les zones montagneuses, devant s'assurer de la sécurité des sites à haute altitude et équipés de radars portatifs qui permet ainsi aux unités aériennes de balayer largement les zones, d'accroître la détection aérienne et donc de faciliter les opérations de supériorité aérienne d'une part et de repérer les mouvements aériens adverses en montagne et ainsi contrer ces derniers avec un matériel approprié (toujours un plaisir d'accueillir au MANPADS les opérations héliportées délibérées de l'adversaire).

La logistique est évidemment une composante importante pour les opérations militaires en montagne. Un certain nombre de critères naturels sont à prendre en compte pour le réseau logistique que ce soit les différences d'altitude, la difficulté du terrain, le manque de routes et d'infrastructures viables, la neige, la glace, le dénivelé des montagnes, etc. Tout cela complique grandement les opérations de logistique en limitant ses mouvements et sa vitesse d'action. C'est pour cela que le ravitaillement des forces de montagne, en dehors des axes de mouvement connus pour être viables pour l'utilisation routière, deux méthodes seront employées par l'Armée Rouge. La première, la plus évidente, c'est l'utilisation d'unités héliportées qui pourront grandement faciliter le ravitaillement en montagne en contournant la plupart des problèmes de logistique pour les unités au sol. Néanmoins, le ravitaillement héliporté comporte deux contraintes : tout d'abord, si les conditions météorologiques sont trop mauvaises, les hélicoptères de transport ne peuvent acheminer le matériel et seront certainement cloués au sol, surtout lors des périodes hivernales ; ensuite, en cas de difficultés pour les forces aériennes de conserver la supériorité aérienne ou dans le cas où les unités ennemies sont trop proches des forces amies à ravitailler, les hélicoptères de ravitaillement ont de grands risques d'être interceptés, ce qui relève donc du gaspillage de matériel (et humain, il y a de grandes chances que les pilotes y laissent aussi la vie). Il faut donc un moyen terrestre sûr et pour cela, les troupes de montagne utilisent les bonnes vieilles méthodes utilisées depuis des siècles par les armées du monde entier : les animaux. Les mules et les ânes sont généralement des animaux très résilients aux conditions de vie extrêmes de la montagne, la mule est notamment un animal connu pour sa résistance, sa capacité d'emport importante, sa longévité et surtout sa loyauté. C'est un moyen ancestral pour la logistique mais la mule, même dans les conflits modernes, n'a jamais failli à sa tâche lorsqu'il s'agit de mener des opérations de ravitaillement dans des zones géographiques difficiles d'accès. L'avantage d'utiliser ces animaux sont multiples que ce soit leur discrétion (absence de signature radar par rapport aux véhicules terrestres), leur coût relativement bas et leur fiabilité à toute épreuve. Bien sûr, les soldats affiliés aux services logistiques des brigades de montagne seront formés à pratiquer régulièrement des parcours éprouvants avec leur animal de bât dans les zones montagneuses afin de les entraîner à l'escalade d'assaut, l'emballage des animaux ou le mouvement en petits convois dispersés.
Posté le : 31 août 2024 à 18:06:51
331


Posté le : 09 sep. 2024 à 00:12:18
21145


Suite à un décret de la Commission à la Guerre du 15 Juillet 2014, il a été demandé par la Commission de réinstituer une nouvelle forme organisationnelle pour les unités des forces spéciales au sein de l'Armée Rouge. En effet, depuis la Révolution, l'Armée Rouge devait compter principalement sur les éléments les plus conventionnels de la guerre moderne, donc en autre l'arme blindée et mécanisée, pour maintenir l'ordre puis pour être la force de défense principale du pays face aux menaces impérialistes voisines. Néanmoins, les forces conventionnelles sur lesquelles les Estaliens ont perfectionnés au mieux leur fonctionnement, leur recrutement, leur entraînement, leur matériel et leur organisation ne suffit as forcément à gagner toutes les guerres. Il est parfois nécessaire pour les forces révolutionnaires de disposer d'un embryon élitiste de forces spéciales devant assurer la défense de notre Fédération dans des opérations réservées uniquement aux professionnels. Et en cela, l'Estalie a besoin de réformer son corps d'unités spéciales. En effet, après la Révolution, la plupart des unités des forces spéciales ont étés dissoutes, souvent dû à leur appartenance politique un peu trop proche des royalistes, ce qui leur a valu leur élimination. Les forces spéciales estaliennes restantes comme la Garde Royale étant ralliés aux forces terroristes du FLS et ne pouvant plus que compter que sur les opérateurs dévoués et efficaces mais malheureusement peu nombreux du SRR, l'Armée Rouge doit disposer de ses propres forces spéciales afin d'assurer son indépendance dans ses opérations non conventionnelles. Ainsi, la Commission à la Guerre a décidé de former un nouveau corps pour les forces spéciales : le CFST (Commandement des Forces Spéciales Terrestres). Ce commandement centralisé devra ainsi coordonner les opérations des forces spéciales terrestres dirigées par l'Armée Rouge. Compte tenu de l'absence d'organisation encore inhérente dans les forces aériennes fédérales et faute d'équipements adéquats à fournir à des forces spéciales aériennes, la Commission indique tout de même que le CFST se concentre exclusivement sur les forces spéciales affiliées à l'Armée Rouge et ne dispose d'aucune prérogative directe sur de futures forces spéciales aériennes, sur les forces spéciales de la police fédérale ou les unités spéciales du SRR. Ainsi, les forces spéciales du CFST devront se coordonner afin d'assurer les missions que l'on confie généralement aux forces spéciales que ce soit la reconnaissance spéciale en terrain hostile, la formation et le développement de forces armées gouvernementales et insurrectionnelles en territoire étranger, l'action directe, le soutien aux forces conventionnelles contre la guérilla et les forces insurrectionnelles, les opérations antiterroristes, le sabotage, la démolition ou encore le sauvetage d'otages.
Organisation :
Le CFST est lui-même organisé en plusieurs comités et différentes unités jouant tous un rôle spécifique dans la réalisation successive des opérations non conventionnelles sur le terrain en temps de paix comme en temps de guerre. En premier lieu, on retrouve le Comité de Direction Interarmées (CDI) qui est chargé d'étudier les exigences et les techniques des opérations spéciales afin de s'assurer de la coordination entre toutes les armes à la disposition des forces spéciales, notamment lorsque des opérations spéciales nécessitent l'utilisation d'un moyen de transport aérien ou héliporté. Le but est donc à la fois de planifier et d'organiser les entraînements et les manoeuvres pour permettre aux opérateurs de disposer d'une connaissance technique suffisante du milieu dans lequel ils vont évoluer une fois sur le terrain mais également pour valider et assurer la bonne gestion des opérations spéciales demandées par l'état-major. En somme, toutes les opérations spéciales demandées par l'Armée Rouge passe obligatoirement par les officiers des forces spéciales du CDI qui passe en revue les capacités opérationnelles des forces spéciales, élaborent les ébauches des plans d'approche et d'action des dites opérations et déclarent si, in fine, le plan est cohérent, réaliste et peut être effectué avec un minimum de pertes humaines et matérielles (le risque de perdre des opérateurs expérimentés lors des opérations spéciales font partie des plus gros problèmes que rencontrent les forces spéciales, un opérateur prend parfois des années à être entraîné pour atteindre le sommet de l'entraînement militaire moderne, le perdre signifie aussi une perte importante de temps et de moyens humains pour les forces armées).
Plus bas dans la hiérarchie du CFST, on retrouve ensuite les unités opérationnelles des forces spéciales, ce qui nous intéresse vraiment ici. On retrouve différentes unités pour les forces spéciales révolutionnaires, chacun ayant souvent un rôle spécifique dû à un entraînement dirigiste tout aussi complexe et éprouvant en fonction des missions et des attentes des candidats. Dans l'ordre, on retrouve donc :

Formation :
Si chacune des forces spéciales citées précédemment ont chacun leur rôle à jouer et souvent des rôles spécifiques demandant des compétences particulières, il existe un socle d'entraînement commun à toutes les forces spéciales sur le terrain. En effet, pour intégrer un de ces groupes spéciaux, le CFST fait passer la totalité des candidats dans le centre de formation spéciale de Pendrovac qui sera l'installation principale d'entraînement des forces spéciales avant leur sélection dans les différentes forces spécialisées (sauf pour la Force Artémis, les candidats pour cette force sont déjà choisis dès le départ et leur entraînement se fait à part, loin des autres candidats des autres forces).

Evidemment, la formation des forces spéciales estaliennes se compose des cinq grand fondamentaux du combat : l'adresse au tir, l'entraînement physique, l'entraînement médical, le combat en petites unités et la mobilité. L'entraînement militaire se décompose en trois phases. La première, nommée la phase de pliage, est conçue pour évaluer la situation physique et mentale des candidats tout en lui donnant les bases tactiques de combat au sein des forces spéciales estaliennes. Durant cette phase durant un mois, les instructeurs apprennent aux soldats comment entretenir son matériel en mission, subvenir aux besoins de la mission et de ses camarades et accomplir des missions de combat non conventionnelles en terrain difficile. Il est à noter que les candidats ne sont pas choisis aléatoirement et sont choisis selon des ordres de critères mentaux et physiques, la plupart des candidats choisis sont déjà militaires ou ont déjà effectués leur service militaire, ça nous évite d'avoir des bleus dans les forces spéciales et de tout leur apprendre depuis le début. La phase de pliage se compose en deux parties : deux semaines dites de RAP et deux semaines dites Darby. Les deux semaines RAP sont là pour évaluer physiquement les candidats avec un minimum physique requis : 50 pompes normales minimum, 50 pompes sautées minimum, course de 8 kilomètres en 40 minutes ou moins, dix tractions minimum, etc. Cela comporte également à des entraînements avec des parcours du combattant, des escalades de cordes de six mètres avec la seule force des bras et sans l'aide des jambes, une marche de vingt kilomètres avec treillis, paquetage et fusil-mitrailleur avec un sac de 22 kilos remplis de cailloux dans le dos, parcours d'obstacles avec des tyroliennes, des gouttières, des asperges, des cheminées et des échelles sur une longueur de 2 kilomètres de parcours et ce, de manière chronométrée. Évidemment, les candidats ont droit à trois essais, on est pas des monstres (ou peut-être qu'on l'est). De plus, ces deux semaines comprendront une évaluation de survie en milieu nautique dans le lac de Pendrovac, une épreuve de navigation terrestre de quatre heures dans les montagnes, une course de 3 kilomètres en binôme avec paquetage et équipement complet et pour achever la deuxième semaine, une marche de 20 kilomètres avec 24 kilogrammes sur le dos, sans eau. A la fin de ces deux semaines, le tiers le moins performant du lot est disqualifié, les 66% restants sont conservés pour la deuxième phase. La troisième semaine débute par une instruction rapide des procédures de commandement des troupes sur le terrain, les principes de la patrouille en terrain hostile, la démolition, les embuscades d'escouade et la reconnaissance spéciale en profondeur. Ensuite, une fois l'instruction faite, les candidats doivent encore passer un parcours du combattant de 20 obstacles ardus en terrain vallonée. Puis une fois cela fait, les deux semaines seront rentabilisés dans des patrouilles en terrain accidenté, dans l'alpinisme et dans la mise en application pratique de ce qui a été dit précédemment. A la fin du mois, 50% du lot initial le plus performant des candidats sont conservés.
La deuxième phase se nomme la phase dite de montagne. Au cours de la phase de montagne, les candidats reçoivent un cours sur les tâches d’alpinisme militaire, l’entraînement à la mobilité, ainsi que les techniques d’utilisation d’un peloton pour des opérations de patrouille de combat continues dans un environnement montagneux. Ils développent davantage leur capacité à commander et à contrôler des patrouilles de la taille d’un peloton en planifiant, en préparant et en exécutant diverses missions de patrouille de combat. Les candidats continuent d’apprendre à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs subordonnés dans les conditions défavorables des montagnes. Le terrain accidenté, les conditions météorologiques extrêmes, la faim, la fatigue mentale et physique et le stress émotionnel que l’élève subit lui donnent l’occasion d’évaluer ses propres capacités et limites ainsi que celles de ses pairs. Les candidats reçoivent une formation de quatre jours sur l’alpinisme militaire. Au cours des deux premiers jours à l’alpinisme inférieur, les candidats apprennent les nœuds, les relais, les points d’ancrage, la gestion des cordes et les bases de l’escalade et de la descente en rappel. La formation d’alpinisme se termine par un exercice de deux jours où l’on applique les compétences acquises lors de l’alpinisme inférieur. Les candidats effectuent une journée d’escalade et de descente en rappel sur un terrain exposé et à angle élevé. Le deuxième jour, les escouades effectuent un entraînement à la mobilité pour déplacer leur personnel, leur équipement et les victimes simulées sur un terrain très restrictif à l’aide de cordes fixes et de systèmes de halage. Après l’alpinisme, les candidats effectuent quatre jours d’entraînement aux techniques de combat. Au cours de cette formation, les candidats reçoivent des cours et effectuent des exercices pratiques sur le mouvement au contact, la base de patrouille, les procédures de commandement de troupe, les ordres d’opérations, connus sous le nom d’OPORD, les combatifs, les embuscades et les raids. Les candidats effectuent ensuite dix jours de patrouille lors de deux exercices d’entraînement sur le terrain. Les missions de patrouille de combat sont dirigées contre une force de menace équipée de manière conventionnelle dans un scénario de conflit de faible intensité. Ces missions de patrouille sont menées de jour comme de nuit et comprennent des opérations d’assaut aérien et de vastes mouvements à travers le pays à travers un terrain montagneux. Les candidats exécutent des missions de patrouille nécessitant l’utilisation de leurs compétences en alpinisme. Les missions du peloton comprennent des mouvements de contact, des embuscades de véhicules et de personnel et des raids sur des sites de communication et de mortier. Les candidats effectuent également des traversées de rivières et escaladent des montagnes en pente raide. L’endurance et l’engagement du candidat aux forces spéciales sont mis en avant au maximum. À tout moment, il peut être choisi pour diriger des candidats pairs fatigués, affamés et physiquement épuisés afin d’accomplir une autre mission de patrouille de combat.
La troisième phase se nomme la phase Pendrovac et désigne la phase se déroulant principalement dans le lac avoisinant de Pendrovac afin d'apprendre aux opérateurs les bases du combat des forces spéciales en milieu maritime. À leur arrivée, les candidats reçoivent des instructions sur les opérations nautiques, les mouvements de petits bateaux et la traversée de cours d’eau. Des exercices pratiques dans le cadre d’opérations prolongées au niveau d’un peloton exécutées dans un environnement de marécage côtier testent la capacité des élèves à opérer efficacement dans des conditions de stress mental et physique extrême. Cette formation développe davantage la capacité des candidats à planifier et à diriger de petites unités lors d’opérations indépendantes et coordonnées de patrouille aéroportée, d’assaut aérien, de petit bateau et de patrouille de combat à pied dans un environnement de combat de faible intensité contre un ennemi bien entraîné et sophistiqué. La phase Pendrovac poursuit l’entraînement tactique des petites unités dans un environnement opérationnel progressif, réaliste et contemporain. Les candidats effectuent dix jours de patrouille au cours de deux exercices d’entraînement sur le terrain. Les exercices d’entraînement sur le terrain sont des exercices rapides, très stressants et stimulants au cours desquels les étudiants sont évalués sur leur capacité à appliquer des tactiques et des techniques de petites unités lors de l’exécution de raids, d’embuscades, de mouvements de contact et d’assauts urbains pour accomplir les missions qui leur sont assignées.
Une fois cet entraînement rigoureux effectué sur quasiment trois mois intensifs, l'opérateur est officiellement considéré comme apte à rejoindre une des forces. Chaque force dispose de son propre programme d'entraînement et récupère ainsi les candidats sortant du centre de formation spéciale de Pendrovac qui sortent de trois mois de formation intensive pour les prolonger dans des formations spécifiques, plus longues, allant de douze à 24 mois en fonction des unités. Une fois la formation achevée, il est à noter qu'en temps de paix, des exercices réguliers avec des unités de tomodensitométrie fédérales maintiennent à jour leurs compétences et leur base de connaissances afin de conserver le niveau de formation des opérateurs bien après la fin de leur formation initiale. Il est à noter que la formation après Pendrovac peut être écourté pour des besoins opérationnels si jamais la force a besoin des nouveaux effectifs le plus vite possible mais les opérateurs en entraînement doivent reprendre la formation après leur intervention en conditions réelles.
Posté le : 09 sep. 2024 à 19:56:26
18583

Au-delà de l'organisation concrète des unités de première ligne, de l'entraînement des troupes, du pourvoi de leur équipement, de leur commandement par l'état-major, de la coordination interarmées ou encore des forces spéciales qui composent désormais l'Armée Rouge, il est évident qu'à la guerre, un soldat le ventre vide ne se bat pas. De ce fait, la logistique est un élément essentiel au bon fonctionnement des forces armées organisées afin d'assurer leur ravitaillement en vivres, en matériel, en munitions et assurer leur transport entre les points chauds du conflit. De ce fait, la plupart des grands conflits, antiques comme modernes, se sont souvent remportés sur une question de logistique qui jouait certes à l'arrière-plan des grandes opérations militaires mais qui fut déterminante dans la réalisation de l'ensemble de ces dites opérations. Une bonne armée, c'est une bonne logistique. C'est pour cela que la Commission à la Guerre et l'état-major de l'Armée Rouge a décidé de réorganiser pleinement le service logistique de l'Armée Rouge afin de permettre une meilleure gestion et distribution des ressources militaires entre les unités opérationnelles de l'Armée Rouge et régler définitivement les problèmes de logistique qui touchaient autrefois l'Armée Royale estalienne.
Organisation :
Si le service logistique dispose d'une seule et même mission assez évidente comme dit précédemment, le service logistique au sein de l'Armée Rouge de notre glorieuse Fédération n'est pas homogène et se divise en plusieurs branches et différents organismes qui disposent chacun de leurs responsabilités spécifiques et de rôles spécialisés dans le fonctionnement global de la logistique estalienne. Ainsi, on retrouve les organismes de logistique suivants :

L'organisation de la logistique en elle-même, il faut savoir qu'à chaque opération militaire prévue par l'état-major de l'Armée Rouge, le CLF se charge de sa planification logistique en estimant la quantité de matériel demandé par l'état-major par rapport à ceux actuellement en stock, la quantité de véhicules nécessaires au transport du matériel, la quantité de carburant nécessaire au déploiement du service logistique pour la maintenance des opérations, l'approvisionnement en matériaux d'étanchéité et de pneus, la fourniture de tous les équipements nécessaires aux soldats avant les départs de missions, le listage et l'application des examens médicaux au sein des infirmeries militaires, la préparation des documents de transport et la comptabilité exacte du matériel transporté dans les véhicules (pour éviter le détournement équipé et pour comptabiliser les pertes liées aux combats ou à l'usure afin d'assurer leur futur remplacement), la planification des itinéraires logistiques entre les dépôts logistiques de l'Armée Rouge et la ligne de front, le détournement des troupes nécessaires à la protection des convois (si nécessaire) ou encore les affectations financières que devra payer la Commission à la Guerre pour les frais de maintenance des opérations. C'est pour cela que le CLF est un corps qui compte quasiment exclusivement de la masse administrative lourde, plus la logistique est planifiée et ordonnée d'un point de vue bureaucratique, plus elle est efficace sur le plan comptable. Les chiffres ne mentent pas dès lors qu'on sait s'en servir. Bien sûr, cela ne suffit pas, les logisticiens ne sont pas qu'une masse bureaucratique qui tient les comptes de l'armée comme un expert-comptable, il faut aussi des logisticiens formés sur le terrain qui tiennent compte des réalités opérationnelles, puisse fournir les informations au niveau local pour permettre à la hiérarchie d'avoir une vue d'ensemble sur la logistique de la région et ainsi désigner les priorités logistiques si nécessaire ou en cas d'imprévu.
C'est là que le CMAR entre en jeu. Le CMAR forme dans ses écoles militaires exclusivement des logisticiens (et recrutent des mécaniciens civils (donc souvent des conscrits) pour leur apprendre les composants des véhicules militaires, histoire de ne pas perdre de temps et d'obtenir une main d'oeuvre déjà qualifiée qui n'est pas néophyte dans le domaine) spécialisés dans la gestion des matériaux et de l'entreposage de domaines variés nécessitant des connaissances approfondies sur les besoins de chaque matériel : véhicules à roues, véhicules à chenille, systèmes de communication, armement, électronique, informatique, génie de combat, matériel chimique, matériel stationnaire et alimentaire ; voici les grandes spécialités des écoles militaires lors de la formation des logisticiens, à noter que les logisticiens sont formés à deux spécialisations afin de limiter les effectifs nécessaires dans les unités logistiques en terme de logisticiens. Chaque compagnie de la logistique militaire répond aux ordres du CMAR et est obligatoirement muni de magasiniers et d'un superviseur logistique qui s'assure de la rédaction des rapports logistiques militaires au commandement et au CMAR qui le fait ensuite circuler au CLF. Ainsi, c'est pour cela que le CMAR fait joindre aux unités de commandement des bataillons de première ligne au moins un superviseur logistique du bataillon, un officier chargé du transport et trois responsables respectivement de la planification logistique, du département technique et de la gestion du matériel de guerre. Il est à noter ensuite que les compagnies de soutien des unités de première ligne disposent d'une section technique et d'une section du matériel tous deux gérés par les responsables du département technique et de la gestion du matériel de guerre qui en sont aussi les officiers en chef. Ces sections se chargent de remettre à leur officier responsable des rapports et des registres journaliers sur la tenue du matériel, sa quantité, le taux d'usure de celui-ci, les remplacements nécessaires et les pièces nécessaires à l'entretien du matériel (afin de faciliter l'acheminement ajusté des pièces de rechange). Enfin, en ce qui concerne la protection militaire des convois logistiques, le CMAR ponctionne généralement sur les régiments des Brigades Populaires afin d'assurer la protection des unités logistiques en arrière-garde afin d'éviter de détourner les unités formées aux opérations en première ligne et donc d'assurer une efficacité optimale des unités de première ligne au combat.

Enfin, notez que la plupart des bataillons opérant dans un même secteur géographique déterminé à l'avance par le CLF et matérialisé directement par le CMAR sont sous la dépendance logistique commune d'une unité de logistique commune qui est, en somme, un regroupement géographique de l'ensemble des moyens logistiques des unités qui y sont liées. Généralement situées près des infrastructures stratégiques comme les gares, les autoroutes, les ports ou les aéroports afin de faciliter leur transport et leur rassemblement, chaque unité est un point névralgique de la logistique estalienne. Chaque type de biens est organisé par la suite sous la forme d'une catégorie listée en fonction de l'utilité pratique des fournitures individuelles et du type de matériel qui s'y trouve. Chacune de ces unités sont ensuite reliés à des APS, des bases militaires servant à la fois de garnison pour les petites unités, notamment les régiments des Brigades Populaires, mais également d'immenses entrepôts où sont entreposés la plupart du matériel stocké sorti d'usine de l'Armée Rouge, ces APS sont là pour entreposer le matériel de guerre et le distribuer en fonction des besoins en quelques heures ou jours aux unités qui en ont besoin qui les distribuent ensuite en fonction des besoins locaux. Les APS sont reliés directement à des voies d'infrastructures stratégiques comme les voies ferrées ou les aéroports afin d'assurer le ravitaillement de toute une région si nécessaire. Les APS sont généralement des entrepôts géants, animés par plusieurs milliers de membres du personnel de maintenance de l'Armée Rouge ou d'unités civiles travaillant conjointement avec l'armée dans des entrepôts climatisés afin d'entretenir le matériel et s'assurer qu'il puisse être immédiatement envoyé dans les heures qui suivent vers le front ou les unités nécessitant du matériel de remplacement.
Infrastructures et matériel :
La majorité du temps, il est évident que le service logistique s'appuie sur le réseau de transport de la Fédération en elle-même pour assurer la logistique et la maintenance des unités estaliennes en temps de paix ou dans le cas où l'Estalie est attaquée sur son sol. L'Estalie a l'avantage d'avoir permis à ses forces armées d'utiliser avec une grande facilité son propre réseau de transport civil à des fins militaires et dispose d'un large réseau sur lequel s'appuyer. Beaucoup de mesures ont étés orientées dans ce sens que ce soit le réseau de transport à l'échelle rurale durant le KROMEVAT I qui permet à la fois le déplacement rapide des forces estaliennes en zone rurale grâce aux routes du réseau mais aussi au service logistique de convertir les centres de distribution régionaux à des fins militaires pour réorganiser le système logistique en zone rurale en cas d'invasion du territoire. On peut aussi parler de l'AITI qui a été mise en place après la mobilisation des troupes fédérales en Juin 2014 suite aux incidents frontaliers avec la Kartvélie qui avait entraîné des complications de circulation pour les populations civiles sur les autoroutes du pays. Dès lors, l'AITI a permis à la fois de réguler ce trafic militaro-civil en un réseau distinct, d'aménager les routes pour les forces terrestres et aériennes et d'organiser d'un point de vue militaire le réseau ferroviaire et autoroutier entre les régions estaliennes pour assurer un déplacement rapide et souple pour les forces de l'Armée Rouge. Il faut noter tout de même quelques particularités spécifiques au service logistique estalien.
Le premier est que le CLF a jugé bon d'organiser son réseau logistique aérien sur deux aéroports spécifiques réservés uniquement à un usage logistique militaire : un situé à quelques kilomètres de l'aéroport international de Mistohir et un autre à Fransoviac. Ces deux aéroports, dont le début de construction débutera en fin Juillet 2014, devra assurer principalement la capacité de déploiement aérien à l'étranger et assurer le pont aérien entre les aérodromes militaires des bases militaires estaliennes. En effet, chaque base militaire estalienne dispose au moins d'une piste d'atterrissage viable pour les transports militaires moyens voire lourds afin d'assurer son ravitaillement par voie aérienne qui est la voie la plus accessible et la plus rapide dans les faits. Ensuite, il faut savoir que le CMAR coopère beaucoup avec le génie de combat : le génie de combat est formé pendant plusieurs semaines dans les écoles militaires du CMAR afin d'apprendre la construction de bases militaires avancées en moins de 72 heures (le matériel, que ce soit les tentes, les protections individuelles, les services essentiels comme l'eau potable, sont réfléchis et développés pour être facilement déployables, le génie de combat étant là pour assurer par leur expertise la pose rapide des bases militaires avancées). Le but de ces bases (que l'on nomme aussi FOB's en anglais) est assez simple : assurer une présence militaire locale dans une région hostile reculée disposant de peu d'infrastructures et surtout jouer comme un point névralgique de la logistique et de l'entreposage du matériel sur un point donné en zone hostile et ce, rapidement. Les FOB's sont autant un outil logistique pour les affrontements dans des zones géographiquement difficiles d'accès et hostiles mais aussi un moyen opérationnel sûr d'entériner une présence militaire minimale.
Formation :
Il est évident que les logisticiens, au-delà de l'apprentissage dans les écoles militaires du CMAR, seront employés à s'entraîner régulièrement avec les unités de première ligne lors de jeux de guerre afin d'apprendre à gérer l'aspect logistique des conflits de basse à haute intensité face à des tactiques ennemies diverses et de jouer l'adaptabilité afin de rendre le système logistique estalien à la fois imparable et résilient aux tentatives de sape de l'adversaire en cas de conflit. Les logisticiens doivent donc s'entraîner à différents scénarios que ce soit l'organisation de la logistique lorsque l'équipe adverse focalise son attention sur la destruction du dit réseau logistique ; l'application du service logistique lorsque les communications sont coupées, les systèmes informatiques en panne ou dans des zones géographiques rudes, etc.

Parmi les thématiques vues dans les jeux de guerre et que le CLF a jugé prioritaire compte tenu des capacités techniques actuelles du service logistique fédéral, certaines ont étés pointées par l'administration comme prioritaires : l'alimentation suffisante en électricité des camps de base et du chauffage, le stockage adéquat des fournitures alimentaires et la fourniture en réfrigérateurs portables sur le terrain, la pose des cuisines de campagne, la fourniture de services de blanchisserie et de toilettes, l'application des services d'eau potable, l'entretien et la réparation des véhicules et enfin le service des déchets.
Technologies :
La complexité des chaines d'approvisionnement même à l'échelle nationale peut demander une coordination minutieuse qui exige une force administrative importante. Néanmoins, il peut arriver que l'erreur soit humaine ou que tous les facteurs n'aient pas tous étés pris en compte, ce qui peut entraîner des disparités entre les rapports logistiques du CLF et la réalité du terrain. Ces écarts entre les chiffres et la réalité peuvent être minimes et indolores pour les forces armées sur le terrain mais à moyen terme, elles peuvent s'avérer complètement faussées et ainsi donner une fausse évaluation de la force des troupes sur le terrain à l'état-major de l'Armée Rouge au cours des opérations militaires. Il est prouvé, de surcroît, que l'utilisation des outils numériques dans la gestion de la logistique militaire diminue les besoins excédentaires des forces armées, c'est-à-dire les coûts supplémentaires non nécessaires aux opérations militaires qui sont tout de même envoyés en première ligne.
C'est pour cela que le CLF mise beaucoup sur la technologie et l'informatique pour satisfaire ses besoins de planification. Pour cela, le CLF et le CMAR utilisent plusieurs systèmes informatiques comme le système ERP qui gère en temps réel les approvisionnements, les contrats avec les entreprises publiques, les inventaires et les commandes de chaque service logistique affilié au CMAR, le tout permettant une visualisation globale en temps réel des besoins logistiques de l'Armée Rouge et donc en découle une meilleure distribution des ressources militaires par les organes logistiques centraux. De plus, les ressources militaires sont toutes suivies au sein de l'Armée par un système RFID et des codes-barres afin de donner la possibilité de suivre individuellement ou en groupe du matériel militaire et ainsi de repérer potentiellement les anomalies dans la chaîne logistique et donc de corriger rapidement les problèmes logistiques derrière. Le CLF se base aussi beaucoup sur la simulation et la modélisation informatique de la logistique fédérale afin de modéliser différentes configurations de missions et donc de permettre d'anticiper les futurs besoins logistiques dans plusieurs types de situations opérationnelles, le tout permettant d'avoir à la fois une longueur d'avance sur les besoins inhérents des troupes sur le terrain avant même les premiers engagements tout en donnant une meilleure capacité d'ajustement des capacités de transport, des besoins en maintenance et des stocks nécessaires dans les unités logistiques. De nombreux outils et méthodes qui sous-tendent la quatrième révolution industrielle qui se profile sont essentiels à l’amélioration de la résilience de la chaîne d’approvisionnement commerciale et de la logistique. Avec les réseaux d’approvisionnement numériques, il peut être plus facile de réagir et de limiter les perturbations, car ils exploitent davantage d’informations pour faire des choix éclairés en matière de chaîne d’approvisionnement physique et de logistique, comme la production ou le transport. En effet, les réseaux d’approvisionnement numériques peuvent offrir une grande résilience car ils offrent les moyens de limiter la durée des perturbations. Au cœur d’un réseau d’approvisionnement numérique se trouvent le data. Une connectivité accrue offerte par un réseau d’approvisionnement numérique provient de l’intégration d’ensembles du data existant et nouveau au moyen de capteurs et de visualisations graphiques. L’intelligence d’un réseau d’approvisionnement numérique est, en partie, le résultat d’analyses avancées et d’apprentissage automatique pour permettre des opérations proactives alors que l’agilité d’un réseau d’approvisionnement numérique découle d’une meilleure prise de décision à l’aide de l’IA et d’algorithmes d’optimisation. La maintenance peut également être facilitée en plaçant le data au centre de l'attention. Par exemple, pour assurer une maintenance de haut niveau, comme la réparation d’un radar sur site plutôt que dans l'atelier logistique du CMAR, il faut savoir ce qui doit être réparé, où se trouvent les ressources pour effectuer les réparations et les moyens de connecter les deux en temps réel. Cela nécessite également des outils, comme la réalité augmentée ou la fabrication additive, qui permettent au personnel de tirer parti de la télémaintenance. Les installations de dépôt connectées par le biais de données peuvent également atténuer les vulnérabilités en aidant les forces armées à comprendre où se trouvent les fournitures et à les distribuer pour minimiser les effets d’une attaque ennemie. La fabrication avancée, qui repose également sur les données, peut permettre aux forces armées de produire davantage de ce dont elles ont besoin, au moment et à l’endroit où elles en ont besoin.
Posté le : 23 oct. 2024 à 20:41:14
Modifié le : 19 sep. 2025 à 21:10:45
25903

L'Armée de la Fédération des Peuples Estaliens, aussi nommée plus amicalement l'Armée Rouge, est divisée en deux branches principales : l'Armée Rouge (éponyme de l'armée dans son ensemble) qui représente les forces terrestres de la Fédération et l'Armée de l'Air Rouge qui regroupe les forces aériennes de l'armée estalienne. Les deux branches disposent de leurs propres états-majors et de leur propre cursus de recrutement et hiérarchique mais disposent d'un corps interarmées qui est une structure qui rassemble ces deux branches lors des opérations communes interarmées (donc pour ainsi dire, la quasi-totalité de leurs opérations). De ce fait, le corps interarmées dispose aussi de son état-major (en somme, l'addition des deux états-majors) et rassemble sous son autorité temporaire les unités qui dépendent à la fois de l'Armée Rouge et de l'Armée de l'Air Rouge. On peut donc se poser la question de savoir qui va diriger les forces anti-aériennes de l'Armée Rouge : est-ce qu'on l'a confie aux forces terrestres étant donné que ces systèmes sont factuellement basés au sol et dépendent à la fois de la protection des unités terrestres mais sont également des vecteurs de protection des unités terrestres contre les opérations aériennes adverses ? Ou doit-on la confier aux forces aériennes afin de coordonner la chasse et la détection aérienne avec les informations données par la défense anti-aérienne ? Ou un mélange des deux ?
Ainsi, la première mesure sera de retravailler la position du SCC nouvellement formé destiné à la sécurité informatique des installations étatiques et militaires ainsi que le contre-espionnage informatique (dont les données sensibles militaires). Au-delà de ça, le renseignement militaire de l'Armée Rouge sera également sous la direction du corps interarmées (son action concrète et sa réforme fera l'objet d'un autre document ultérieurement). Enfin, on retrouve au cœur du sujet les deux autres corps qui vont nous intéresser : le corps de défense rapprochée (CDR) et le corps de défense stratégique (CDS). Il est à noter que les deux disposent d'une mission presque identique, c'est-à-dire la protection anti-aérienne mais les deux corps n'agissent ni sous la houlette des mêmes officiers, ni sur la même étendue géographique. Le rôle du CDR est simple : protéger les forces terrestres au sol des opérations aériennes adverses. C'est concrètement les officiers du CDR qui se chargent de diriger la DCA intégrées aux unités de l'Armée Rouge ainsi que les unités indépendantes sensées couvrir l'ensemble du front et des unités. Le CDR dispose en effet de petites unités indépendantes rassemblées en batteries (qui ne doivent pas dépasser généralement la taille d'un bataillon) qui se répartissent les secteurs géographiques du front. Le but du CDR en répartissant de manière plus indépendante des autres unités est double. Le premier est bien entendu de protéger les unités terrestres sur le terrain en diminuant le nombre de matériel anti-aérien mis à disposition afin de couvrir une vaste zone avec le moins de matériel possible afin de se prémunir d'opérations SEAD d'une part et de condenser la défense anti-aérienne en cas d'imprévu. Le second but est de couvrir une vaste zone dite hostile, proche de la ligne de front, généralement pour éviter les contournements aériens (une force aérienne hostile maline pourrait simplement esquiver les unités terrestres et leur défense pour attaquer ce qui se trouve derrière, donc l'ensemble de la logistique en général) et d'éviter donc les contournements de cibles, les prises à revers et de protéger les zones stratégiques et nécessaires au bon déroulement des opérations terrestres. C'est aussi un moyen de capter les moyens aériens vers la ligne de front et de décharger une partie du travail du CDS en même temps (on préfère davantage que si on doit se prendre une bombe, ça doit se faire en terrain étranger et pas sur le sol estalien, histoire de ne pas exposer les cibles stratégiques de la Fédération elle-même). On notera la structure très décentralisée du CDS qui autonomise grandement ses unités locales : les commandants locaux disposent de prérogatives de protection supplémentaire afin de redéployer si nécessaire leurs batteries dans les zones qui leur convient d'occuper si les commandants locaux estiment le déploiement nécessaire et ce, sans attendre l'approbation du commandement central. Il est à noter que le commandement suprême de ce corps est confié à un général de l'Armée Rouge terrestre et il est secondé par un colonel de l'Armée de l'Air qui est chargé non pas du commandement et de la répartition des batteries mais du renseignement. En somme, le général du CDR est chargé de la répartition des batteries et des opérations de protection en elles-mêmes tandis que le colonel a pour principale charge de collecter les informations fournies par le CDR afin de le fournir à l'Armée de l'Air Rouge afin d'assister la chasse notamment.

Notons enfin que le CDS et le CDR ne sont pas laissées livrées à elles seules. En effet, séparer strictement les deux entités pourrait limiter la synchronisation de la défense rapprochée avec la défense stratégique et pourrait causer de graves problèmes de réactivité en cas d'attaque étendue sur plusieurs zones géographiques ou en cas d'attaque surprise. C'est pour cela que le CDS et le CDR seront sous l'autorité d'un commandement unifié : le Commandement de Défense du Ciel (CDC). Regroupant les commandements des deux corps susmentionnés, ce commandement unifié sera une unité de gestion qui sera chargé de coordonner l'ensemble des défenses aériennes, notamment d'un point de vue géographique et informatif. Ainsi, ce commandement permettra plus aisément de déterminer les zones de protection des deux corps respectifs (ce qui permettra aux deux corps de ne pas empiéter sur la zone de l'autre corps afin d'éviter l'accumulation de moyens sur un seul espace en délaissant très probablement les autres) et permettra en même temps de répondre en temps réel aux initiatives aériennes adverses en ayant un contrôle direct sur les réactions d'un des deux corps ou sur les deux en même temps ; le matériel et les unités des deux corps pouvant changer de commandement, le CDC est là pour faciliter le transfert hiérarchique et redéployer les unités d'un corps pour les besoins de l'autre corps et vice-versa. Le CDC est aussi chargé de disposer au service des deux autres corps une force de réaction rapide. Cette force de réaction rapide, disposant d'unités des Brigades Populaires (donc composés de réservistes), mobilisés en temps de guerre, sont des équipes de réserve chargées de se déployer et d'agir immédiatement aux changements du champ de bataille en cas d'initiative adverse sur le plan aérien. Sous le commandement direct du CDC, les unités de réaction rapide sont donc là pour gérer les imprévus d'une part et renforcer les zones sensibles qui seraient surchargées par des attaques concentriques des forces aériennes adverses.

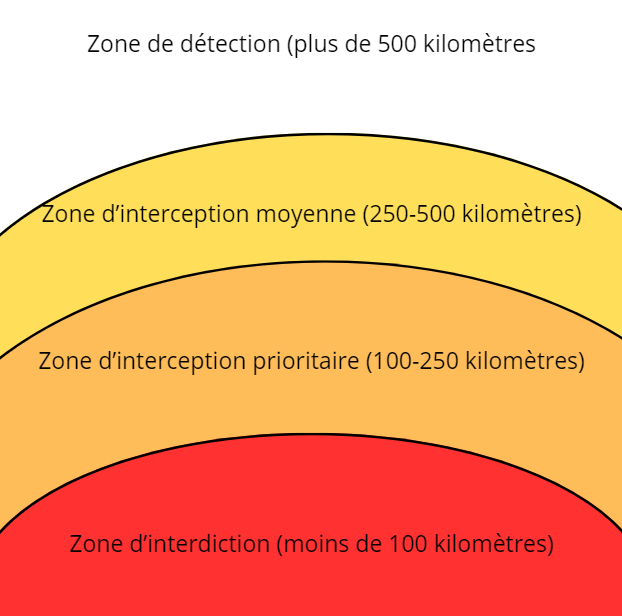
D'autres aspects doctrinaux sont à détailler ici également. En effet, on a parlé précédemment de corridors d'interception. Pour le commandement estalien, les corridors d'interception sont des zones géographiques spécifiques du territoire estalien où les forces aériennes et anti-aériennes ont une plus grande facilité à détecter et concentrer leurs efforts de détection et d'interception des aéronefs ennemis. Cela représente non seulement les rassemblements d'installations critiques mais aussi les zones géographiques faciles d'interception où le relief à basse altitude est peu utilisable en cas d'interception (concrètement, les grandes plaines de l'est de l'Estalie), les routes aériennes les plus utilisées dans un soucis d'économie de carburant en fonction du point de départ, etc. Ces corridors sont privilégiés dans la détection radar mais aussi dans la préparation des pilotes et des opérateurs anti-aériens au sol où des simulations et des scénarios réguliers sont mis en place afin de permettre au personnel d'appréhender la zone d'une part et d'optimiser la protection des lieux. Autre aspect doctrinal : la dissimulation. En effet, ayant quadrillé la totalité de son territoire en fonction de la portée des systèmes et la défense des zones critiques, le CDS dispose par exemple d'emplacements prédéfinis de positionnement des systèmes fixes, souvent des emplacements souterrains assez larges pour accueillir les lanceurs et souvent dans des zones difficiles de repérage comme les montagnes ou les forêts. Il en va de même pour les stations radars. Le but de ces emplacements est d'à la fois protéger les systèmes en cas de mission SEAD (en fortifiant ces emplacements contre les missiles divers tirés en cas de mission SEAD) mais aussi pour simplement cacher la présence ou l'emplacement exact de ces systèmes afin de rendre beaucoup plus difficile la capacité ennemie à supprimer la défense sol-air estalienne. Enfin, il est à noter que chaque batterie estalienne dispose de deux antennes de brouillage mobile qui se situe à proximité des radars de la batterie et une deuxième située en dehors du périmètre de la batterie. L'antenne de brouillage est généralement inactive mais dans le cas de la présence d'un aéronef ennemi dans la zone d'interdiction ou la confirmation du lancement d'un missile en direction de la batterie, l'antenne peut être activée afin de brouiller le signal menant aux radars de la batterie tandis que la deuxième antenne cherche plutôt à attirer dans sa direction le missile attendu, le signal étant porté de façon à ce que le lanceur et les véhicules autour restent loin du lieu d'impact et soient dans l'environnement proche du brouillage.
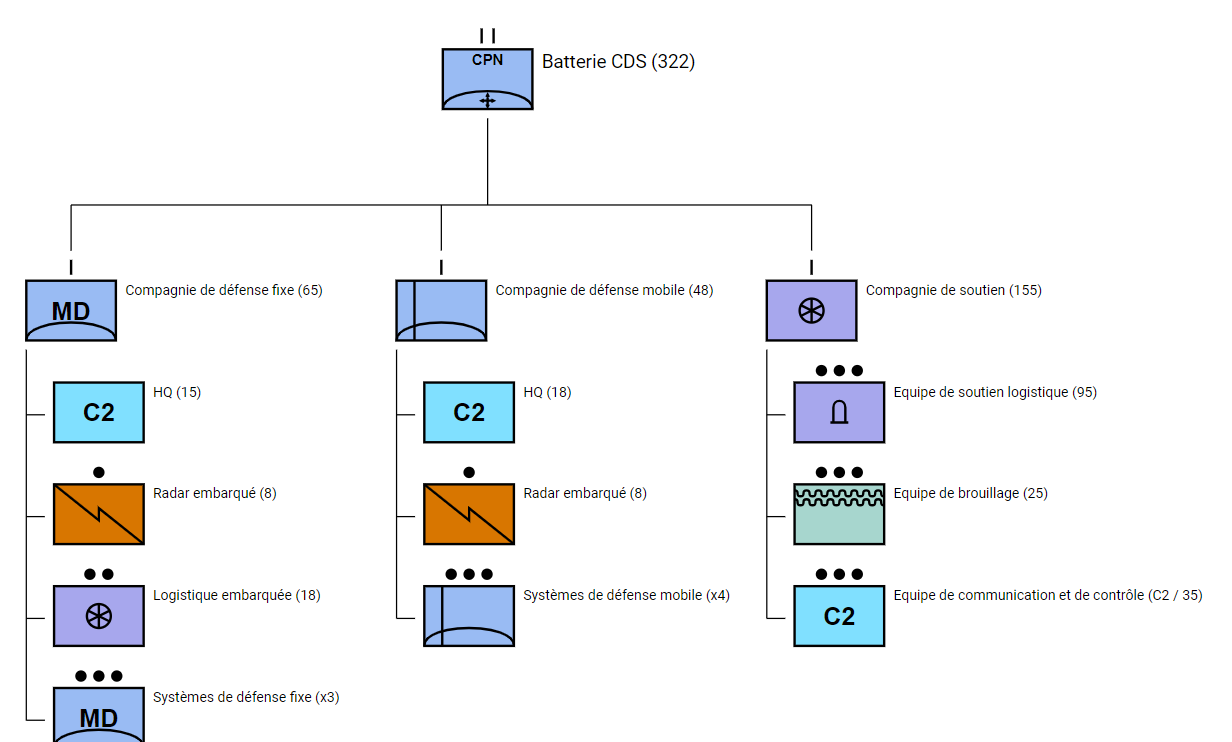
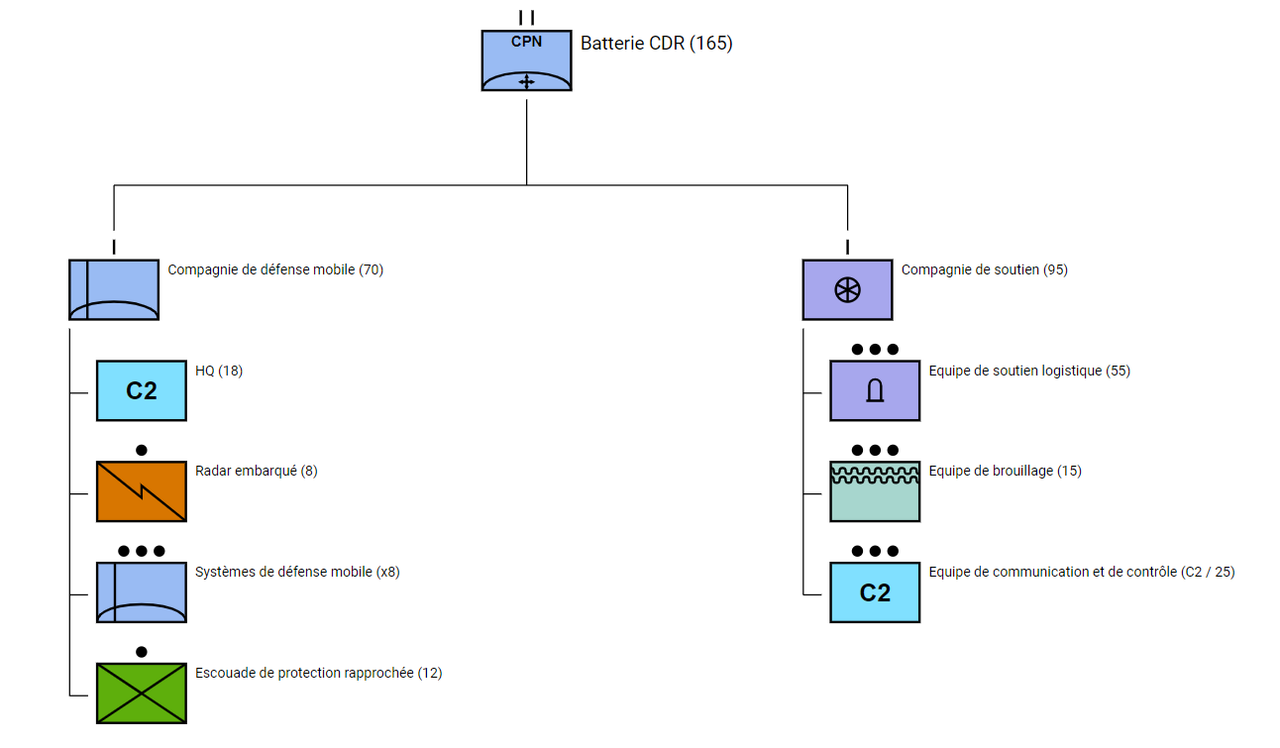
Notez que la batterie du CDR dispose en son sein également d'une escouade de protection rapprochée qui se charge surtout de protéger directement les systèmes en eux-mêmes d'unités terrestres ennemies, même si les batteries ne sont jamais laissées seules en soit, elles disposent toujours d'un embryon d'escouade de sécurité qui assure le périmètre extérieur de la batterie.
Malgré un manque de huit exemplaires actuellement dans les rangs de l'Armée Rouge en ce qui concerne les canons anti-aériens mobiles, la Commission à la Guerre va annoncer pour début décembre 2014 la formation de 10 batteries du CDS qui seront dispatchés sur tout le territoire fédéral (soit un total de 3220 hommes seront envoyés dès la fin de leur formation dans ces batteries) soit 30 systèmes opérationnelles. Dans le même, cinq batteries identiques de réaction rapide seront mises en place au sein des Brigades Populaires comptabilisant 15 systèmes supplémentaires. D'ici le milieu de l'année prochaine, la Commission à la Guerre cherchera un objectif de 25 à 50 bataillons dans le CDS. Quant au CDR, dû au déficit de canons anti-aériens mobiles actuellement dans l'Armée Rouge, 6 batteries seront formées et mis en attente de leur matériel le temps que leur production s'achève soit 825 hommes mobilisés pour le CDR.









Posté le : 01 nov. 2024 à 02:26:53
34877

La restructuration de l'Armée Rouge en tant que force terrestre de choc pouvant mener de larges offensives terrestres sur le terrain ayant été grandement priorisé au cours des derniers mois par la Commission à la Guerre, il a été considéré comme nécessaire de se focaliser désormais sur la branche aérienne des forces armées fédérales, la Commission considérant que même si l'Armée de l'Air Rouge et sa création par le Congrès il y a quelques mois est une bonne chose, nous devons chercher désormais à organiser cette force aérienne conséquente pour qu'elle puisse appuyer efficacement les unités terrestres dans leurs offensives tout en protégeant le ciel estalien. Ainsi, on peut considérer ici que l'organisation de l'Armée de l'Air Rouge va reposer sur plusieurs rôles qui lui seront attribués de manière générale. La première sera évidemment la supériorité aérienne en toute circonstances, autant d'un point de vue offensif comme défensif ; l'Armée de l'Air Rouge doit être en capacité à la fois d'enlever le contrôle des cieux dans n'importe quel espace géographique se situant dans son rayon d'action mais également être en capacité de conserver celle-ci, que ce soit dans le cieux étrangers ou dans le ciel de l'Estalie elle-même, l'Armée de l'Air Rouge devant assurer la permanence de la souveraineté de la Fédération sur son espace aérien. La seconde mission est d'appuyer de quelconque manière que ce soit les opérations terrestres en participant au choix à la neutralisation des moyens de riposte adverses (troupes, infrastructures, logistique) mais également en étant un multiplicateur de puissance supplémentaire à la puissance terrestre de l'Armée Rouge en facilitant ses opérations par l'appui en reconnaissance ou en logistique des unités au sol. Enfin, le troisième rôle confié à l'Armée de l'Air Rouge est celui de la projection des forces de l'Armée Rouge. L'Estalie étant une puissance enclavée ne disposant ni de côtes, ni de flotte, c'est aux forces aériennes d'assurer le transport régulier entre les bases militaires estaliennes basées à l'étranger et la Mère Patrie. En dehors de ses voisins directs, l'Armée de l'Air Rouge doit être en capacité d'assurer la continuité des opérations à l'étranger et doit être en capacité de frapper des cibles lointaines qui pourrait compromettre la sécurité nationale ou menacer les intérêts estaliens dans la région. L'Armée de l'Air Rouge doit donc agir à la fois comme une force de projection logistique, comme le tenant du maillage neuronal que doit constituer à terme la présence militaire estalienne à l'extérieur de son territoire mais également une force de frappe stratégique capable d'étendre suffisamment loin son rayon d'action afin d'éliminer préventivement certaines menaces.
Au-delà de son organisation, la formation des pilotes est essentielle dans la stratégie aérienne globale, les pilotes en vol devant gagner en expérience durant les périodes de paix et mettre en pratique leurs heures de vol en temps de guerre. De ce fait, le pilote doit être aussi capable d'être autonome dans son fonctionnement et indépendamment du commandement central, doit pouvoir improviser dans des situations critiques. Le métier de pilote nécessite de l'initiative et de l'autonomie en grande partie tout en étant capable d'une remarquable coordination avec ses collègues, sans oublier que les pilotes doivent être formés à la survie en terrain hostile en cas de crash en terrain ennemi afin que les pilotes ne deviennent des sources de renseignements potentiels pour l'adversaire. Enfin, nous devons faire en sorte que l'organisation de l'Armée de l'Air puisse être supportée par un ensemble logistique cohérent et organisé capable de répondre aux besoins immédiats de maintenance et de réparation des aéronefs et de réarmer en peu de temps ces derniers afin d'effectuer, en temps de guerre, une plus importante fréquence de sorties dans le cadre d'une campagne aérienne soutenue qui exige en elle-même un grand nombre de sorties en un espace de temps étroit et court, d'où la nécessité de tenir la cadence de ces sorties par la logistique et la maintenance.
Organisation :
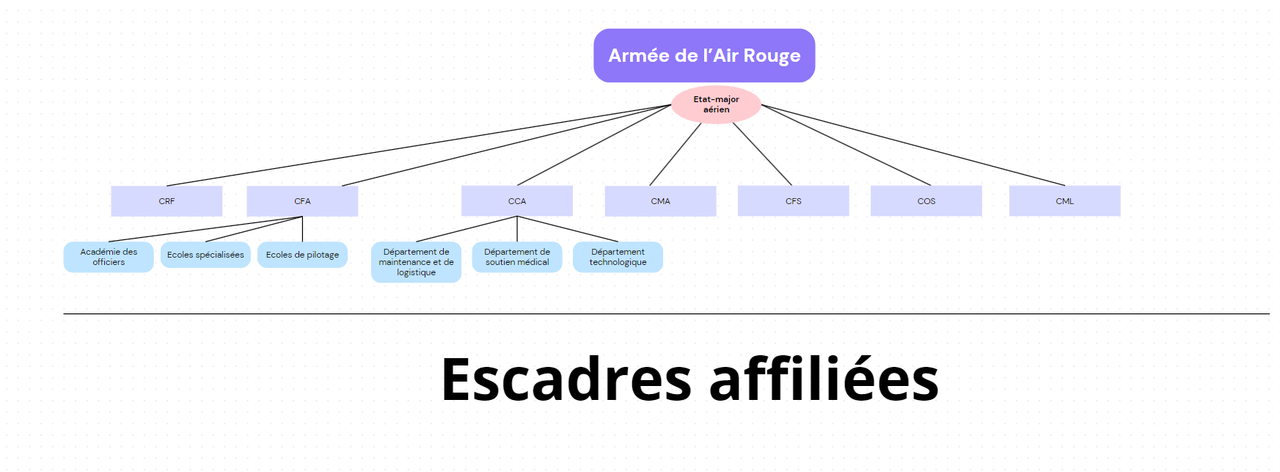
Afin de comprendre l'organisation de l'Armée de l'Air Rouge, nous allons partir du sommet de la hiérarchie militaire avant de progressivement défiler vers le bas afin que l'on puisse comprendre exactement le rôle de chaque organe. Tout d'abord, au sommet de la hiérarchie de l'Armée de l'Air Rouge, on retrouve l'état-major de l'Armée de l'Air Rouge dont le quartier-général est basé à Mistohir et qui sert de siège à toutes les grandes décisions stratégiques de l'Armée de l'Air Rouge et elle donne ses recommandations budgétaires et politiques à la Commission à la Guerre. Recevant un budget propre auprès de la Commission à la Guerre, elle gère également les décisions budgétaires des forces aériennes. L'état-major aérien estalien est dominé par deux grandes figures : le secrétaire aux forces aériennes (SFA) qui est nommé par le Commissaire à la Guerre et qui est un civil qui est chargé de gérer les questions administratives, politiques et financières de l'Armée de l'Air Rouge au nom de la Commission à la Guerre. La deuxième figure n'est autre que le Maréchal de l'Air, officier supérieur le plus élevé de l'Armée de l'Air Rouge qui supervise la formation et la préparation opérationnelle de l'Armée de l'Air Rouge. Il est secondé d'un vice-maréchal. De ce fait, ces deux figures sont à la tête de deux directions principales : le secrétariat et le commandement militaire respectivement. L'état-major aérien a plusieurs fonctions mais elles consistent en somme à gérer la politique de défense aérienne globale de l'Armée de l'Air Rouge à établir les objectifs stratégiques et les priorités militaires à court, moyen et long terme et à planifier les missions et les opérations. C'est également l'état-major aérien qui alloue le budget aux commanderies principales (on y reviendra) en évaluant les besoins financiers liés à la modernisation des infrastructures, le développement technologique ou la formation du personnel. C'est également l'état-major aérien qui collabore avec les institutions industrielles et supervise avec elles l'innovation et la recherche de nouvelles technologies aéronautiques, c'est l'état-major qui coordonne la quasi-totalité des programmes de recherche avec les entreprises publiques ou les instituts universitaires. L'état-major se charge également de la politique de recrutement, de formation, de déploiement et de gestion du personnel. Enfin, l'état-major aérien dispose à son gré du pouvoir de définir les doctrines militaires, les règles d'engagement et les standards d'opérations de toutes les unités de l'Armée de l'Air Rouge que ce soit dans les domaines du commandement, des opérations aériennes ou des opérations conjointes avec d'autres branches de l'Armée Rouge. Enfin, il est à noter que l'état-major comprend en son sein plusieurs bureaux et départements spécifiques : un bureau de planification et développement stratégique (pour les plans de modernisation à long terme du matériel de l'Armée de l'Air Rouge), le bureau d'opérations (chargé de coordonner les opérations courantes comme les déploiements, les exercices ou les réponses aux crises urgentes), le bureau du renseignement (chargé de coordonner les activités de renseignement et de reconnaissance de l'Armée de l'Air Rouge, ce bureau est en étroit lien avec le SRR), le bureau de cybersécurité (chargé de la sécurité numérique et de l'innovation technologique informatique des outils aéronautiques et terrestres de l'Armée de l'Air Rouge, ce bureau est généralement affilié au SCC qui s'assure de la formation de son personnel) et un département juridique (qui est surtout chargé d'élaborer les règlements disciplinaires, de gérer la police militaire et d'encadrer légalement les activités de l'Armée de l'Air Rouge).

Plus bas dans la hiérarchie, on retrouve les commanderies principales. Les commanderies principales sont des grandes structures organisationnelles dans l'Armée de l'Air Rouge chargé d'une mission spécifique ou plus rarement d'une région géographique précise (dans ce cas, ces commanderies sont créées de façon temporaire pour répondre à un besoin immédiat de l'Armée de l'Air Rouge, il n'existe pas concrètement de commanderies principales affiliées à une zone géographique bien spécifique). Chaque commanderie principale a pour mission de s'assurer de la gestion, de l'entraînement et de l'équipement des forces sous son commandement selon les objectifs que lui a fixé l'état-major aérien. Chaque commanderie principale dispose donc de ses propres unités, escadres et bases ainsi que de son propre quartier général pour coordonner et exécuter les opérations liés à son domaine dédié. Voici la liste de chaque commanderie principale :






Chaque commanderie principale dispose de plusieurs escadres en son sein. Une escadre est une unité aérienne intermédiaire, c'est l'unité de base la plus importante en effectifs de l'Armée de l'Air Rouge capable de remplir des missions de façon indépendante et autonome et d'assurer une fonction bien spécifique. Chaque escadre est dirigé par un colonel de l'air et sont divisés en plusieurs groupes qui possèdent eux-mêmes plusieurs escadrons qui eux-mêmes contiennent des escadrilles. Dans la dénomination militaire estalienne, on divise les escadres en plusieurs types, eux-mêmes divisés en sous-types. Ainsi, on divise les escadres de l'Armée de l'Air Rouge en trois types : les escadres opérationnelles, les escadres spécialisées et les escadres expéditionnaires. Les escadres opérationnelles sont des escadres permanentes chargés de missions de combat ou de support direct au combat, c'est la force la plus offensive qui soit dans l'Armée de l'Air Rouge. Ces escadres opérationnelles peuvent se diviser en trois sous-types : les escadres de chasse (conçus pour la supériorité aérienne, la frappe aérienne ou l'escorte), les escadres de mobilité (conçus pour le transport aérien ou le ravitaillement en vol) et les escadres de bombardiers (conçus pour le bombardement stratégique). Ensuite, on retrouve les escadres spécialisées qui se chargent de missions bien spécialisées comme la formation, la surveillance ou la logistique. Là aussi, on retrouve parmi les escadres spécialisées deux sous-types : les escadres de formation (chargés de gérer les programmes de formation de pilotes, ils mettent sur pied des aéronefs d'entraînement pour les pilotes et sont responsables des nouvelles recrues et de leur formation) et les escadres de reconnaissance (chargés de la collecte et l'analyse de renseignements pour appuyer les opérations militaires, utilisant donc plus globalement les drones de reconnaissance et les avions ISR pour la surveillance des théâtres d'opérations). Enfin, dernier type d'escadre, ce sont les escadres expéditionnaires qui sont des escadres temporaires formés pour répondre des déploiements spécifiques ou des crises urgentes, ce dispositif étant mis en place par principe pour les unités aériennes de la CFR et donc pour les unités de réserve n'ayant pas d'unités permanentes de référence et devant créer de nouvelles escadres de façon temporaire pour remplir une mission déterminée. Une fois la mission achevée, si la crise est résolue, l'escadre est dissoute.
Notez qu'il n'existe pas d'escadres de maintenance dans l'Armée de l'Air Rouge, la composition interne des escadres en elles-mêmes les rendent pleinement autonomes d'un point de vue logistique et de la maintenance, le CML se charge uniquement de mobiliser des moyens terrestres pour acheminer le matériel aérien dans les bases estaliennes et forme au mieux des escadres expéditionnaires de mobilité pour approvisionner les bases à l'étranger. En effet, pour une escadre, celle-ci est pleinement autonome et est justement faite pour être détachée du corps aéronautique principal en cas de problème logistique ou de frappes aériennes ennemies sur le sol estalien ou sur ses bases aériennes. Ainsi, l'escadre se compose de quatre groupes : un groupe d'opérations, un groupe de maintenance, un groupe de soutien et un groupe médical. Le groupe d'opérations reste le coeur même de l'escadre, c'est ce groupe qui continent les escadrons de vol chargés des opérations principales de l'escadre, le groupe se divisant ensuite en escadrons spécialisés en fonction du type d'escadre. Le groupe de maintenance est responsable de l'entretien des aéronefs et de l'équipement de la base et s'assure de la disponibilité de vol de chaque appareil, il est divisé en plusieurs escadrons de maintenance (qui assure les réparations et la maintenance de routine et des escadrons de support technique (pour la gestion des pièces détachées, les diagnostics des appareils ou les réparations et la maintenance d'urgence). Le groupe de soutien s'assure du soutien logistique en lui-même en dehors de la base avec des escadrons de logistique et de transport (terrestre ou aérien), un escadron de sécurité pour la protection au sol de la base, un service de gestion des infrastructures (comprenant notamment tout ce qui est lié à la gestion des bâtiments et au génie civil) et des services personnels (logements, restauration, hygiène, etc.). Enfin, le groupe médicale fournit le soutien médical à l'escadre en s'assurant de la bonne condition physique et mentale des pilotes, il se divise généralement en deux escadrons : un escadron de soins primaires (qui assure le suivi physique et psychologique des pilotes) et l'escadron de soutien médical qui se charge des soins d'urgence et les soins spécialisés pour les blessés (il peut arriver que cet escadron soit mieux équipé, notamment par des hélicoptères, et soit envoyé sur le front pour effectuer des missions aéromédicales pour évacuer les blessés sur le terrain, cet escadron n'est pas uniquement réservé au personnel des escadres auxquelles elles appartiennent bien entendu).
On peut également parler des escadrons qui est l'unité de base fonctionnelle de toute bonne escadre qui se concentre sur une mission spécifique et compte généralement 100 à 300 membres, dirigés par un lieutenant-colonel et comptant généralement entre 10 à 24 appareils en fonction des moyens de l'Armée de l'Air Rouge et de la mission de l'escadron.

Organigramme actuel :
Au moment où la réforme de l'Armée de l'Air Rouge a été effectuée, celle-ci dispose dans son parc aérien de trente avions de chasse, dix avions d'attaque au sol, neuf avions de transport tactique et deux avions de guerre électronique. De ce fait, l'organisation actuelle, en tenant compte de l'organisation nouvellement mise en place de nos forces aériennes, s'organise comme ceci :
En total, en comptant le personnel de l'état-major, les escadrons de sécurité et le personnel auxiliaire, on atteint un total de 800 hommes.
Logistique, entraînement et R&D :
Afin de pouvoir renforcer les opérations aériennes en elles-mêmes, nous devons être en capacité de gérer en amont ce qui permet concrètement aux forces aériennes de mobiliser des forces technologiquement supérieures, professionnelles et surtout bien armées, entretenues et équipées. Cela passe par trois principes fondamentaux que sont le réseau logistique, la formation des pilotes et du personnel de maintenance et la R&D. Dans un premier temps, nous devons envisager la mise en place d'infrastructures de soutien logistique adéquats pour l'Armée de l'Air Rouge. Etant donné que contrairement aux besoins des forces terrestres qui nécessitent une force logistique centralisée concrète, l'armée de l'air doit disposer d'une grande mobilité et une rapidité d'intervention aussi foudroyante que possible. Dès lors, centraliser le système logistique n'a que peu de sens car cela nécessiterait pour les aéronefs d'être envoyés dans des centres de maintenance centralisés, c'est du délai de déplacement en plus qu'on ne peut pas se permettre dans une guerre aérienne, il faut donc au contraire complètement décentraliser les capacités de maintenance et de réparation de l'Armée de l'Air Rouge. Pour cela, chaque base disposera non seulement des escadrons de maintenance habituels capables d'effectuer des réparations de premier et de second niveau sur les aéronefs mais celles-ci seront équipées de modules de maintenance mobile. Les modules de maintenance mobile de l'Armée de l'Air Rouge sont des unités de maintenance autonomes conçues pour effectuer des réparations rapides sur les aéronefs et autres équipements directement sur le terrain, sans nécessité de retourner directement à une base fixe. Ces modules sont de fait extrêmement utiles pour maintenir la disponibilité opérationnelle élevée des aéronefs de nos forces aériennes, ce qui accroît ainsi leur disponibilité d'une part mais aussi l'accroissement du nombre de sorties envisageables sur un lapsus de temps relativement court dans des opérations aériennes très soutenues. Chaque module de maintenance mobile, dont plusieurs exemplaires seront fournis aux escadrons de maintenance sur chaque base, comporte plusieurs équipements que ce soit des équipements de diagnostic portatif (scanners et outils de diagnostic de vol, de motorisation, d'hydraulique et d'avionique, outils de diagnostic informatique), des stocks de pièces de rechange courantes (composants de moteurs, câbles, circuits électroniques, joints hydrauliques, éléments de fixations) ainsi que du lubrifiant, du carburant, des batteries de secours, des bouteilles d'oxygène, des outils et des machines avec des outils spécialisés ou des machines de levage et de déplacement, des générateurs d'électricité (notamment en cas d'absence d'alimentation locale) des stations de communication portable (pour conserver le contact entre le commandement et les équipes logistiques), des tentes de maintenance (contre les intermpéries), etc. Notons que plusieurs types de modules seront à disposition des escadrons de maintenance que ce soit des modules légers pour les entretiens de premier niveau (remplacement de pièces mineures, diagnostic des pannes) ou des modules lourds pour les réparations structurelles plus importantes, à noter que ces modules sont déplacés en camions ou en fourgonnettes pour faciliter le déplacement dans la base et assurer la récupération aisée des équipements par les mécaniciens.

Il est à noter que la logistique en terrain hostile est aussi nécessaire. On peut en effet se douter que le modèle logistique des bases aériennes prises à l'étranger, que ce soit des territoires conquis ou des bases militaires à l'étranger, ne soient pas similaires au modèle estalien et il peut arriver que concrètement, sur le terrain, la logistique ne suive pas si les forces aériennes souhaitent exploiter les bases aériennes nouvellement prises à l'ennemi. C'est pour cela que le CML garde aussi en stock une arme imparable en terme de suivi logistique en territoire ennemi : les bases avancées de soutien logistique (BASL). Les BASL sont des installations logistiques temporaires conçues pour fournir un soutien opérationnel rapide aux unités aériennes proches de zones de conflits ou en zone de déploiement afin de maintenir l'autonomie logistique des forces aériennes locales tout en réduisant les délais d'approvisionnement et en assurant une maintenance directe et localisée, sachant que le matériel obtenu dans ces BASL sont faits pour être aérotransportables, ce qui signifie que le matériel d'une BASL peut théoriquement être largué par parachute dans une zone choisie pour que le génie au sol aménage en peu de temps la BASL au profit de l'Armée de l'Air Rouge. En plus d'ateliers modulaires (souvent similaires aux modules mobiles), les BASL disposent d'hangars temporaires (structures gonflables ou tentes renforcées) pour abriter le matériel des intempéries ainsi que de véhicules utilitaires aérotransportables comme des chariots ou des équipements de levage pour faciliter la manutention des pièces lourdes et du matériel. La logique du BASL en territoire hostile s'applique en somme sur la plupart d territoire estalien. En effet, en cas de campagne aérienne à notre encontre, il faut éviter à tout prix que l'ennemi puisse s'en prendre directement à nos capacités logistiques car l'affrontement dans les cieux ne se limite pas aux pertes obtenues dans les combats aériens mais dans la capacité de l'adversaire à empêcher l'ennemi à se relever. De ce fait, le système logistique est, dans une campagne aérienne défensive, la colonne vertébrale de toute stratégie aérienne défensive. Pour cela, le stockage des ressources logistiques ne doit pas s'effectuer directement dans les bases aériennes mais bien dans plusieurs sites dispersés, austères, souvent proches des autoroutes (notez que l'AITI se charge depuis Juin 2014 à aménager les routes estaliennes pour en faire des pistes d'atterrisage, il est donc évident qu'une partie de ces sites de stock logistiques soient proches de ces pistes d'atterrissages afin de pouvoir approvisionner en vitesse les aéronefs).
La logique de la logistique estalienne s'appuie sur deux concepts clés. Le premier, on l'a vu, c'es le concept de déploiement opérationnel agile (DOA) qui encourage en somme la logistique estalienne à disperser ses forces et à utiliser des moyens mobiles afin de rendre son maillage plus imprévisible pour l'adversaire tout en conservant une flexibilité importante et une rapidité accrue dans la maintenance et la soutenabilité de la logistique face aux opérations aériennes de haute intensité. Le deuxième concept clé, c'est celle de la logistique persistante : Posture, Sense, Respond. En somme, Posture signifie une préparation stratégique proactive en prévoyant des équipements et des installations capables de résister à des environnements contestés avec des bases et des équipements prépositionnés, cette approche nécessitant donc aussi l'usage de mesures défensives (sécurisation physique des infrastructures, fortification et durcissement des infrastructures, camouflage) ainsi qu'une plus grande accentuation de la polyvalence dans la formation des logisticiens de l'Armée de l'Air Rouge. Le principe de Sense est de viser l'intégration de technologies pour obtenir une prise de conscience en temps réel des besoins logistiques pour l'état-major, cela comprenant des réseaux de capteurs, l'utilisation de l'intelligence artificielle (à terme) et l'utilisation d'une architecture de données interconnectée afin d'émettre une réaction rapide du commandement. Enfin, le principe de Respond est de prévoir une capacité de réaction rapide de l'Armée de l'Air Rouge pour soutenir les besoins opérationnels dans des environnements incertains que ce soit grâce à des systèmes de distribution flexibles, des capacités de déploiement mobile ou des réseaux de soutien locaux. Enfin, dernier point de détail, la logistique cherchera à se doter d'imprimantes 3D afin d'user de la technologie de la fabrication additive afin d'éviter la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement.
Ensuite, vient la partie de la formation et de l'entraînement du personnel de l'Armée de l'Air Rouge qui se veut le plus complet possible et aussi rigoureux que possible. La formation au sein de l'Armée de l'Air Rouge se divise en plusieurs étapes qui permet non seulement de former les pilotes et les équipages qui ont nécessairement besoin d'être composés uniquement de professionnels de personnes hautement qualifiés mais aussi du personnel de maintenance, du soutien logistique et du commandement et des communications. Vient tout d'abord la formation de base qui se déroule durant huit semaines sur la base de Barakov, non loin de Mistohir, visant principalement à inculquer les principes fondamentaux de la vie militaire (discipline, condition physique, compréhension des consignes de sécurité), une formation de tir et de maniement des armes, un apprentissage aux tactiques de survie, une formation aux premiers secours ainsi qu'une introduction à l'aéronautique. Une fois la formation de base de huit semaines achevée, les recrues sont envoyés dans différentes écoles de spécialisation détenues par l'Armée de l'Air Rouge en fonction de leurs futures spécialités. En dehors des pilotes, on trouve des écoles de spécialisation pour la maintenance aéronautique, le renseignement, le contrôle du trafic aérien ou la cybersécurité (même si cette dernière ne relève pas directement des institutions éducatives détenues par l'Armée de l'Air Rouge mais des institutions du SCC). Cette formation technique, pour les non-pilotes, dure entre quatre à douze mois en fonction de la spécialité et est ouverte aux conscrits.

En ce qui concerne les pilotes, c'est tout de suite plus ardu. Les futurs pilotes sont envoyés dans des écoles de pilotage (actuellement celles de Mistohir et de Fransoviac) où ces derniers suivent un programme d'entraînement intensif de 52 semaines. Ce programme d'entraînement se déroule en trois phases. La première, qui dure six semaines, consiste en une formation académique et préparatoire assez classique où les élèves pilotes suivent des cours académiques couvrant les principes de l'aérodynamique, la météorologie, la navigation ou les procédures de sécurité en vol ainsi que des instructions sur le fonctionnement des systèmes avioniques et les bases de la communication radio. Dès cette première phase, les élèves doivent passer une grande partie de leur formation dans des simulateurs de vol pour se familiariser avec le cockpit et les procédures de vol afin de leur apprendre les commandes de base sans risque. La deuxième phase dure 22 semaines et s'effectue plutôt sur des avions d'entraînements, principalement des avions à hélice obsolètes conçus pour les manœuvres de base. C'est durant cette phase que les pilotes apprennent les fondamentaux du pilotage comme le décollage, l'atterrissage et les manœuvres de base comme les virages ou les changements d'altitude. Une fois que les élèves maîtrisent les bases, ils effectuent des vols en solo pour renforcer leur autonomie. Ils s'entraînent également aux manœuvres d'urgence et sont formés aux procédures d'urgence en cas de panne moteur, de perte de contrôle ou d'autres incidents techniques critiques. Enfin, la troisième phase est celle du perfectionnement et de la spécialisation et dure 24 semaines, les élèves sont sensés choisir au début de cette phase la spécialisation qu'ils souhaitent choisir en fonction de leurs performances mais aussi en fonction des besoins de l'Armée de l'Air Rouge : les pilotes peuvent donc choisir de se spécialiser dans des avions de chasse ou dans des avions de transport (le combat ou le soutien en somme). Dans les deux cas, les pilotes passent sur des entraîneurs adaptés à turboréacteur (bimoteur pour les pilotes de soutien) et sont donc entraînés avec ces nouveaux entraîneurs à pratiquer des commandes de vol avancés et des manœuvres plus complexes et des techniques plus spécifiques à leur spécialisation (combat aérien pour la chasse, vols de formation et atterrissage de précision pour les transporteurs par exemple). Les futurs pilotes de chasse sont particulièrement entraînés à s'exercer des manœuvres tactiques lors de combats aériens fictifs, à pratiquer le tir de précision ou à maintenir des formations de vols. Les pilotes de transport et de soutien s'entraînent davantage au ravitaillement en vol ou aux missions de largage. Il est à noter que les écoles de pilotage se servent abondamment des simulations immersives, les élèves passent plusieurs heures dans des simulateurs d ehaute-fidélité pour s'entrainer à des scénarios de mission réalistes comme des combats aériens ou des missions de ravitaillement. Certains simulateurs de l'Armée de l'Air Rouge incluent des environnements de guerre multi-domaines incluant des notions de cybersécurité, de guerre électronique ou de coordination avec d'autres unités au sol, ces notions étant apprises durant le cursus de formation du futur pilote. Une fois ces trois phases passées, la version officielle veut que les pilotes reçoivent leurs ailes et sont officiellement pilotes au bout de ces 52 semaines ; la vérité est qu'avant d'intégrer pleinement leur unité opérationnelle, les pilotes doivent suivre une quatrième formation de qualification sur l'appareil qu'ils piloteront en mission, cette formation pouvant durer entre plusieurs semaines et plusieurs mois en fonction de la complexité de l'avion et de la mission. En dehors de la formation en elle-même qui permet d'accéder au rang de pilote, il faut noter que la formation se poursuit tout au long de la carrière du pilote avec la mise en place de programmes de perfectionnement formant les pilotes au rôles de commandement, d'instructeurs de vol ou de spécialisation avancée (que ce soit dans le combat aérien ou dans les opérations de guerre électronique par exemple), l'entraînement des pilotes reste multi-domaines dans un sens étant donné qu'elle essaie d'être aussi polyvalente que possible. La formation continue des pilotes s'organise de ce fait en modules différents et l'Armée de l'Air Rouge fait régulièrement attention de faire suivre plusieurs modules à ses pilotes. Généralement, en modules, on retient généralement les modules d'entraînement en conditions extrêmes afin de renforcer la résilience des pilotes et des équipes de maintenance (qui ne sont pas épargnés par ces modules bien entendu) aux conditions climatiques difficiles ; les modules de flexibilité opérationnelle afin de faire intégrer aux pilotes les réflexes de prises de décisions rapides et de tactiques d'adaptation en temps réel ; les modules de cyberdéfense (gérés par la SCC ici) pour permettre aux pilotes de comprendre les principes de protection informatique des systèmes embarqués contre les attaques potentielles ; les modules dits de Mission Command afin d'encourager en opération l'initiative individuelle et le commandement décentralisé afin de permettre aux commandants subalternes en cas de rupture de communications de prendre des décisions indépendantes afin d'atteindre les objectifs opérationnels fixés et ce peu importe les perturbations sur le terrain. De façon régulière, il est donc aussi évident que l'Armée de l'Air Rouge organise régulièrement des exercices de simulation de combat afin d'entraîner les équipages aux situations de combat en intégrant des missions interarmes afin de développer l'interopérabilité entre les différentes armes de l'Armée Rouge et tester les pilotes en conditions de stress. Pour continuer sur le principe de la formation, l'Armée de l'Air Rouge dispose aussi de son académie des officiers afin de former les sous-officiers et les officiers au leadership, aux tactiques militaires et aux opérations aériennes tout en proposant une fois les formations achevées des programmes avancés de formation en commandement et en gestion pour les officiers de carrière sur la stratégie aérienne, le renseignement ou le développement technologique et les applications concrètes sur le terrain.
En ce qui concerne la R&D, c'est un peu plus simple que ça. Le programme de R&D de l'Armée de l'Air Rouge est mené par le Département Aéronautique de la Commission à la Guerre basé à Mistohir chargé de réunir des experts aéronautiques issus des cadres de l'Armée de l'Air Rouge, des membres choisis de la Commission à la Guerre et les représentants des entreprises publiques spécialisées dans le domaine aéronautique. Ce département vise donc principalement à établir un dialogue entre l'Armée de l'Air Rouge et ses fournisseurs industriels afin que les deux puissent échanger des données vitales au bon fonctionnement des deux parties : l'Armée de l'Air Rouge fournit les données qu'elle récupère de ses expériences, ses combats et ses entraînements en matière de combats aériens et de besoins technologiques sur le terrain ; les fournisseurs industriels proposent quant à eux leurs innovations afin de pallier aux manques opérationnels auxquels l'Armée de l'Air Rouge peut rencontrer sur le terrain. De ce fait, le département fonctionne en même temps comme une sorte d'immense vente aux enchères, l'Armée de l'Air Rouge convoquant régulièrement le département pour un appel d'offres auprès des entreprises publiques et en échange d'une subvention publique, les entreprises publiques sont incités à proposer leur propre solution, celle étant choisie par l'Armée de l'Air Rouge recevant la dite subvention. Pur esprit de concurrence en somme afin de motiver l'innovation technologique en faveur des forces aériennes d'une part et de pallier sur commande aux difficultés opérationnelles de l'Armée de l'Air Rouge par l'innovation technologique.
Posté le : 05 nov. 2024 à 19:32:26
8510

Afin de préparer les forces actuelles de l'Armée Rouge à combattre dans des conflits de haute intensité, la Commission à la Guerre a demandé à l'organisation de nouveaux exercices militaires à l'échelle fédérale de l'Armée Rouge afin de préparer à la fois les troupes et leurs officiers respectifs aux conditions d'une guerre à haute intensité et les défis auxquels ils seront confrontés à l'avenir dans des conditions de conflit à large échelle avec une force armée conventionnelle équivalente ou supérieure numériquement et matériellement à l'Armée Rouge. Tel David contre Goliath, l'Armée Rouge doit pouvoir dans des situations d'infériorité numérique et matérielle faire jouer ses avantages que sont l'organisation, la tactique et l'instruction de son corps commandant ainsi que la totalité du maillage militaire en arrière-plan que l'Armée Rouge a pu tisser, notamment en ce qui concerne son réseau logistique qui lui donne un avantage sur l'usure des troupes et sur le taux de remplacement des troupes en première ligne par des unités fraîches, caractéristique essentielle des combats à haute intensité où le taux de pertes en première ligne est souvent élevé. Cet exercice vise donc à préparer d'une telle envergure en simulant des situations complexes de la guerre conventionnelle et asymétrique. L'exercice s'effectuera dans les bases du nord de la Fédération.
Les objectifs de cet exercice sont multiples sur le plan opérationnel. Le premier est l'évaluation de la réactivité des forces estaliennes en testant notamment les capacités de l'Armée Rouge à se mobiliser rapidement et à réduire le plus possible son temps de réponse en cas de situation de crise. Le second objectif sera celui de la coordination interarmes en cherchant à renforcer les processus de coordination entre les différentes branches afin d'en améliorer la synergie tactique et stratégique une fois en première ligne afin que chaque arme complète le travail de l'autre branche et ainsi faire avancer la totalité du plan stratégique mis en place au préalable. Le troisième objectif est évidemment la gestion logistique, cet exercice sera une occasion de mettre à rude épreuve les capacités logistiques estaliennes que ce soit dans l'approvisionnement en vivres et munitions mais aussi la gestion des soins médicaux sur le terrain ou encore la résilience des capacités de communication au sein même de l'Armée au cours des combats ou en cas d'offensive ennemie. Le quatrième objectif, un peu moins conventionnel, est celui de gérer les tactiques de guerre asymétrique et la cyberdéfense nationale en simulant des attaques non conventionnelle à travers la guerre cybernétique, le tout organisé par le SCC. Enfin, l'objectif le plus évident de l'exercice restera évidemment l'évaluation des performances individuelles et collectives des soldats que ce soit l'endurance, la discipline ou la capacité d'adaptation (autant des soldats que de leurs officiers) sur le terrain mais également l'efficacité collective globale des unités, notamment dans des conditions de fatigue et d'usure intense.
Phases de l'exercice :

La première phase de l'exercice (5-7 Janvier) sera une phase de préparation et de briefing global pour les unités afin de fournir aux unités des briefings détailles pour chaque brigade et unités spécialisées afin de les renseigner sur les objectifs stratégiques de l'exercice, les zones cibles des opérations ou encore les règles d'engagement durant l'exercice, des postes de commandement temporaires seront mis en place durant cette phase et la logistique sera chargé de son côté de valider le mieux possible les niveaux d'approvisionnement en munitions, en carburant et en rations pour des simulations aussi réalistes que possible.
La deuxième phase (7-10 Janvier) devra tester principalement les capacités de déploiement rapide et la sécurisation des zones critiques par les unités de l'Armée Rouge en cas de crise majeure. Les brigades motorisées et mécanisées de l'Armée Rouge devront simuler des avancées coordonnées rapides en terrain hostile, devant s'entraîner à sécuriser rapidement les routes et les postes avancés adverses. Les unités de montagne à Bolioska devront se charger d'effectuer des exercices d'occupation en terrain montagneux afin de préparer notamment des embuscades et assurer des voies de repli en terrain plat. Les forces spéciales devront également faire partie intégrante de l'entraînement afin de les entraîner dans un rôle de soutien aux forces de combat conventionnelles dans des opérations de repérage, de sabotage de positions ennemies simulées ou dans la sécurisation de zones à haute valeur stratégique. Enfin, le CDC devra également faire partie de l'entraînement en s'organisant afin de mettre en place une défense aérienne cohérente et rapide en simulant avec les unités de chasse et d'attaque au sol de l'Armée de l'Air Rouge des tentatives d'incursion aériennes adverses, le CDC devant couvrir notamment la progression des unités mécanisées et motorisées et donc doit s'entraîner à sécuriser rapidement les zones prises en quelques heures seulement afin de limiter le plus possible les fenêtres d'ouverture des unités aériennes ennemies en cas d'attaque mécanisée terrestre.
La troisième phase (10-14 Janvier) sera une phase essentiellement défensive, nous permettant d'analyser comment l'Armée Rouge réagit face à une attaque coordonnée ennemie d'une armée conventionnelle hostile. L'Armée de l'Air Rouge, notamment les Sky Reapers et les Steel Eagles devront simuler des missions d'interception aérienne ou des missions de support aérien rapproché en collaboration pour les premiers avec le CDC. Le CDC, justement, devra aussi s'organiser avec les unités de la Garde Populaire qui participeront à l'exercice en simulant la défense du territoire fédéral par des interceptions de missiles ou de drones ennemis avec des entraînements visant exclusivement à savoir rapidement détecter et éliminer des menaces dans le ciel estalien. Chaque brigade de l'Armée Rouge sera engagé dans des exercices de défense territoriale et de protection de points stratégiques, les brigades mécanisées et blindées seront particulièrement sollicités pour tester leurs capacités de défense mobile en utilisant des tactiques de défense en profondeur afin de ralentir l'adversaire en diminuant l'exposition des troupes estaliennes et les pertes en conséquence. Les brigades motorisées seront entraînées à organiser des lignes de défense plus statiques en terrain ouvert afin de s'entraîner à user de la totalité de leur puissance de feu en tant que partie défensive. Les forces spéciales seront chargés de mener des missions de reconnaissance en terrain hostile et de contre-saboter les opérations clandestines et non conventionnelles adverses durant cette période.
La quatrième phase (14-20 Janvier) sera la phase de contre-offensive coordonnée de l'Armée Rouge afin de tester les capacités offensives de l'Armée Rouge et notamment la coordination de ses assauts blindés et du soutien aérien. La 2e Brigade Blindée "Teney" et la 3ème Brigade Mécanisée "Krovi" seront chargés de simuler des assauts blindés sur des positions fortifiées et de percer le dispositif ennemi en utilisant le soutien maximal des chars d'assaut, des transports de troupes et des chars légers le mieux possible. La 1ère Brigade Motorisée "Skinneli" et la 5ème Brigade Motorisée "Agressiya" seront entraînés plutôt à des exercices de percée rapide suivis d'exercices d'occupations temporaires de zones prises à l'adversaire en utilisant notamment les camions comme un vecteur de mobilité accrue en terrain adverse. La 2ème Escadre d'Attaque "Steel Eagles" sera entraîné à effectuer des attaques au sol sur les positions ennemies désignées en mettant en pratique une coordination étroite avec les brigades au sol afin de simuler des frappes précises dévastatrices, l'escadre faisant mine de ne compter que sur les indications au sol pour tirer afin que nous puissions évaluer la capacité des unités de communication à indiquer les cibles précisément aux unités aériennes et aux unités aériennes de frapper là où on leur demande si ces derniers sont aveugles et ne disposent pas de marquage précis au sol. Les forces spéciales, enfin, seront chargés d'effectuer des sabotages en amont afin de désorganiser le dispositif défensif adverse et de créer des brèches afin de faciliter notamment les offensives blindées.
La cinquième et dernière phase (20-23 Janvier) sera principalement une phase d'évaluation post-exercice et de résilience logistique afin d'analyser les capacités de la logistique estalienne à reconstituer les forces en première ligne avec un affrontement de haute intensité.
Note du SRR (confidentiel) : Le programme Zminapohody-S ayant débuté l'année dernière étant bien avancé, l'exercice en entier sera l'occasion de mettre en pratique certaines armes météorologiques mises au point par le SRR, notamment la génération de précipitations et de brouillard dans des buts tactiques précis comme des offensives terrestres ou dans des tentatives de blocage des opérations aériennes ennemies. Des ionosphères artificielles seront mises en place en parallèle au niveau des pays voisins afin d'analyser sur une courte période de quelques minutes l'efficacité de la perturbation des communications militaires et civiles. Le programme de fabrication industrielle de l'octanitrocurbane étant lui aussi bien avancé, nous disposerons de plus en plus de munitions avec ce type d'explosif afin d'en déterminer l'efficacité concrète contre des bases factices utilisées pour l'entraînement et où l'utilisation d'armes réelles sera autorisé, que ce soit pour l'artillerie ou l'aviation notamment.
Posté le : 28 nov. 2024 à 21:03:05
482


Posté le : 11 déc. 2024 à 02:30:03
32111

Suite aux combats de Février en Kartvélie qui représente tout de même le premier engagement armé de l'armée estalienne depuis plus d'un siècle, même si des constatations positives ont pu être établies sur l'état de nos forces armées, notamment sa capacité de déploiement de sa puissance de feu en terrain ouvert et sa réactivité opérationnelle sur le terrain, il est à constater que les combats qui ont suivis le 5 Février n'ont guère mis en valeur l'Armée Rouge et ont plutôt mis en évidence ses défaillances tactiques dans le domaine urbain. Il est normal pour la plupart des officiers de l'Armée Rouge que ces combats ne soient pas extrêmement concluants comme attendus : une armée encore peu expérimentée dans le domaine de la guerre moderne malgré les innovations apportées à l'armée estalienne depuis plus d'un est quelque chose de normal et il est du devoir de la Commission à la Guerre de tirer non seulement des leçons de ces affrontements et de mettre à profit le retour d'expérience de nos troupes et de nos officiers afin d'améliorer à l'avenir les performances militaires de l'Armée Rouge. Nous avons faits l'erreur aujourd'hui mais voyons cela de manière positive : ces défaillances ne seront plus par la suite.
Le conflit en Kartvélie a révélé plusieurs failles de notre armée dans le cadre de la guerre urbaine. Tout d'abord, notre armée n'était pas concrètement prête dans l'instant pour une guerre urbaine : la structure de l'Armée Rouge établie dès 2014 visait principalement à affronter une armée kartvélienne conventionnelle dans un terrain ouvert et était précisément faite pour favoriser une stratégie de choc mécanisé en déployant une puissance de feu localisée et importante sur les points faibles du dispositif ennemi. De ce fait, la neutralisation des moyens lourds de l'armée kartvélienne devait assurer la destruction du moral en même temps, la prise des villes ne devait donc être qu'une formalité dans le plan de bataille estalien, la principale difficulté résidait à la fois sur le plan logistique (comment assurer une continuité de la puissance de feu supérieure de nos troupes sans qu'elles ne tombent trop vite à court de munitions ?) et sur la résistance éventuelle des unités kartvéliennes pouvant disposer d'équipements lourds équivalents à ceux de l'Estalie. Or, ce plan de bataille est devenu obsolète dès lors que la Révolution Brune s'était déclenché, provoquant une intervention précipitée de l'armée estalienne pour sécuriser la prise de pouvoir des révolutionnaires. Nous ne reviendrons pas vraiment sur la prise de pouvoir en elle-même : elle s'est faite rapidement et de façon organisée de la part de nos troupes malgré quelques lacunes logistiques secondaires. C'est ce qui suit qui devient la source de toutes nos préoccupations. En effet, dès les premiers combats urbains, les unités envoyées sur place, pourtant des forces professionnelles manquaient d'expérience et de formation adaptée pour gérer efficacement les combats dans les zones urbaines denses, sans oublier que l'équipement standard dont était équipée la 2e Brigade Blindée n'était pas nécessairement optimisé pour les environnements urbains complexes où la mobilité, la protection contre les explosifs improvisés et la reconnaissance en temps réel sont cruciales. Le second problème qui est rapidement apparu a été la rigidité structurelle du commandement qui s'est avérée trop centralisée dans ce cas de figure : les décisions étaient trop centralisées et la réactivité de nos unités sur le terrain face aux situations évolutives du combat urbain ont étés impactées par cette rigidité tactique de notre corps décisionnaire. De plus, la chaîne de commandement s'avère bien trop lourde. Ensuite, le problème le plus évident auquel nous avons étés confrontés, c'est évidemment le manque de doctrine adaptée au combat urbain et pour cause, la totalité des doctrines auquel les officiers ont eu recours en Kartvélie relèvent de la guerre conventionnelle classique. Certes, cela démontre au moins que nous ne sommes pas démunis face à une armée conventionnelle et l'efficacité de l'enseignement militaire dans le domaine conventionnel mais nos officiers ont complètement omis d'étendre leur attention doctrinale aux spécificités de la guerre asymétrique et des guerres urbaines. Notons aussi l'insuffisance de nos moyens pour gérer les populations civiles locales, rien n'a été fait pour minimiser les pertes civiles et la plupart des évacuations ont étés organisées par les milices révolutionnaires locales elles-mêmes (dont la coordination avec nos propres forces laisse d'ailleurs à désirer). En bref, tous ces problèmes nécessitent une réforme supplémentaire de nos forces.
Les bases de la guerre urbaine selon la Commission à la Guerre :
Pour comprendre les batailles urbaines de la Révolution Brune, il est impératif de comprendre les environnements urbains. Au niveau le plus élémentaire, les environnements urbains sont des incubateurs de destruction – pour les forces militaires, pour les ressources, pour la population civile et pour les infrastructures civiles. Les environnements urbains sont des incubateurs de destruction parce que les rues étroites d’une ville, ses infrastructures denses et ses grandes populations freinent la mobilité tactique, tronquent la capacité d’une force à mener une guerre de manœuvre et augmentent en conséquence la probabilité d’engagements linéaires de destruction méthodique et de combats de position. Les environnements urbains invitent à des guerres et des sièges positionnels. Le terrain canalisant les environnements urbains exige que les forces terrestres, lorsqu’elles sont engagées dans une zone urbaine, opèrent dans une direction généralement déterministe liée à l’emplacement de l’ennemi. En conséquence, le déterminisme dans la bataille urbaine entrave le potentiel de manœuvre tactique par le déni des conditions nécessaires à la manœuvre. Pour la réalisation d’une manœuvre, une force doit être mobile et capable d’avancer rapidement contre un ennemi le long de plusieurs routes. La reconnaissance utile fonctionne comme un point pivot à partir duquel une force de manœuvre se déplace et se bat, à distance, tout en travaillant indirectement à la réalisation de son objectif militaire sur les flancs et à l’arrière de son adversaire. La manœuvre nécessite également des cycles de décision rapides. La vitesse à laquelle une force peut se déplacer à travers les cycles de transition est affectée en grande partie par le nombre de variables qu’elle doit aborder. Les environnements urbains présentent un nombre beaucoup plus important de variables, ainsi que le type de variables, pour qu’une force soit prise en compte. Le nombre et le type élevés de variables ralentissent à la fois la prise de décision et le mouvement, tout en augmentant la quantité et la diversité du travail préparatoire et de la formation environnementale nécessaires pour augmenter les chances de succès. Mis à part la guerre de manœuvre confondante, les environnements urbains contrecarrent les actions offensives vives. Les opérations militaires dans les zones urbaines sont généralement des affaires lourdes parce que la force attaquante doit se déplacer délibérément pour se protéger des dangers qui se cachent sur le terrain complexe d’une ville. Les environnements urbains disloquent les forces armées, en particulier celles qui n’ont pas l’intention de combattre au sein d’une ville. La dislocation est le résultat de rendre la force d’une force militaire non pertinente. La force militaire dépend de deux variables dépendantes : les composantes et les conditions de combat. Les composants sont les outils de guerre : systèmes d’armes, unités, réseaux de communication, systèmes de soutien, ressources et nœuds de commandement. Les conditions sont des environnements et des situations qui favorisent les composantes d’un combattant. La dislocation est positionnelle, fondamentale, temporelle ou morale. La dislocation de position est l’effet obtenu lorsqu’un combattant ne peut pas surmonter les défis du combat dans un endroit pour lequel il n’est pas adapté. La luxation fonctionnelle est la conséquence lorsqu’un combattant est incapable de compenser avec succès le fait d’être forcé de se battre selon une méthode qui ne correspond pas à la façon dont il préfère se battre ou à la façon dont il a été construit, formé et doté des ressources nécessaires pour se battre. La dislocation temporelle est la répercussion générée lorsqu’un combattant est incapable de surmonter le défi associé à l’incapacité d’opérer au rythme qu’il préfère. La dislocation morale est l’effet causé lorsqu’un combattant est incapable de surmonter l’impact déconcertant d’une situation en difficulté. Les formes de dislocation ne sont pas exclusives ; En fait, la dislocation parfaite résulte du fait qu’un combattant est attiré dans les quatre formes du concept. Néanmoins, une dislocation parfaite est difficile à générer. En effet, beaucoup de temps, de ressources et de coordination doivent être réunis pour que les quatre formes de dislocation se matérialisent d’abord, puis se figent dans une situation inexorable. Le plus souvent, la luxation se présente sous une combinaison de deux formes. En plus des problèmes causés aux forces terrestres traditionnelles, le champ de bataille urbain diminue les avantages de l’intégration des forces interarmées. Une panoplie d’avions aériens, de capteurs, de drones de reconnaissance et d’avions aéroportés d’alerte précoce et de contrôle trouvent leur travail beaucoup plus difficile dans les zones urbaines. C’est parce que le terrain physique entrave la surveillance, le ciblage et le taux de réussite des frappes aériennes et terrestres de canons, de roquettes et de missiles de première frappe.

En réfléchissant aux opérations urbaines récentes qui ont eu lieu en Kartvélie, la Commission à la Guerre peut identifier une liste innumérable de conclusions et de recommandations associées. Une synthèse attentive de ces résultats révèle toutefois un ensemble de principes transcendants de la guerre urbaine qui s’étendent à travers les opérations urbaines, indépendamment du conflit, qui sont énumérées ci-dessous. L’épuisement, ou l’incapacité d’un acteur à maintenir une progression tactique, opérationnelle ou stratégique vers son objectif politique ou militaire correspondant, est le thème qui unifie ces principes que sont :
Modernisation des structures de commandement :
Le combat urbain est devenu au fil des années un des environnement les plus complexes et les plus exigeants de la guerre moderne au XXIe siècle entre la densité de la population et de ses infrastructures et les menaces asymétriques qu'un défenseur ou attaquant peut exploiter à son profit. L'armée estalienne doit cependant se rendre à l'évidence : la structure de son commandement actuel et la composition de ses unités reflètent encore une organisation rigide basée sur les guerres conventionnelles qui limite l'adaptabilité et l'efficacité des forces en présence dans les milieux urbains. Il faut donc reconfigurer et moderniser les structures de commandement et débuter la formation d'unités spécialisées afin d'optimiser la réactivité, la coordination et la polyvalence des troupes estaliennes dans les environnements urbains tout en renforçant leur capacité à opérer de façon plus autonome et intégrée dans une structure plus ample encore.
Le commandement estalien va mettre en avant au sein de ses structures une nouvelle doctrine, l'Auftragstaktik (HRP : concept allemand, j'ai pas trouvé de nom académique équivalent) qui est une doctrine qui encourage les subordonnés à agir de manière autonome tout en respectant les objectifs généraux fixés par leurs supérieurs. De ce fait, la doctrine mise en place par les forces estaliennes se repose sur trois principes clés. Tout d'abord, la vision du commandement estalien est axée avant tout sur les objectifs, les ordres détaillés et la planification maximale est délaissée au profit de la définition de l'intention stratégique ou tactique (comme la sécurisation d'une zone ou la neutralisation d'une opération adverse) tandis que les moyens pour atteindre le dit objectif sont laissés à la discrétion des subordonnés. Le second principe est celui de la flexibilité dans l'exécution, les commandements de niveau inférieur adaptent leur approche en fonction des circonstances, ce qui est relativement nécessaire dans la dynamique de la guerre moderne et encore plus dans les conflits urbains. Enfin, le dernier principe garde toutefois l'idée que la responsabilité des résultats incombe donc aux officiers sur le terrain, l'autonomie ne signifie pas la perte de contrôle du commandement, les officiers sur le terrain sont tenus responsables des échecs ou des réussites sur le terrain. C'est dans ce cadre là que les écoles militaires estaliennes seront modernisées et leur système de formation revu pour les officiers et les sous-officiers. Les programmes seront axés sur l'autonomie en leur apprenant à prendre des décisions stratégiques de manière indépendante en anticipant les besoins sur le terrain sans ordres détaillés et en promouvant l'initiative sur le terrain. La hiérarchie stricte telle qu'elle est mise en place dans l'Armée Rouge est abandonnée au profit d'une formation des officiers estaliens à analyser eux-mêmes la situation et à agir sans devoir attendre une approbation hiérarchique stricte, les règlements militaires de l'Armée Rouge qui seront rédigés pour l'édition 2015 devront refléter cette vision doctrinale où la responsabilisation des échelons intermédiaires et l'action prioritaire des officiers et des sous-officiers combattants est mise en avant. L'initiative individuelle devient valorisée et récompensée, les sous-officiers et les soldats révolutionnaires qui agissent de manière proactive sont encouragés au sein de l'Armée Rouge. Ensuite, c'est aux communications de faire la deuxième partie du travail, une doctrine ne s'appuie jamais sur une structure inexistante et ici, c'est bien le secteur des communications qui sera visé par l'Armée Rouge. En effet, les initiatives personnelles et la responsabilisation des officiers sur le terrain peut apporter beaucoup d'avantages concrets, notamment une adaptabilité importante et une imprévisibilité totale aux yeux de l'adversaire (les troupes sur place se saisissant d'opportunités locales repérables directement sur le terrain afin d'exploiter un succès ou contre-attaquer par exemple). Néanmoins, pour appliquer de telles méthodes, encore faut-il que la situation soit non seulement lisible pour chaque acteur et que des unités différentes postées à des centaines de mètres ou des kilomètres de distance puissent coordonner leur action, que ce soit contre des nids de résistance asymétriques ou des forces armées conventionnelles plus importantes afin de jumeler la puissance de feu des unités. C'est pour cela que l'Armée Rouge souhaite mettre en application au sein de sa doctrine de combat le principe de réseau neuronal de combat au sein de ses forces par la mise en application d'un système C4ISR utilisable à l'échelle globale dans toute l'Armée Rouge (forces terrestres et aériennes incluses). Jusqu'à là, il est à noter que la concrétisation d'un système neuronal entre les forces armées s'est avéré très peu pratiqué dans le monde, y compris parmi les grandes puissances militaires actuelles. Autant peut-on dire qu'on retrouve un tel système au sein de l'OND (et qui se limite davantage à la coopération inter-alliés entre les forces armées des pays participants), autant les armées onédiennes de façon individuelle ne l'ont dans l'ensemble que largement négligées ; il n'est pas nécessaire de faire le détour par l'Alguarena, le Grand Kah ou la Loduarie où cette notion est quasiment absente dans les écoles de guerre ou sur le terrain. En bref, le modèle estalien ne peut s'appuyer sur un modèle pré-existant qui aurait pu faire ses épreuves et doit prendre le risque d'être pionnier dans cette catégorie, malgré les risques de revers que cela peut impliquer. En somme, la mise en place d'un réseau neuronal se définit comme un ensemble d'opérations basé sur la supériorité de l'information qui génère une puissance de combat accrue en mettant en réseau des capteurs, des décideurs et des tireurs pour atteindre une conscience partagée, une vitesse de commandement accrue, un rythme d'opérations plus élevé, une létalité plus grande, une capacité de survie accrue et un certain degré d'autosynchronisation. En substance, ce réseau neuronal doit traduire la supériorité de l'information en puissance de combat en reliant efficacement les entités bien informées dans l'espace de combat. L'objectif d'un tel réseau est de permettre aux petites unités d'atteindre une efficacité de mission sans précédent : l'efficience et l'efficacité des opérations militaires s'améliorent grâce aux communications à haut débit et à la connaissance de la situation basée sur le réseau. Un système qui intègre des décideurs humains, des capteurs de situation et de ciblage, c'est-à-dire des sources de données, traite rapidement l'information et la fournit à une unité cible. De plus, les petites unités peuvent compenser leur nombre limité par un degré important de mobilité et d'adaptabilité. Le développement d'un réseau adéquat capable d'échanger des informations en temps réel permet un commandement beaucoup plus décentralisé. De plus, une telle structure améliore la capacité de coordonner des opérations asymétriques et de vaincre un adversaire numériquement supérieur. Vous l'aurez donc compris : le développement d'un tel réseau a tout intérêt à être couplé à la culture doctrine de l'Auftragstaktik, l'autonomie individuelle des officiers et leur capacité à saisir les opportunités localement sans attendre les ordres d'une structure hiérarchique plus rigide doit se coupler avec leurs capacités à accéder aux bonnes informations et ainsi améliorer leur coordination avec les unités alliées adjacentes mais également pour favoriser le combat inter-armes au sein des forces armées. En effet, ce qu'a révélé les combats en Kartvélie, c'est l'abus assez évident des forces de soutien (aviation et artillerie notamment) pour déloger les forces terroristes. Il est généralement admis que cette utilisation abusive du soutien révèle certes des faiblesses des unités de première ligne mais également une incapacité du soutien à être pleinement efficace : le ratio entre munitions tirées et cibles neutralisées nous est défavorable, ce qui montre le manque de précision des informations de tir pour le soutien qui peuvent pourtant être données avec précision par les unités en première ligne. L'aviation est davantage à plaindre ici, l'artillerie étant bien plus efficace dans ce cas présent (surtout compte tenu de la doctrine actuelle qui s'avère relativement efficace). L'utilisation combinée de l'artillerie, de la communication, du renseignement, de la guerre électronique et de l'acquisition d'objectifs à partir de centres de commandement et de contrôle décentralisés dans un réseau global unifié est impératif dans ce cas présent. Il permet aussi, ironiquement, de contrer la guerre électronique adverse et de rendre l'Armée Rouge moins sensible aux moyens de guerre électronique ennemis : la structure décentralisé du système de communications limite le nombre de signatures électroniques émises par l'Armée Rouge.
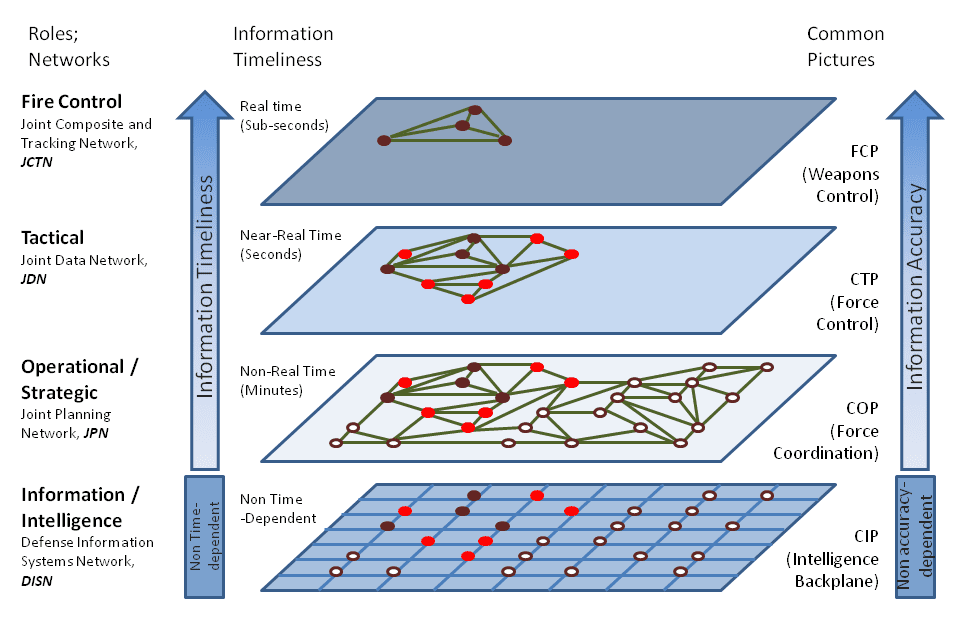
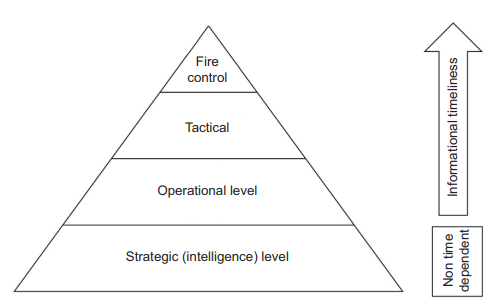
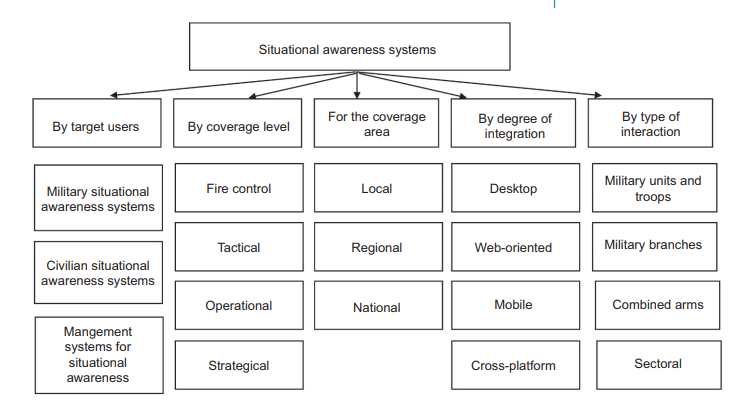
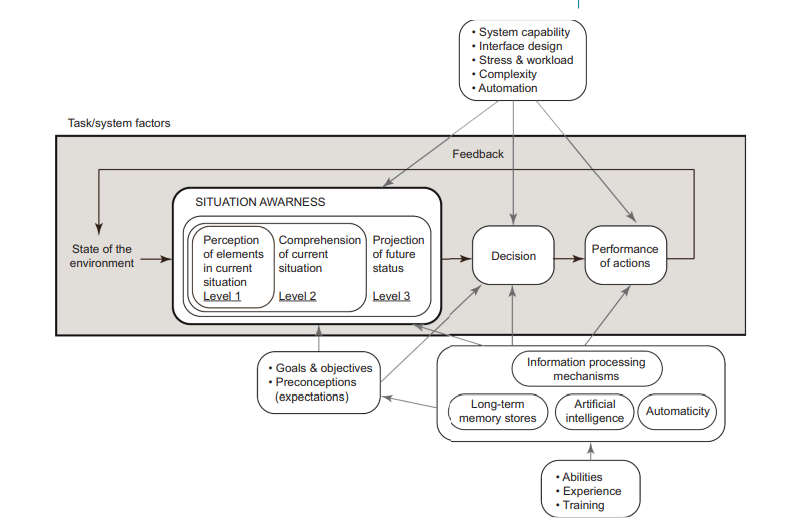
Le modèle de conscience situationnelle (application concrète de l'information au sein du réseau neuronal) se fait sur trois niveaux différents. La première étape, c'est la perception du statut, des attributs et de la dynamique des entités au sein de l'environnement : l'opérateur doit discerner les entités importantes de l'environnement comme les aéronefs, le terrain, la provenance des tirs ou toute forme de caractéristique pertinente. Le second niveau, c'est la compréhension de la situation qui repose sur l'intégration d'éléments repérés à la première étape déconnectés entre eux. La seconde étape va plus loin que la simple prise de conscience de l'environnement puisqu'elle consiste en le développement d'une compréhension de la signification des éléments présents. Enfin, la troisième étape, c'est la projection qui concerne toute la capacité du commandement à projeter les actions futures des unités dans l'environnement à plus ou moins court terme qui se réalise sur la base de la connaissance de l'état et de la dynamique des unités et de la compréhension de la situation appréhendée dans la seconde étape. Il est à noter que pour chacun de ces étapes, réalisés à différentes échelles (tactique, opérationnel et stratégique), plusieurs solutions logicielles sont utilisées par l'Armée Rouge pour différentes fonctions, cette décentralisation des logiciels (tout en s'assurant de la compatibilité des logiciels entre eux afin de partager les informations de l'un avec l'autre). Ainsi, en fonction des niveaux, on retrouve des logiciels avec des fonctions différentes :
Le tout étant assimilé dans un système neuronal unique qui agit comme un système de collecte,, de traitement et d'affichage d'informations sur les forces ennemies (l'expertise du SRR dans le domaine informatique permettra à terme aux forces armées d'établir une telle infrastructure) et se devra d'être multi-domaines, devant être utilisé autant par les forces terrestres que aériennes. Fait intéressant, un tel système pourra aussi être utilisé par le CDC en tant que support supplémentaire afin de réagir plus efficacement encore aux opérations aériennes adverses par une diffusion plus large des informations de l'Armée Rouge aux unités anti-aériennes dispersées sur le territoire qui peuvent ainsi couvrir plus efficacement les portions de territoire visés par l'ennemi. Le système neuronal intègre les informations sur la localisation des forces (amies comme ennemies) afin de suivre en temps réel la position des troupes ennemies et enregistrer rapidement les conséquences du feu sur les unités alliées ou ennemies durant les combats. Ce système, pour l'état-major ainsi que pour les unités de commandement des brigades, permettra d'établir une carte numérique interactive pour l'ensemble des gradés avec des données de diverses sources autrement inaccessibles (images satellites, radars, capteurs terrestres, trackers, interceptions radio, informations de première main). Quant à la sécurité du système, elle est assurée par des clés de sécurité FIDO qui est un outil d'authentification à deux niveaux qui est utilisée en complément d'un mot de passe comme deuxième niveau de vérification de l'utilisateur tout en utilisant pour le premier niveau des méthodes de cryptographie à clé publique standard pour garantir une authentification plus forte. L'intégration des données sémantiques s'effectue sur la base d'un cadre cartographique qui affiche différentes sources de données, certains marquages sont faits manuellement afin de confirmer des informations reçues de première main.
Aux artilleurs plus particulièrement, afin de coupler avec les doctrines actuelles de puissance de feu de l'artillerie estalienne sera confiée un système d'exploitation dit Kropy qui est un système de commandement et de contrôle tactique permettant de créer des cartes intelligentes en combinaison avec des dispositifs et des instruments destinés à planifier et à guider des missions. Dans l'ensemble, il fournit un accès à une carte numérique de la zone avec la position des batteries, des unités alliées et ennemies, un échange de données avec les autres membres du système (unités alliées, coordonnées des cibles détectées, courts messages texte), il résout les tâches de calcul individuelles comme la calcul des tirs (grâce à une mise à jour récurrente des informations géométriques du champ de bataille, la mise à disposition d'un navigateur, d'une carte avec les altitudes précises, de la distance d'une cible à une autre ou encore la portée et le taux de précision en fonction de la pièce d'artillerie utilisée), la zone de tir ou la correction automatique des tirs d'artillerie et il s'assure de l'interaction et du transfert des données provenant des moyens de reconnaissance. On estime qu'avec un tel système, le temps de déploiement des batteries d'artillerie sera réduit par cinq, le temps nécessaire pour atteindre une cible imprévue sera également réduit et le temps nécessaire pour faire de la contre-batterie sera grandement réduit également.
Pour les unités blindées, ce sera le système Bron qui sera utilisé, ce dernier devant servir aux blindés estaliens de tirer sans forcément avoir besoin de ligne de vue directe sur l'ennemi. En effet, lorsqu'un char est dans une position de tir, il doit déterminer avec assiduité sa position géographique : ces informations sont transmises au chef du peloton blindé qui les saisit dans le système sur sa tablette. Le système prend en compte les paramètres de obus et les données météorologiques, les positions de tir sont calculés directement auprès du commandement de la compagnie blindée. Il est à noter que le tir indirect des unités blindées dans les combats modernes est jugé comme très efficace mais difficile à appliquer pour une raison simple : le calcul manuel pour les équipes d'un tel tir indirect prend en moyenne entre 20 à 25 minutes. Avec un tel système, ce délai se réduit à un temps respectable de 5 à 7 minutes.
Il est enfin à noter que le système neuronal s'appuie localement sur des centres de situation qui sont des pôles technologiques qui intègrent et coordonnent les moyens de renseignements de l'Armée Rouge et contribuent à mener efficacement des opérations conjointes entre les différentes armes. Sur la base des informations acquises sur le terrain, les officiers peuvent planifier les opérations de façon plus efficace, notamment entre différentes unités et entre différentes armes et différents commandements afin d'optimiser les ressources dont disposent les forces armées. Un centre de situation en temps de paix se situe à Mistohir en tant qu'unité civilo-militaire (l'Armée Rouge fait généralement appel à des entreprises et des coopératives spécialisées dans le domaine informatique pour faire fonctionner le centre de situation) et qui se charge du recueil des informations sur le territoire fédéral en temps de paix. Néanmoins, en temps de guerre, le système aura tendance à s'étendre et à créer des centres de situations multiples sur des parties du front ou destinées à des opérations particulières afin de décentraliser le système le plus possible et le centrer sur les besoins immédiats en temps de guerre : le système neuronal est donc non seulement décentralisé mais très flexible ce qui rend difficile la prévision des mouvements estaliens par les forces adverses et constitue une défense passive très importante contre la guerre électronique (car l'important dans la guerre électronique, c'est précisément de savoir où viser pour frapper le système, la guerre électronique est l'archétype du "frapper peu pour frapper mal").
Préparer les troupes à la doctrine en combat urbain :

Sans parler de la théorisation des doctrines, c'est leur mise en pratique qui est importante. Nous allons brièvement ici mettre en oeuvre les conséquences du retour d'expérience kartvélien même si le commandement admet aussi qu'une réforme de l'organigramme des brigades mécanisées, que la Commission à la Guerre estime dans ses rapports comme l'unité la plus prompte à s'adapter au contexte urbain, devra se faire à l'avenir. Pour le moment, lors des exercices, des unités pilotes basées sur diverses propositions dans les écoles militaires et l'état-major seront expérimentées. D'ici que ces résultats nous viennent, l'Estalie doit proposer une série de mesures pour pallier dans l'immédiat aux défaillances techniques de ses troupes lors des combats urbains. Les deux brigades mécanisées de l'Armée Rouge recevront désormais un entraînement intensif sur le combat rapproché (CQB), la reconnaissance et les techniques de dégagement d'obstacles (murs, barricades, bâtiments occupés par l'ennemi) dans des centres de formation dans les trois régions militaires de la Fédération où sera reproduit plusieurs environnements urbains (intacts ou dévastés, avec des systèmes de tunnels par ailleurs). L'équipement des troupes estaliennes en terrain urbain sera revu : lance-grenades raccourcis, Colt-ESH (version raccourcie du fusil d'assaut de l'armée régulière), gilets de protection renforcés contre les prokectiles à courte portée et les éclats, casques à vision thermique intégrée. Les unités de génie seront désormais formées à neutraliser les IED et à aménager des tunnels ou des postes avancés dans les milieux urbains dans une situation de combat intense. Une partie des unités de génie des brigades mécanisées deviendront des démineurs spécialisés EOD qui devront accompagner par groupe de deux les escouades d'infanterie mécanisée en première ligne et qui seront responsables du repérage et de la neutralisation des pièges explosifs. Ils seront équipés de détecteurs d'explosifs, de robots de désamorçage et de charges de démolition contrôlée. Le système de conscription de l'Armée Rouge va prioriser dans l'envoi de conscrits dans le génie de combat les spécialistes civils dans la gestion urbaine et les infrastructures afin d'utiliser leur expertise pour exploiter les bâtiments comme postes avancés ou zones défensives, identifier les points faibles d'une infrastructure pour une démolition stratégique ou pour prévoir les trajets de repli ou d'approvisionnement dans des zones densément peuplées. Chaque escouade devra également désormais contenir dans son véhicule blindé une arme de type DMR (ou plus si la situation l'exige) afin de s'adapter aux tirs à moyenne et longue distance. Enfin, le cahier des charges des véhicules blindés de l'Armée Rouge sera révisé auprès des entreprises publiques de la défense : le plancher des véhicules sera renforcé, le blindage y sera plus épais (avec des plaques d'acier renforcés), un blindage de type V-shaped sera imposé (la forme en "V" du blindage dévie les explosions sous le véhicule et disperse l'onde de choc plus facilement ce qui réduit les dommages au châssis et à l'équipage), des pneus anti-crevaison et des jantes renforcées ainsi que des roues à pression ajustable seront exigées pour compenser les pertes de pression causées par les explosions, des leurres infrarouges et des pods lanceurs de fumigènes seront installés (davantage pour les combats avec l'infanterie ennemie), des toiles de protection seront installées à l'intérieur des habitacles pour éviter les blessures par éclats ou bris de vitres, la séparation interne et le cloisonnement à l'intérieur des véhicules sera mise en place pour minimiser les blessures internes en cas d'explosion et chaque véhicule blindé sera équipé de systèmes de détection et de neutralisation d'IED durant les combats urbains (détecteurs de métaux, capteurs électromagnétiques, radars de pénétration de sol, systèmes de brouillage mobile).
Posté le : 05 jan. 2025 à 02:55:18
412


Posté le : 11 mars 2025 à 14:20:21
37480


Les opérations aéromobiles désignent l'ensemble des opérations aéroportées utilisant généralement des moyens héliportés (ou à déploiement vertical de manière générale) afin de mener des missions de combat ou de soutien en utilisant la mobilité des moyens d'assaut aérien afin d'accomplir la mission. On considère, au sein de l'école de guerre estalienne, que l'utilisation des manoeuvres d'assaut aérien sont utilisées par les commandants afin d'obtenir en premier lieu un effet de surprise tactique face à des forces généralement supérieures numériquement en faisant obstruction de tout obstacle et de tout relief et sans aucune dépendance à une ligne de communication terrestre quelconque. Ces opérations sont donc l'incarnation la plus concrète du concept d'armes combinées puisqu'elles nécessitent une coordination et une planification implacable entre le commandement terrestre et le commandement aérien. La polyvalence et la force unique des unitées aéromobiles sont généralement obtenues par une combinaison des capacités des aéronefs déployés lors de l'assaut en s'appuyant sur leur vitesse, leur agilité et leur puissance de feu, le tout appuyé par les unités au sol que ces mêmes aéronefs se chargent de déployer dans le même temps.
Dans le cadre des prochains exercices de début d'année des forces armées estaliennes, l'Armée Rouge a décidé récemment de se servir à la fois de ses stocks d'unités héliportés et de l'augmentation toujours plus importante de ses effectifs professionnelles afin de mettre sur pied une force aéromobile régulière en capacité d'accomplir deux objectifs à la fois stratégique et tactique. Sur le plan tactique, l'Estalie prévoit de disposer dans son panel d'unités une force aéromobile qui devra ainsi compléter parfaitement la force mécanisée au sol que l'Estalie a déjà réussi à se constituer, la combinaison entre forces héliportées et forces mécanisées doit assurer en peu de temps le renforcement du fer de lance de toute opération offensive terrestre, la force mécanisée se chargeant ainsi de la neutralisation du matériel lourd ennemi en première ligne tandis que les forces aéromobiles seraient chargées de la neutralisation de l'organisation ennemie en elle-même, en frappant les infrastructures, la logistique ainsi que les zones vulnérables et les points névralgiques nécessaires à l'ennemi pour contrer la masse mécanisée estalienne, rendant toute contre-mesure inefficace à terme du fait de la désorganisation engendrée par les opérations aéromobiles. Sur le plan stratégique, l'état-major estalien prévoit que les unités aéromobiles soient le fer de lance des forces de réaction rapide de l'Armée Rouge et soient de fait la première unité en capacité de se déployer dans un large rayon d'action en cas d'intervention à l'étranger. En effet, bien que l'Estalie continue inlassablement de renforcer ses capacités de projection à l'étranger, elles sont encore insuffisantes pour acheminer rapidement une brigade mécanisée ou blindée complète par exemple, alors que ces unités sont généralement les meilleures unités que l'Estalie puisse offrir en cas d'affrontement armé. Il faut donc une force d'une autre nature qu'une force lourde qui puisse intervenir avec une efficacité plus ou moins similaire et qui soit formée au déploiement aérien rapide (le déploiement aérien, compte tenu de l'enclavement de l'Estalie, étant le seul moyen pour notre nation d'assurer une projection de force quelconque). C'est là que les unités aéromobiles entre en jeu car celles-ci doivent être en capacité d'assurer ces deux objectifs à la fois stratégique et tactique.
Considérations tactiques :
En plus d'utiliser les fondamentaux tactiques du combat terrestre, un mélange proche des tactiques d'infanterie légère et d'infanterie mécanisée, les unités aéromobiles doivent se charger de considérer plusieurs autres fondamentaux tactiques. En effet, les forces aéromobiles estaliennes se voient confier des missions qui tirent partie avant tout de leur mobilité supérieure aux unités terrestres, elles doivent combattre en équipes interarmes, la planification doit être centralisée et détaillée mais leur exécution reste dans les faits agressive et décentralisée. En règle générale, les forces aéromobiles sont constituées d'unités d'infanterie légère sans grande mobilité tactique, ce qui explique pourquoi cette force doit obligatoirement être débarquée sur l'objectif ou à proximité, à moins qu'une force suffisante d'hélicoptères de transport lourd soit disponible pour soutenir les moyens de mobilité ou d'appui-feu. Les forces aéromobiles peuvent opérer de manière indépendante ou en conjonction avec d'autres forces terrestres. C'est le commandant de mission qui détermine la composition des vagues d'assaut. En effet, idéalement, la force d'assaut doit être capable de surpasser les forces ennemies susceptibles d'être présentes dans l'immédiat et de rassembler une puissance de feu plus rapidement que les ennemis. De plus, les hélicoptères doivent être utilisés comme des moyens de tromperies tactiques en effectuant des atterrissages de démonstration lorsque cela est possible dans des zones différentes au cours d'un même vol afin de tromper l'ennemi quant au véritable objectif de l'opération. Tout est fait pour éviter des affrontements prolongés : que ce soit par la ruse (comme la tromperie tactique que nous venons d'aborder) ou la focalisation sur des objectifs non défendus ou faiblement défendus, les objectifs bien défendus doivent être supprimées par une neutralisation préalable des défenses ennemies avant le débarquement à proximité des unités au sol. Généralement, les unités aéromobiles sont également vulnérables aux unités héliportées ennemies, à l'aviation adverse ou aux défenses anti-aériennes. Pour contrer cela, les opérations aéromobiles se doivent d'être accompagnées d'unités aériennes afin d'assurer la supériorité aérienne d'une part et des opérations SEAD doivent être effectuées dans les zones traversées avant le début des opérations.
Un des points principaux à retenir lors des opérations aéromobiles, c'est bien souvent la planification en revanche. En effet, le commandement et le contrôle des opérations aéromobiles doivent être planifiés de manière détaillée, avec la mise à disposition d'informations sur les positions adverses et le relief au sol de l'objectif, une répétition de l'exécution de la manoeuvre par les troupes avant les opérations afin que chaque sous-officier puisse connaître le rôle que lui et ses troupes jouent au cours de l'opération. Chaque opération aéromobile doit être accompagné de plans d'urgence à tous les degrés de l'exécution de la manoeuvre afin de s'assurer de la poursuite de la mission pendant une exécution décentralisée et dans un environnement opérationnel qui reste en constante évolution. En règle générale, la planification détaillée des opérations aéromobiles repose sur la division en deux temps des actions lors de l'opération : les actions temporelles et les actions événementielles. Les actions temporelles désignent dans le corpus militaire estalien un moment précis de l'opération avec une durée déterminée, comme une préparation d'artillerie à une heure précise. Les actions événementielles désignent plutôt les actions entreprises en réaction à des actions temporelles et à leurs conséquences ou à des actions ennemies. Pour prendre l'exemple d'une préparation d'artillerie, une action temporelle désignerait une zone comme cible de l'artillerie à un horaire précis mais dans la planification, il peut être prévu en tant qu'action événementiel que si une compagnie alliée entre en contact avec l'ennemi dans la zone désignée, alors l'artillerie met un terme à son action temporelle. En somme, cette séparation entre deux types d'actions permet principalement au commandement, lorsqu'il sur-planifie certaines opérations, de donner une suite d'ordres à chacune de ses unités sans nécessairement avoir besoin de lui communiquer en cas d'imprévu, ce qui peut par exemple permettre une certaine autonomie des unités entre elles en cas de rupture des communications (dans le cadre d'une opération de guerre électronique qui toucherait les communications alliées, par exemple, ce type de planification maintient sur le court terme la cohésion entre les différentes unités). Cette façon de planifier les opérations est venue à l'idée de l'état-major estalien dû à la difficulté lors des opérations aéromobiles à communiquer sur de longues distances car bien que des mesures soient prises pour établir un système de C2 aéroporté efficace sur la zone de combat, leur vulnérabilité en cas de contre-attaque massive ou de guerre électronique adverse oblige l'état-major à repenser la manière dont elle planifie ses opérations aéromobiles, bien que la réussite du commandement des opérations réside dans l'organisation efficace des tâches, la planification précise, l'exécution décentralisée et l'utilisation de réseaux de radios aéroportés afin de multiplier les capacités de communication fiables au sein d'une troupe aéromobile.
Les opérations de combat d'une force aéromobile sont diverses, chaque opération visant à tirer parti de la rapidité et de la flexibilité de ce type d'unités afin d'obtenir un effet de surprise maximal dans un délai relativement court. On peut donc lister ici les opérations aéromobiles suivantes :

Bien que les unités aéromobiles soient aussi utiles pour les opérations défensives, leur nature est profondément offensive (même les opérations défensives nécessitent un esprit offensif pour arracher l'initiative à l'ennemi), elles doivent mener l'initiative face à l'ennemi, accroître la liberté d'action du reste de l'armée et générer l'effet de surprise. Comme toutes les opérations, les assauts aériens doivent certes être planifiées mais doivent être organisées soit de façon délibérée (avec une longue préparation en amont comme décrit plus haut) ou de manière hâtive, c'est-à-dire en utilisant des forces immédiatement disponibles de façon fragmentaire pour effectuer des opérations nécessitant une préparation minimale, en échangeant donc la planification et la préparation au profit de la rapidité d'exécution et de l'imprévisibilité (en prévoyant une opération hâtivement, en utilisant les moyens conventionnels de planification décrits plus haut, on empêche l'ennemi de prévoir les mouvements par l'observation, la reconnaissance ou l'espionnage). Les opérations offensives font souvent preuve d'opportunisme en exploitant notamment chaque renseignement tiré à l'ennemi afin d'obtenir une position avantageuse et générer un rythme opérationnel plus élevé que l'ennemi pour entraver sa réactivité. L'objectif des opérations aéromobiles offensives n'est pas seulement de prendre le terrain (qui est un objectif souvent secondaire) mais l'ennemi lui-même en attaquant ses faiblesses en concentrant la puissance de feu sur ses vulnérabilités, en isolant les unités ennemies de leur soutien (y compris la population), en frappant l'ennemi de façon imprévisible pour perturber la planification de son commandement, en surchargeant les capacités du commandement adverse à observer, orienter, décider et agir face aux initiatives estaliennes.
En dehors des combats au sol, le soutien héliporté est tout aussi important dans ces opérations que les combats eux-mêmes. En effet, un des aspects les plus importants de ces opérations est la présence d'un appui-feu, c'est-à-dire l'utilisation coordonnée de mortiers, d'artillerie, d'hélicoptères ainsi que d'avions de combat afin de détruire, neutraliser et supprimer les cibles de surface en soutien aux opérations. L'appui-feu est d'autant plus nécessaire qu'elle obstrue la vision ennemie, isole ses formations et ses positions, ralentit et canalise ses mouvements, créait des zones d'obstacles, use de la contre-batterie face à l'artillerie ennemie, interdit les renforts adverses d'accéder à la zone de combat et fournit un éclairage aux troupes alliées en cas de combat nocturne. En dehors de l'appui-feu direct, le soutien héliporté se caractérise par la présence d'unités LCE organiques, rattachées aux unités de combat et qui s'assure de la progression des forces au sol, à leur approvisionnement et au déploiement du matériel et des munitions par voie aérienne. Généralement, le soutien est chargé de la plupart des missions en dehors du combat :
Formation :
L'entraînement aux assauts aériens doit être intégré régulièrement aux programmes des unités aéromobiles de l'Armée Rouge afin que celles-ci développent à chaque niveau, de l'escouade au bataillon, leurs capacités opérationnelles. L'objectif de la formation des unités aéromobiles, sans que celles-ci n'atteignent forcément le même niveau d'exigence que les forces spéciales également formées aux opérations aériennes, puissent mener les opérations d'assaut aérien avec rapidité, précision et confiance. Les unités d'infanterie mais aussi toutes les unités de combat et de soutien, doivent recevoir une formation. Pour l'infanterie, il s'agira surtout d'effectuer des entraînements tactiques liés aux techniques des petites unités d'infanterie, ce qui constitue la base de toute phase terrestre des opérations aériennes. La formation doit assurer pour toutes les unités la maîtrise de la préparation aux opérations, à l'embarquement, au déplacement aérien, aux tactiques d'atterrissage et de déchargement, en mettant l'accent sur l'embarquement et le débarquement rapide lors des manœuvres afin de tirer partie de la rapidité et de la mobilité des unités aéromobiles. Il s'agira également de former les sous-officiers des petites unités d'infanterie à opérer indépendamment de leur organisation mère afin d'accomplir leur part de la mission globale. De plus, les sous-officiers doivent être en capacité de prendre l'initiative en l'absence d'ordres de leurs supérieurs car la rapidité et surtout la nature complexe des opérations aériennes imposent une utilisation de procédures opérationnelles d'urgence normalisées chez tous les sous-officiers ainsi que l'entraînement des troupes aux exercices de combat dans des conditions défavorables. Tous les soldats doivent être entraînés à des actions de routines à effectuer au cours des opérations, en incluant des procédures en cas de crash, des plans de secours au cours des opérations, etc.

La mobilité est aussi importante dans la formation d'une troupe aéromobile, les unités doivent être entraînées à voyager léger, en cohérence avec leur mission tactique, en emportant uniquement l'équipement et les fournitures nécessaires. On prône ici la complète austérité des moyens, rien de superflu et tout ce qui peut être allégé le sera. Enfin, bien entendu, chaque soldat doit être entraîné à une formation de parachutisme afin d'apprendre les méthodes de parachutage d'une part et doivent aussi s'entraîner à la descente en rappel des hélicoptères.
Organisation :
La structure des forces aéromobiles en Estalie est assez différente de la structure des autres unités régulières de l'Armée Rouge pour une raison assez simple. Quiconque a eu le courage de se pencher sur l'organisation interne des unités estaliennes remarquera que l'accent est toujours mis auprès des unités combattantes sur l'autonomie. Chaque brigade est indépendante, dispose de ses propres unités logistiques, de communication, de maintenance, de soutien médical ainsi que ses propres unités de soutien de combat, indépendamment de toute unité spécialisée dans ces domaines précis. Ainsi, il n'existe pas à proprement parler de division au sein de l'Armée Rouge : au début dû à des raisons avant tout matérielles, l'armée estalienne étant à l'époque pas assez grande pour accueillir une division puis pour des raisons tactiques et stratégiques qui ont constitué depuis lors le cœur de la stratégie estalienne. Avec les forces aéromobiles, les choses changent quelque peu puisque pour la première fois depuis l'époque royale, l'armée estalienne va se doter d'une division de combat. Les raisons qui poussent l'état-major à enfin passer le stade divisionnaire pour le cas aéromobile est spécifique à la condition même des unités aéromobiles : le matériel héliporté estalien est limité numériquement et il est évident qu'en cas de conflit, l'état-major n'usera pas de toutes ses troupes aéromobiles en même temps et cherchera à conserver une réserve pour conserver une réactivité sur la ligne de front. Il faut donc composer avec deux brigades minimum plutôt qu'une : une brigade de combat, comportant la très grande majorité du personnel destiné au combat, et une brigade héliportée, chargée de tenir tout le personnel et le matériel héliporté. La brigade héliportée joue alors le rôle de distributeur de matériel héliportée aux brigades de combats et joue tous les rôles nécessaires au cours des opérations qui concernent la reconnaissance héliportée, le transport, l'appui-feu, etc. Tout ce monde doit donc être rassemblée, pour des raisons de communication, de flexibilité et de coordination sous une division qui sera nommée la 9ème Division Aéromobile "Krichahchi-Orly".
Brigade de Combat (BDC) :
On va d'abord détailler l'organisation interne de la 1ère Brigade de Combat (BDC) "Pendrovac". Les BDC sont faites pour disposer d'une organisation très modulaire, conçues pour être rapidement projetées en opérations. On commence doucement avec les escouades d'infanterie qui sont les unités de base de combat, elles sont composées d'un chef d'escouade (sergent) qui commande l'escouade et coordonne les feux, 2 chefs d'équipes (caporaux) qui dirigent chacun une équipe de combat de 4 soldats avec un mitrailleur (fusil-mitrailleur), un grenadier (avec lance-roquettes) et deux fusiliers (donc le chef d'équipe). Ainsi, chaque escouade compte neuf soldats.
On passe ensuite au peloton d'infanterie qui est composée de quatre escouades de combat, d'un chef de peloton (lieutenant), d'un sergent adjoint, d'un médecin de combat, d'un radio-opérateur et d'un tireur d'élite et d'un observateur qui l'assiste. Généralement, les pelotons d'infanterie disposent de deux hélicoptères moyens qui leur sont attitrés (deux escouades par hélicoptère) ou d'un hélicoptère lourd pour toute l'équipe. Il est à noter que parmi les quatre escouades, on compte trois escouades de combat (avec le matériel cité plus haut) et une escouade d'appui-feu qui remplace la composition de l'équipe de combat par deux mitrailleurs, un grenadier et le chef d'équipe (qui reste un fusilier). Au total, chaque peloton d'infanterie compte 42 soldats en tout. Bien que les pelotons soient héliportés, c'est la brigade héliportée de la division qui leur met à disposition ces équipements. Cependant, le peloton dispose lui-même d'un véhicule blindé léger aérotransportable pour le commandement.
Equipement : x42 équipements d'infanterie + x4 lance-roquettes + x1 VBL.
On passe ensuite à la compagnie d'infanterie qui comprend trois pelotons d'infanterie (soit 126 soldats au combat), un peloton d'appui-feu (qui se compose de deux escouades de mortiers légers (un mortier par escouade), une escouade antichar (4 lance-missiles antichars) et une escouade de tireurs de précision soit un total de 24 hommes). On compte également une section de commandement qui comporte un commandant de compagnie (capitaine), un sergent-major de compagnie, un lieutenant des opérations, un radio-opérateur, trois médecins de combat et 4 fusiliers-conducteurs soit un total de 11 hommes. On compte donc un total de 161 hommes par compagnie. Chaque compagnie, en plus de l'équipement héliporté, dispose avec lui de 4 véhicules blindés légers aérotransportables.
Equipement : x161 équipements d'infanterie + x12 lance-roquettes + x8 VBL + x2 mortiers légers + x4 lance-missiles antichars + x3 véhicules de transmission radio.
Plus haut encore, on compte le bataillon d'infanterie aéromobile qui compte trois compagnies d'infanterie (soit 483 hommes) et une compagnie d'appui qui comprend trois pelotons de mortiers lourds (trois mortiers lourds par peloton), un peloton antichar (comprenant 12 lance-missiles antichars) et un peloton de reconnaissance avancée soit au total 135 hommes. Le bataillon dispose également de sa propre compagnie de commandement et de logistique avec un quartier général (chargé du commandement, des renseignements et des transmissions), une section médicale (avec 25 médecins de combat) et une section de transport comprenant surtout des camions logistiques aérotransportables (30 camions par section), la compagnie comportant au total 222 hommes. Au total, on compte donc 840 hommes par bataillon d'infanterie aéromobile.
Equipement : x840 équipements d'infanterie + x36 lance-roquettes + x24 VBL + x6 mortiers légers + x24 lance-missiles antichars + x3 mortiers lourds + x15 camions de transport x4 véhicule de transmission radio + x15 camions-citernes.
La brigade en elle-même dispose ensuite de plusieurs autres unités en dehors du bataillon. En effet, la BCT en elle-même compte trois bataillons d'infanterie aéromobile. Néanmoins, ces bataillons ne sont pas seuls. On compte plusieurs autres bataillons chargés de missions différentes. Ainsi, on compte en premier lieu un bataillon de reconnaissance et de cavalerie légère qui est chargée d'effectuer des missions de reconnaissance avancée et d'éclairage, de détecter et suivre les mouvements ennemis et d'assurer la surveillance et la collecte de renseignements. Le bataillon se décompose en une troupe de commandement (chargée du commandement et des transmissions) comportant 80 hommes, un véhicule de transmission radio et six véhicules blindés légers aérotransportables ; une troupe de reconnaissance blindée comportant 100 hommes, 12 chars légers et 6 véhicules blindés légers ; une troupe de reconnaissance motorisée comportant 100 hommes et 16 véhicules blindés légers ; une troupe de surveillance chargée d'utiliser des drones légers de reconnaissance et comportant 70 hommes, 6 drones de reconnaissance et 8 véhicules blindés légers ; et enfin une troupe de soutien et de maintenance comprenant 50 hommes et 20 camions de transport aérotransportables, deux véhicules radars, 5 camions-citernes et un véhicule de transmission radio. Au total, le bataillon de reconnaissance et de cavalerie légère compte 400 hommes.
Equipement : x400 équipements d'infanterie + x36 VBL + x20 camions de transport *x2 véhicules de transmission radio + 12 chars légers + x2 véhicules radars + x6 drones de reconnaissance + x5 camions-citernes.
On compte ensuite un bataillon du génie qui est chargé de construire et fortifier les positions défensives, poser et déminer les champs de mines, réparer et entretenir les infrastructures utilisées par la brigade et assurer le renseignement sur le terrain (cartographie, drones, guerre électronique). Pour cela, le bataillon se décompose en une compagnie de commandement (chargée du commandement et des transmissions) comportant 100 hommes, un véhicule de transmission radio et 10 véhicules blindés légers ; une compagnie de génie de combat comportant 120 hommes, 10 chars de dépannage, deux ponts mobiles et 6 véhicules blindés légers ; une compagnie de déminage comportant 120 hommes, 8 véhicules de déminage et 5 bulldozers ; une compagnie de reconnaissance et de guerre électronique comportant 100 hommes, 6 drones de reconnaissance, 2 véhicules radars ainsi que des véhicules annexes de brouillage ; et enfin une compagnie de soutien et de maintenance comportant 60 hommes, 20 camions de transport, un véhicule de transmission radio et 5 camions-citernes. Au total, le bataillon du génie compte 500 hommes.
Equipement : x500 équipements d'infanterie + x24 VBL + x20 camions de transport + x2 véhicules de transmission radio + x10 chars de dépannage + x2 véhicules radars + x6 drones de reconnaissance + x5 camions-citernes + x2 ponts mobiles + x8 véhicules de déminage + x5 bulldozers.
On compte ensuite un bataillon d'artillerie qui est chargé de fournir un soutien d'artillerie aux troupes au sol, effectuer des barrages de tir et des frappes de précision et assurer la contre-batterie et la destruction des positions ennemies. Pour cela, le bataillon se décompose entre une compagnie de commandement de 80 hommes, 6 véhicules blindés légers et un véhicule de transmission radio ; deux batteries d'artillerie comportant chacun 120 hommes et 6 canons tractés ; une batterie de roquettes comportant 100 et 6 lance-roquettes multiples ; et enfin une batterie de soutien logistique comportant 50 hommes, 20 camions de transport et 5 camions-citernes. Au total, le bataillon d'artillerie compte 450 hommes.
Equipement : x450 équipements d'infanterie + x6 VBL + x20 camions de transport + x1 véhicules de transmission radio + x5 camions-citernes + x12 canons tractés + x6 lance-roquettes multiples.
Enfin, au sein de la brigade, on compte un bataillon logistique chargé de gérer le ravitaillement en carburant, en munitions et en vivres, assurer la réparation des véhicules et des armements et effectuer le transport logistique. Il se décompose en une compagnie de commandement de 120 hommes, 10 véhicules blindés légers et un véhicule de transmission radio ; deux compagnies de transport et de distribution comportant chacune 80 hommes, 10 camions citernes et 30 camions de transport ; une compagnie de maintenance comportant 100 hommes et 6 chars de dépannage ; une compagnie de soutien médical avec 75 hommes et 6 camions de transport ; et enfin une unité de de soutien au combat (HSL-FSC) comportant 85 hommes et 6 véhicules blindés légers. Au total, la compagnie logistique comprend 560 hommes.
Equipement : x560 équipements d'infanterie + x16 VBL + x66 camions de transport + x1 véhicules de transmission radio + x20 camions-citernes + x6 chars de dépannage.
Maintenant qu'on a les effectifs et les équipements de chaque bataillon au complet, il est tant de s'attarder sur la brigade en elle-même qui comprend donc, pour récapituler :
Soit un total de 4500 hommes. Chaque brigade de combat aéromobile contient en terme d'équipements le matériel suivant :
Brigade Héliportée Aéromobile (BHA) :
La BHA est la brigade qui contient l'ensemble des moyens héliportés de la division. En effet, là où la plupart des brigades de combat précédentes ne disposaient pas de matériel héliporté assigné à leur brigade, du fait de leur polyvalence entre le transport héliporté et le combat terrestre, les BHA sont justement là pour accomplir ce travail de hub en fournissant aux brigades de combat le matériel héliporté et le personnel formé nécessaire, le but étant que ces brigades puissent être en capacité, en fonction des besoins opérationnels, dispatcher et optimiser la distribution de leurs unités en soutien ou en transport auprès des unités combattantes. Les BHA sont donc formées à des missions diverses qui comportent généralement les assauts aériens avec l'infanterie aéromobile, l'appui-feu, la reconnaissance, la surveillance et le transport logistique.
Le BHA se décompose en plusieurs unités : une compagnie de commandement, un bataillon d'attaque, un escadron de cavalerie, un bataillon de soutien de combat aéromobile et un bataillon de soutien. Analysons dans un premier temps la compagnie de commandement qui est le centre de commandement stratégique de la brigade, gérant l'ensemble des opérations aériennes de la division et coordonne les bataillons au sein de la brigade. La compagnie est principalement chargée de superviser les unités aériennes en coordination avec le reste de la division, effectuer le travail de planification stratégique (organisation du transport, de l'attaque et de la reconnaissance), gérer les transmissions et les communications entre les bataillons et le commandement divisionnaire, analyser le renseignement en exploitant les données ISR et superviser la logistique en carburant, munitions et pièces détachées. La compagnie compte tout d'abord un état-major de la brigade comprenant un colonel, un lieutenant-colonel, un sergent-major, deux officiers des opérations, deux officiers du renseignement, deux officiers de la logistique, deux officiers des transmissions et 14 aides et planificateurs. Au total, l'état-major compte 25 personnes répartis dans 4 véhicules blindés légers et un véhicule de transmission radio. La compagnie compte également un peloton de transmissions chargé de maintenir les communications et les transmissions de données et comportant un capitaine, 10 opérateurs radio, 5 techniciens, 5 administrateurs du réseau informatique et 9 spécialistes de la guerre électronique soit 30 hommes répartis dans 6 véhicules de transmission radio. On compte également un peloton du renseignement chargé de la collecte et de l'exploitation des informations ISR et comportant un capitaine, 10 analystes du renseignement (cartographie, images, SIGINT), 5 opérateurs SIGINT, 5 spécialistes de drones et 4 coordinateurs de mission ISR (liaison avec les unités héliportées) répartis dans 4 véhicules de transmission radio. On compte ensuite un peloton des opérations aériennes chargé de la supervision et de la coordination des missions de vol et de la surveillance de l'espace aérien opérationnel et composé d'un major, 8 contrôleurs de mission aérienne, 5 planificateurs météo et 6 spécialistes de gestion de l'espace aériens répartis dans deux véhicules blindés légers, un véhicule de transmission radio et un véhicule radar. On retrouve ensuite le peloton médical chargé d'assurer les premiers soins, stabiliser les blessés et coordonner les évacuations médicales et comportant un major médical, 6 infirmiers, 6 techniciens médicaux et 7 médecins chargés de l'évacuation médicale répartis en deux véhicules blindés légers et un véhicule de transmission radio. Enfin, on retrouve le peloton logistique chargé de la gestion des ressources de la brigade (carburant, munitions, pièces détachées) et comportant un capitaine de logistique, deux sous-officiers en charge des stocks, 10 gestionnaires de munitions, 10 opérateurs de stockage et 7 techniciens en maintenance légère répartis dans 6 camions de transport. Au total, la compagnie de commandement compte 150 hommes.
Equipement : x150 équipements d'infanterie + x8 VBL + x6 camions de transport + x13 véhicules de transmission radio + x1 véhicule radar.
Vient ensuite le bataillon d'attaque. Le bataillon d'attaque est l'unité d'attaque aérienne principale de la brigade, contenant à la fois des hélicoptères d'attaque et des drones afin de fournir un appui-feu et de la reconnaissance ISR sur le terrain. Le bataillon est chargé ainsi d'assurer un appui aérien rapproche aux forces terrestres, acquérir les objectifs afin de coordonner les actions offensives avec l'infanterie et l'artillerie et se charge également de la destruction des unités blindées, la grande partie des hélicoptères d'attaque estaliens ayant des capacités antichars. On compte d'abord dans le bataillon d'une compagnie de commandement de 65 soldats comprenant un état-major (10 officiers), un peloton de transmissions (15 soldats), un peloton de renseignement (15 soldats), une section médicale (10 soldats) et un support logistique (15 soldats), la compagnie disposant en son sein de 5 véhicules blindés légers, deux véhicules de transmission radio, un véhicule radar, deux camions de transport et un camion citerne. Vient ensuite les compagnies d'attaque qui sont le fer de lance du bataillon. Chaque compagnie d'attaque dispose d'un commandement de compagnie (10 soldats), trois escadrons de vol (comportant deux hélicoptères chacun avec 60 pilotes et copilotes) et un peloton de maintenance de premier niveau (20 hommes) disposant d'un camion de transport et d'un camion citerne. Chaque compagnie contient donc 8 hélicoptères d'attaque et le bataillon compte trois de ces compagnies. On compte ensuite une compagnie de maintenance disposant d'un chef de compagnie, un peloton de maintenance des moteurs et des structures (25 hommes) et un peloton d'armement et d'électronique (24 hommes) soit un total de 50 hommes au sein d'une compagnie de maintenance. Enfin, on retrouve une compagnie de reconnaissance chargée d'exploiter les drones pour la surveillance ISR et les frappes localisées aériennes. Chaque compagnie de reconnaissance détient 4 drones de reconnaissance pilotés par 10 soldats, soutenus par 10 opérateurs de charge utile et 10 soldats affectés à la maintenance et la gestion des liaisons de données soit un total de 30 hommes. Au total, chaque bataillon d'attaque est composé de 415 hommes.
Equipement : x24 hélicoptères d'attaque + x5 VBL + + x5 camions de transport + x2 véhicules de transmission radio + x1 véhicule radar + x4 camions citernes + x4 drones de reconnaissance.
Vient ensuite l'escadron de cavalerie. Celui-ci est la principale unité de reconnaissance et de cavalerie aérienne de la division, spécialisé dans la reconnaissance armée, la surveillance et l'appui aérien rapproché ainsi que l'insertion et l'extraction d'éclaireurs au sol et leur récupération rapide en cas de problème. L'escadron ne dispose pas d'une compagnie de commandement mais d'une simple troupe de commandement de 80 hommes comportant un lieutenant-colonel d'escadron, un major exécutif, un sergent-major, 10 officiers du renseignement et de logistique, 15 opérateurs-radio, 10 pilotes de liaison (hélicoptères moyens), 15 médecins de combat et 27 mécaniciens. La troupe de commandement comporte six véhicules blindés légers mais également deux hélicoptères moyens de liaison afin de permettre à la troupe de se déplacer rapidement d'une zone opérationnelle à une autre aisément. On compte ensuite les troupes de reconnaissance. Une troupe de reconnaissance, c'est une troupe de 80 hommes (un capitaine, un lieutenant, 16 pilotes, 16 artilleurs de bord et 46 mécaniciens) comportant 8 hélicoptères légers polyvalents faits pour la reconnaissance, l'escadron de cavalerie compte deux troupes de reconnaissance soit 16 hélicoptères légers dédiés à la reconnaissance. On compte ensuite une troupe d'éclaireurs comportant 90 soldats (un capitaine, un lieutenant, 12 pilotes, 12 ailiers, 36 éclaireurs au sol et 28 mécaniciens) qui sont la troupe de reconnaissance au sol de la brigade, chargée de l'insertion et de l'extraction d'éclaireurs et soutenant l'évacuation des unités d'infanterie au sol. La troupe d'éclaireurs dispose de 36 éclaireurs (ou opérateurs de reconnaissance) qui sont divisés en six équipes de reconnaissance de 6 hommes chacun et disposant pour chaque équipe d'un lance-missile antichar (il est à noter que ces hommes sont les seuls au sein de toute la division à disposer d'un entraînement similaire à celui des forces spéciales, leur rôle et leur nombre limité les rendant essentiels dans les missions de reconnaissance) ; ils sont transportés par 6 hélicoptères de transport moyen. Enfin, on retrouve une troupe de maintenance de 70 hommes (un officier technique aéronautique, 15 techniciens héliportés, 20 mécaniciens moteurs, 20 spécialistes en armement, 14 techniciens de transport) disposant de 5 camions de transport et 5 camions citernes. Au total, un escadron de cavalerie compte 400 hommes.
Equipement : x36 équipements d'infanterie + x6 lance-missiles antichars x8 hélicoptères de transport moyen + x6 VBL + + x5 camions de transport + x5 camions citernes + x16 hélicoptères légers polyvalents.
Par la suite, on trouve ensuite un bataillon de soutien au combat aéromobile qui est l'unité de soutien général de la division. Son rôle est crucial puisqu'il assure le transport de la majorité des troupes de la division par voie héliportée ainsi que le transport du matériel aérotransportable, le ravitaillement, les évacuations médicales et les missions de commandement aérien (en assurant le rôle de poste de commandement aérien afin de permettre une meilleure coordination des opérations depuis les airs). Le bataillon de soutien au combat aéromobile compte une compagnie de commandement de 80 hommes (un lieutenant-colonel, un major, un sergent-major, 10 officiers du renseignement, 15 opérateurs-radio, 10 pilotes de liaison, 15 médecins de combat et 27 mécanciens) disposant en matériel de six véhicules blindés légers, un véhicule de transmission radio et deux hélicoptères moyens de transport pour la liaison. On compte ensuite une compagnie d'aviation de 85 hommes (un capitaine, un lieutenant, 8 pilotes, 8 ailiers, 10 opérateurs-radio, 57 mécaniciens) chargé d'assurer un poste de commandement aérien pour la brigade et s'assurer des liaisons stratégiques et comportant 8 hélicoptères moyens de transport. On compte ensuite une compagnie de transport lourd de 90 hommes (un capitaine, un lieutenant, 16 pilotes, 16 ailiers, 56 mécaniciens) chargé d'assurer le transport lourd du matériel et des troupes avec à sa disposition 8 hélicoptères de transport lourd. On compte également une compagnie d'évacuation médicale de 85 hommes (un médecin aéronautique, un lieutenant, 16 pilotes-médecins, 16 ailiers-infirmiers, 10 médecins de combat, 41 mécaniciens) disposant pour sa mission de 8 hélicoptères de transport moyens. On retrouve ensuite une compagnie de maintenance de 80 hommes (un capitaine, 20 techniciens avionique, 20 mécaniciens, 20 spécialistes en armement et 19 techniciens de transport) chargés de la maintenance des hélicoptères du bataillon et disposant de 5 camions de transports et 5 camions citernes pour accomplir son rôle de maintenance. Enfin, le bataillon compte une compagnie de soutien de 80 hommes (un capitaine, deux sous-officiers en charge des stocks, 30 opérateurs de ravitaillement, 30 gestionnaires de munitions et 17 techniciens) chargés de la gestion des ressources logistiques du bataillon et disposant en plus de cela de 6 camions de transport et 5 camions citernes. Au total, le bataillon de soutien au combat aéromobile compte 500 hommes.
Equipement : x18 hélicoptères de transport moyen + + x8 hélicoptères de transport lourd + x6 VBL + x1 véhicule de transmission radio + x11 camions de transport + x10 camions citernes.
Enfin, on retrouve le bataillon de soutien qui n'est rien de moins que l'unité clé de toute la brigade puisque c'est le bataillon spécialisé spécifiquement dans le déploiement rapide de l'infanterie au sol, l'appui aux opérations aériennes et la mobilité des forces. C'est le bataillon qui se charge en somme des assauts aériens en eux-mêmes, soutient massivement les forces terrestres en leur fournissant du personnel et du matériel par voie aérienne, etc. Le bataillon de soutien compte une compagnie de commandement de 80 hommes (un lieutenant-colonel, un major, un sergent-major, 10 officiers du renseignement, 15 opérateurs-radio, 10 pilotes de liaison, 15 médecins de combat et 27 mécanciens) disposant en matériel de six véhicules blindés légers, un véhicule de transmission radio et deux hélicoptères moyens de transport pour la liaison. On compte ensuite les compagnies dites d'assaut qui sont chargées du déploiement rapide de l'infanterie et de leur soutien au sol. Chaque compagnie d'assaut compte 90 hommes (un capitaine, un lieutenant, 16 pilotes, 16 ailiers, 56 techniciens) et comporte chacun 8 hélicoptères de transport moyen ; le bataillon de soutien compte au total trois compagnies d'assaut. On retrouve ensuite une compagnie de maintenance de 80 hommes (un capitaine, 20 techniciens avionique, 20 mécaniciens, 20 spécialistes en armement et 19 techniciens de transport) chargés de la maintenance des hélicoptères du bataillon et disposant de 5 camions de transports et 5 camions citernes pour accomplir son rôle de maintenance. Enfin, le bataillon compte une compagnie de soutien de 80 hommes (un capitaine, deux sous-officiers en charge des stocks, 30 opérateurs de ravitaillement, 30 gestionnaires de munitions et 17 techniciens) chargés de la gestion des ressources logistiques du bataillon et disposant en plus de cela de 6 camions de transport et 5 camions citernes. Au total, le bataillon de soutien compte 500 hommes.
Equipement : x26 hélicoptères de transport moyen + x6 VBL + x1 véhicule de transmission radio + x11 camions de transport + x10 camions citernes.
Si on résume les effectifs de chacun de ces bataillons, cela nous fait :
Soit un total de 1965 hommes pour l'ensemble de la brigade. En terme d'équipements, la brigade contient l'équipement suivant :
Organigramme actuelle de la 9ème Division Aéromobile :
Compte tenu des capacités actuelles de l'Armée Rouge en terme d'effectifs, celle-ci peut se permettre de mobiliser trois brigades de combat aéromobiles au sein de sa toute nouvelle division ainsi qu'une BHA en son sein. Au total, la 9ème Division devra compter en total 15 500 hommes en tout.