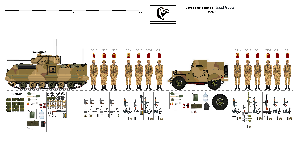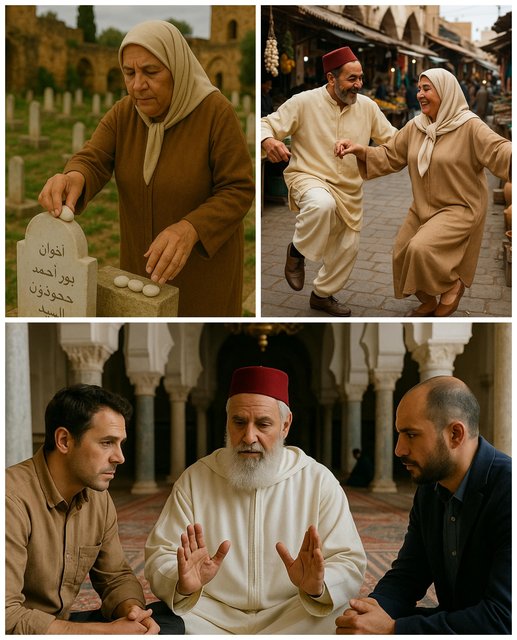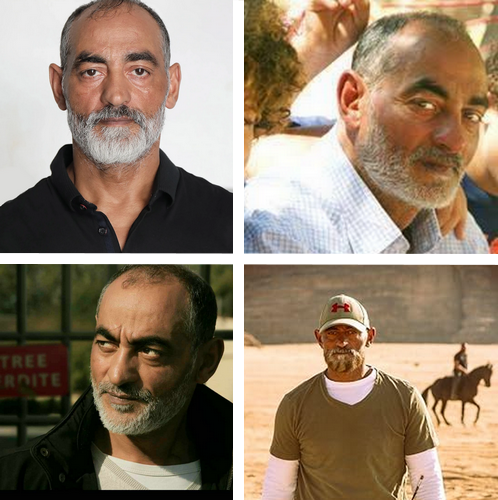HISTOIRE
- Drapeau du Bajusid, article
- Groupe de combat, Armée Républicaine du Bajusid, article
- Joubair Toulali, article
- Les célébrations du renouveau “Al-Badî” (البديع), article
- 2014 - La résurgence de l'artisanat bajusid, article
- La culture de la pistache, spécificité et opportunité du Bajusid, article