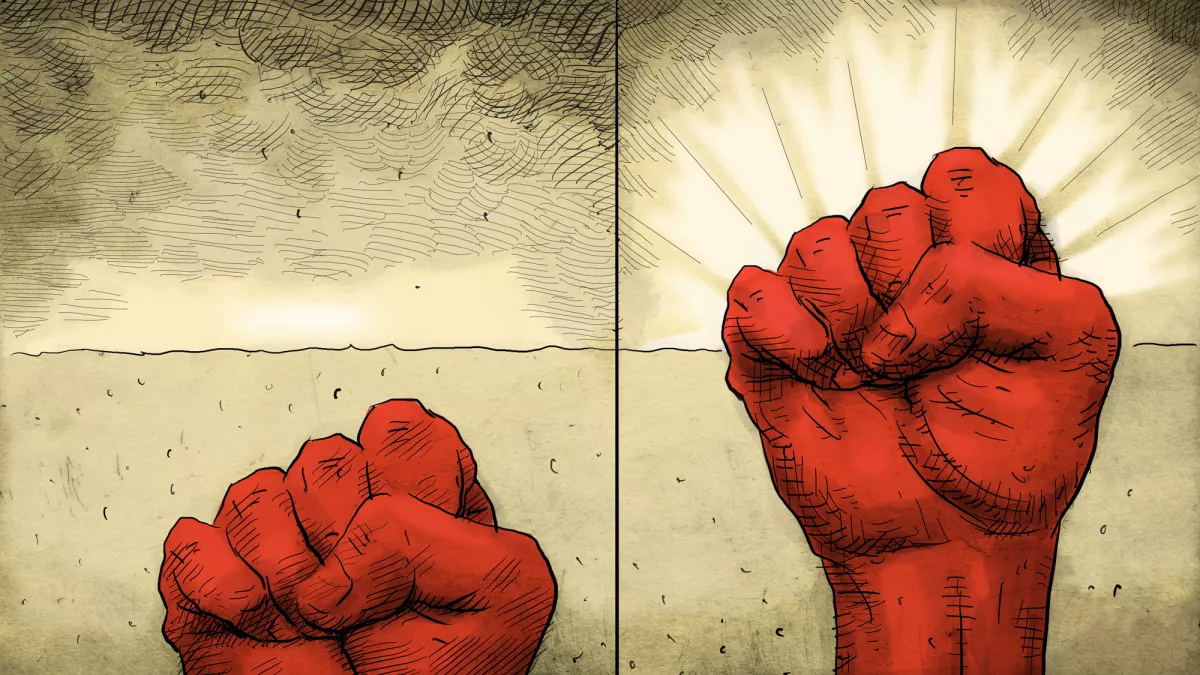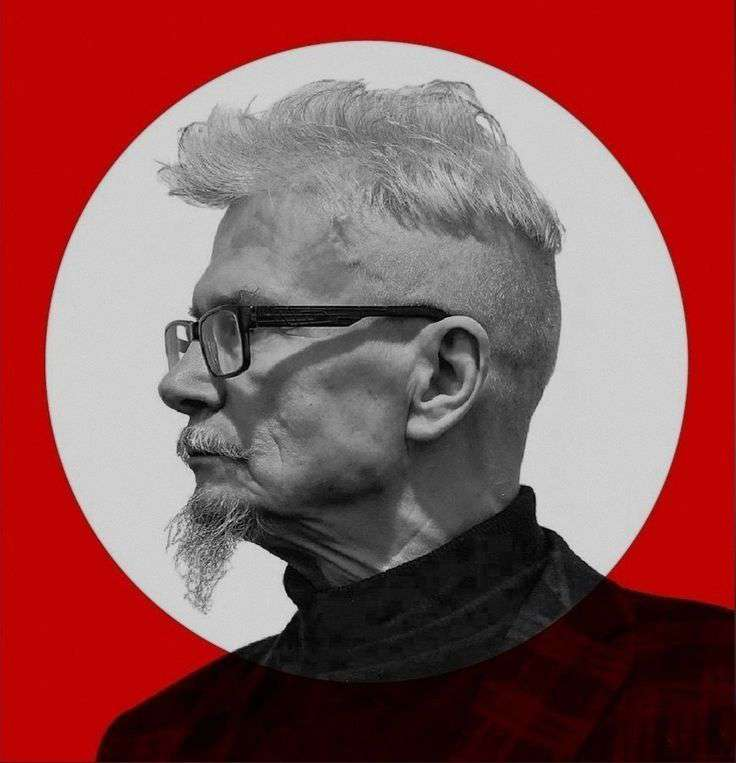Bien que le lari se soit stabilisé ces derniers mois et que la confiance soit revenue que ce soit en ce qui concerne le nouveau lari instauré par le Comité de Reconstruction ou dans la gestion des nouvelles institutions bancaires nationalisées de notre pays qui laisse entendre une socialisation du secteur bancaire et la fin de l'exploitation du travail du prolétariat par la clique bancaire et financière supérieure, il n'empêche qu'un nouvel acteur semble profiter de la relative faiblesse toujours systémique de la monnaie kartvélienne et de la peur naturelle que la population kartvélienne continue d'exercer à l'encontre du gouvernement technique mis en place en désespoir de cause afin de stabiliser économiquement le pays dans l'attente de la mise en place d'institutions politiques solides. Cette peur se traduit pour beaucoup par l'autonomisation des moyens économiques de leurs communes respectives pour certains, par l'utilisation abusive du troc pour d'autres mais pour la plupart, surtout au sud, c'est l'utilisation de l'unitas comme monnaie d'échange qui est probablement le signe le plus évident du manque de confiance sur la longévité de la stabilité kartvélienne. Car certes, l'économie s'est stabilisée et le niveau de vie a pu remonter un peu partout en Kartvélie, les services publics fonctionnent de nouveau, le chômage est en chute libre, les coupures d'électricité se font moins fréquentes et le pays a fini par retrouver une activité économique plus ou moins régulière ; les disettes ont d'ailleurs finis par disparaître grâce à l'abondance de biens alimentaires issus de notre propre agriculture ainsi que l'aide humanitaire généreuse de l'Estalie qui a exporté massivement des biens alimentaires à bas prix parmi la population, mettant ainsi fin aux disettes et permettant une certaine sécurité alimentaire dans tout le pays.
Ce tableau à priori satisfaisant ne doit pas cependant laisser dupe les observateurs les plus avisés : l'influence économique estalienne croît à tous les niveaux et l'utilisation de l'unitas en est non seulement la preuve mais aussi le symptôme dont l'Estalie semble utiliser abondamment de façon volontaire. Si les premières utilisations de l'unitas dans le sud du pays semblaient involontaires de la part de Mistohir, beaucoup de personnes au sud ayant avant la Révolution profiter de relations commerciales mineures avec l'Estalie et donc ont avaient quelques unitas en poche, les ont utilisés en public alors que lari s'effondrait. Par effet domino, cette utilisation cantonnée à quelques centaines de personnes s'est élargi sous la pression du déclassement monétaire que subissait le lari. Dans ce cas-là, on ne pouvait en vouloir ni aux méridionaux ni à l'Estalie : le lari ne valait rien et il fallait bien manger. Or, aujourd'hui, le lari a repris un cours normal et pour cause, il a été indexé sur l'unitas bien plus stable ; de ce fait, aujourd'hui, l'utilisation de l'unitas n'est plus sensée apporter de bénéfices quelconques et ne peut être d'actualité aujourd'hui. Pourtant, son utilisation progresse au point d'être l'unique monnaie en circulation (en dehors du troc toujours actif même si ce mode d'échanges décline naturellement avec le temps) dans un bon tiers des communes du pays. Autant dire que ce n'est que la première étape de la disparition de notre monnaie nationale. La seconde étape vient directement de la Banque Populaire, la banque centrale de l'Estalie, qui s'est visiblement donné le droit de promulguer la parole d'évangile bancaire à toute la Kartvélie et avec l'aval de la Chambre des Négociations et du Comité de Reconstruction, une approbation par ailleurs plus que douteuse. En effet, le 9 Mai dernier, la Banque Populaire a émis une note à l'attention des banques et des coopératives kartvéliennes, notant qu'elle était désormais en capacité d'offrir des crédits libellés en unitas à des taux préférentiels pour toute coopérative kartvélienne se situant dans une commune utilisant l'unitas comme monnaie. La Banque Populaire semble se jouer du flou juridique actuel dû au manque d'institutions politiques, de Constitution ou de règlements sur les limites de la gouvernance locale des communes qui, en dehors de décrets du Comité de Reconstruction, sont libres sur leur politique économique, y compris malheureusement leur politique monétaire. De ce fait, rien ne leur interdit factuellement d'adopter le lari dans leurs échanges monétaires quotidiens ou commerciaux. Autant dire que les Estaliens le savent très bien et jouent sur ce trou dans la législation kartvélienne pour pousser les communes à adopter l'unitas afin de toucher le précieux argent estalien. Si certains se plaisent à dire que ces prêts restent économiquement avantageux et permettent, en échange d'une concession somme toute symbolique, le développement économique des coopératives, le coeur de l'autogestion et la base la plus solide de notre économie, cela reste un aveu de faiblesse. Pour certains autres, le lari devrait même être aboli en estimant que les élucubrations anti-estaliennes sur le lari et l'unitas sont des réflexes de nationalistes, le monde socialiste ne devrait avoir pour certains qu'une unique monnaie. C'est un point de vue qui se partage surtout chez les fédéralistes eurysiens, les même qui souhaitent la construction d'une Fédération des Peuples Eurysiens, autant dire que l'on sait déjà pourquoi ils ne voient le remplacement du lari qu'avec peu de considération, omettant l'idée que les Estaliens sont en train de coloniser économiquement le pays. Autrement, en plus de la Banque Populaire, le gouvernement fédéral estalien s'y est mis aussi avec un communiqué de presse de la Commission aux Finances qui a déclaré désormais que toutes les exportations et importations entre la Fédération des Peuples Estaliens et la Fédération des Communes de Kartvélie devront être libellées en unitas seulement. Autant dire que l'assiette des Kartvéliens dépendant en grande partie des importations estaliennes et que le seul pays à vouloir des exportations industrielles de la Kartvélie reste l'Estalie, c'est synonyme d'une prise d'otages monétaire. Non contents de nous imposer un commerce dans leur monnaie, la Commission aux Finances a aussi déclaré que les communes kartvéliennes utilisant l'unitas auront un accès désormais préférentiel aux produits estaliens exportés en Kartvélie, que ce soit le prix même des biens exportés ou la priorité d'accès de ces derniers. Si la Commission a bien précisé que cette mesure excluait les produits agricoles et alimentaires dont l'accès restera le même pour l'ensemble de la Kartvélie, cela relève d'une véritable prise d'otages. Les Kartvéliens étant davantage préoccupés par leur niveau de vie que par la souveraineté monétaire de leur pays, il est évident que d'ici les prochaines semaines et les prochains mois qui vont suivre, l'unitasisation de notre tissu économique va non seulement s'accroître mais va aussi pousser à la disparition progressive du lari. Si certains ont loués l'idée d'une union monétaire, en l'état actuel des choses, il est invraisemblable que nos besoins monétaires soient en concordance avec ceux de l'Estalie et il est même probable que l'Estalie ne cherche même pas une dite union monétaire avec nous : en vérité, leur économie étant plus stable que la nôtre, il est plus probable qu'une telle union leur soit défavorable ou nous en apporte plus qu'à eux. Non, ils cherchent uniquement à nous rendre dépendants en faisant pression sur le portefeuille et l'assiette de nos concitoyens, rien de plus.
Des protestations ont déjà éclatés à Tbilgorod devant le siège du Comité de Reconstruction, accusée d'être trop estaliophile dans sa politique de reconstruction et de faire trop de concessions à l'Estalie. Des manifestants ont même hués les soldats de la 2ème Brigade Blindée estalienne actuellement stationnés dans les alentours de la capitale, leur intimant de partir et les insultant de "colonialistes" et "d'impérialistes". Après avoir tant critiqué l'impérialisme et le capitalisme bourgeois, l'Estalie est prise la main dans le sac en train de commettre exactement la même colonisation en Kartvélie ! Néanmoins, ces protestations, même si elles ont regroupés près de 10 000 personnes dans la semaine, semblent minoritaires dans l'opinion publique. Déjà dû à la présence médiatique de plus en plus forte des fédéralistes mais surtout à cause de l'apathie générale de cette situation pour la majorité silencieuse : beaucoup veulent seulement travailler, nourrir leurs familles et regagner le niveau de vie d'avant la révolution. Or, beaucoup travaillent dans des coopératives qui dépendent du financement à crédit des Estaliens ou mangent grâce aux caisses humanitaires estaliennes. La dépendance est donc grande et seule une faible partie de la population urbaine de la capitale qui dispose d'une large épargne en moyenne et sont souvent des indépendants travaillant à leur propre compte dans des espaces mutualisés. En bref, des îlots d'indépendance économique au milieu d'un tissu dont la vie dépend de décisionnaires étrangers dans la plupart des cas.
D'un point de vue économique, beaucoup ont estimés que la perte de souveraineté était non seulement insensée comme argument en plus d'omettre les avantages indéniablles de l'unitasisation. Pour certains médias pro-Comité, la souveraineté monétaire n'a ici pas beaucoup de sens dans le cadre des rapports Estalie-Kartévlie, les deux nations anarchistes sont destinées à se rapprocher et d'exploiter leurs forces communes et force est de constater que la monnaie estalienne est une force dont peut se servir à terme les Kartvéliens eux aussi. Les médias énoncent les avantages de l'augmentation de l'usage de l'unitas comme la stabilisation de l'économie en réduisant grandement l'inflation et en limitant les fluctuations monétaires, ce qui peut s'avérer d'une utilité immense dans notre pays où le taux d'inflation est globalement très élevé. De plus, l'adoption de l'unitas permettrait une augmentation relativement importante des échanges commerciaux entre la Kartvélie et l'Estalie et permettrait de réduire les coûts de transaction pour les coopératives et les particuliers avec l'Estalie, les coûts liés au change pouvant être un obstacle au commerce bilatéral. Ce que ces médias omettent face à ces avantages, c'est cependant tous les défauts qu'un tel phénomène apportera à l'économie kartvélienne : la banque centrale perdra toute forme de souveraineté sur la politique monétaire du pays par exemple, nous ne pourrons plus fixer nos propres taux d'intérêt en fonction de nos besoins ou mener de l'impression monétaire en cas de ralentissement économique pour stimuler l'économie. Nous serions dépendants des conditions économiques et politiques estaliennes : en cas de crise économique ou de changement politique majeur en Estalie, le choc extérieur pourrait très bien nous renvoyer à l'âge de pierre ! Enfin, nous perdons le droit de seigneuriage sur notre monnaie, le pays perdra tout profit en lien avec l'impression de sa monnaie, un profit qui revient directement dans les caisses de l'Etat. Vu l'état des finances publiques, ce serait nécessaire pour l'Etat d'avoir le plus de sources de recettes budgétaires possible. Or, avec l'unitas, on s'en prive volontairement !