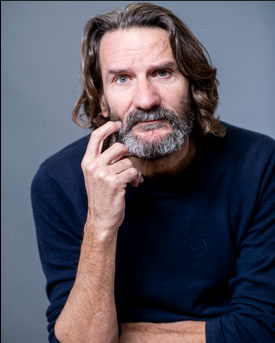Les Casinos Nérème
Fondation : 3 juillet 1909
Activités : Salon de jeux de hasard, lieu d'accueil de l'événementiel
Gouvernance : Société anonyme par actions ; président du conseil d'administration : Monsieur Antonin Flavoni.
Siège social : Hôtel Nérème, VIIème arrondissement de Messalie.

Histoire :
Messalie connaît cette vague à l'orée du XIXème siècle, après trois décennies de Révolution industrielle intense qui propulse les grandes familles détentrices de capitaux à un niveau inédit de richesse. A Carnavale, la Belle époque s'annonce déjà comme une période de fastes et de croissance et, sous la Princesse Eugénie, les casinos se multiplient. S'inspirant de leur réussite, le capitaine d'industrie Jaime Auguste Nérème, issu d'une ancienne famille d'oligarques messaliotes, entreprend la construction d'un beau palais en front de mer, et crée sa société des Casinos Nérème : cet établissement, qui devient le plus grand du type dans tout le pays, est un passage obligé pour les touristes fortunés qui veulent s'y essayer au poker, au blackjack, à la roulette russe et à toute sorte de jeux, à partir de 1909.
Dans les années 1920 et 1930, les Casinos Nérème enregistrent de faramineux profits qui sont petit à petit grevés à la fin des années trente, alors que monte une instabilité économique et politique qui inquiète. Le régime de la Concorde, installé d'une main de fer par le Premier-Directeur Antoine de Barrigue entre 1930 et 1952, rétablit l'ordre et les profits pleuvent à nouveau ; les yachts se multiplient dans le port de Messalie et l'Hôtel Nérème devient un passage obligé, un pèlerinage pour la grande bourgeoisie espérantine.
L'arrivée du Parti républicain, social et conservateur, au pouvoir à partir de 1961 rend l'exercice plus délicat, et les fastes des Casinos Nérème, comme le Trophée de la Plage qui faisait vivre un Club Automobile dynamique, est interdit ; le tir du Grand Feu d'Artifice de la Saint-Sylvestre, après avoir provoqué des incendies dans les quartiers avoisinants, est également banni. Les autorités réglementent également drastiquement les jeux, et interdisent leur pratique en-dehors des maisons à l'accès limité ; la Loterie est nationalisée.
En 1969, un fait divers défraie la chronique : celui du braquage du Casino par des membres de la pègre, qui font irruption dans la soirée du 19 avril à l'occasion de la fête d'anniversaire du comte de Plévenol, et qui s'emparent de plusieurs millions de drachmes en bijoux et en jetons ; l'affaire des jetons continuera d'entacher durablement la réputation des Casinos Nérème, avec des secousses successives liées à la distribution de faux jetons de jeux dans les années qui suivent.
Il faudra attendre 2012 et la suspension des pouvoirs du Parti républicain pour que soient levées des restrictions aux jeux d'argent ; la Loterie est à nouveau privatisée à l'orée de l'année 2013, permettant aux Casinos Nérème de sortir d'une léthargie relative, et au secteur des jeux d'argent de connaître à nouveau une croissance importante qui motive l'entrepreneur du luxe et de l'hôtellerie, Antonin Flavoni, à s'en rendre président du conseil d'administration avec de grands objectifs pour restaurer la grandeur de ce qui fut le plus grand casino de la côte messaliote.