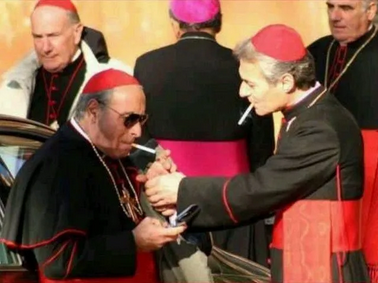Teyla

Mais les souverains teylais, à la lumière de défaites militaires, d'une économie faisant respecter le serment de pauvreté trop à la lettre à toute la Couronne, cherchèrent à s'accaparer plus de pouvoir. Le pouvoir royal cherchait à se renforcer tant sur le pouvoir économique, les pouvoirs locaux que sur le pouvoir religieux. Les rois n'entrèrent pas, ou très rarement, en conflit ouvert avec l'Église. Ils étaient, malgré les différents, légitimes grâce à cette dernière et restaient pour la plupart des croyants inébranlables. La colonisation n'aida en rien l'Église de Catholagne à maintenir son pouvoir auprès du pouvoir royal et des élites. Les politiques brutales et inhumaines, comme les décrets de pureté dans la Colonie de Fort-De-Grâce, trouvèrent une résistance dans une partie des membres de l'Église, jugeant ces actes en dehors de la moralité catholique. Mais l'Église teylaise aida en grande partie à la justification de ces actes et à la défense de ceux-ci. Le protestantisme, déjà présent au Royaume de Teyla, prit une ampleur sans précédent, créant des troubles religieux, souvent réglés à coup de gardes royaux.
Dans les années mille huit cent quarante, après de nombreuses tensions religieuses et un affaiblissement du pouvoir royal, qui était censé être de droit divin et absolu, une guerre civile commença au Royaume de Teyla. Elle fut, non pas soudaine, mais tout de même surprenante pour les élites, économiques, politiques et religieuses. La mort du roi avait laissé un gamin sur le trône, qui n'était même pas dans la capitale. Envoyé par son père dans les tréfonds du Royaume pour assurer sa protection, que pouvait-il faire alors que les familles prétendantes au trône de la Prospérité se déclaraient comme légitimes successeurs de feu son père ? Il mit du temps, mais il prit les armes tandis que les deux autres prétendants se combattaient sur le champ de bataille pour le trône de la Prospérité. Ce gamin devint adulte et après vingt ans de guerre civile, le Royaume de Teyla lui devait obéissance. Il avait réussi à reconquérir le pays, mais à quel prix ? C'est ce prix, et afin que le sang ne coule pas encore dans de telles proportions, que Raymond VI entama une démocratisation et libéralisation du régime. Bien que le souverain resta puissant, avec un droit de veto sur le Parlement notamment, le Royaume changea de régime pour une monarchie constitutionnelle, dans laquelle l'État devint laïque et le Roi ne trouva plus sa légitimité dans la religion en tant que représentant de Dieu, mais bel et bien en tant qu'arbitre de la nation et représentant suprême du peuple, de la volonté populaire.
L'instauration de la monarchie constitutionnelle et la proclamation de la laïcité de l'État furent pour l'Église Catholique Teylaise bien plus qu'une défaite, ce fut un choc moral et politique pour les membres de l'Église. Les prêtres, évêques et cardinaux étaient du jour au lendemain les salariés d'une entreprise, une organisation privée. Ils ne répondaient plus pour le bien de l'État, mais pour le bien de l'Église elle seule. Les débats étaient nombreux à l'intérieur de l'institution. Quand certains voyaient un affront et un affaiblissement auquel il serait impossible de se remettre, d'autres voyaient une liberté de parole et d'action donnée par l'État. Les derniers avaient raison quand les premiers avaient tort. Ceux, au sein de l'Église Catholique Teylaise, qui voyaient un désastre étaient dans une position stérile pour le débat. Leurs anathèmes lancés contre le Souverain et le Parlement atteignaient une population de moins en moins importante, de moins en moins nombreuse. Ceux qui, au contraire, voyaient dans la décision une liberté retrouvée vis-à-vis d'un pouvoir royal, d'un pouvoir politique, prirent en main l'Église Teylaise tout au long du siècle dernier, presque de manière discontinue, jusqu'à aujourd'hui.
Le Royaume de Teyla avait ce charme, diront certains, d'être une nation progressiste en matière sociétale, mais une nation de droite, conservatrice, voire pour les plus vilipendeurs réactionnaire sur le plan économique. La liberté, tant nécessaire dans la société et la démocratie, s'était étendue, à des manières peut-être extrêmes, sur le domaine économique. Mais c'est toute une société qui fut frappée dès les années cinquante par un progressisme, qui s'installa petit à petit dans les esprits. L'Église, peut-être avec un wagon de retard, avait pris ce chemin là aussi, tout en respectant les dogmes de l'Église Catholagne. Un prêtre avait résumé en une phrase la relation qui liait les deux institutions : "Différent mais fidèle". Le "serment" de loyauté était devenu un tabou dans l'institution ; une simple remise en cause provoquait des remous importants et tout un système venait remettre en cause le discours, l'argument, si pertinent soit-il.
Mais dans la continuité de la pensée majoritaire teylaise, le mot "liberté" restait une doctrine, une valeur fondamentale. L'Église Teylaise devait garder sa liberté par principe, mais aussi car c'est même le meilleur moyen pour conquérir les esprits et les cœurs teylais, si on parle le langage du pays. Cette Église, avec une toute nouvelle génération de prêtres, trouva dans le libéralisme économique une cause, non pas à défendre mais à combattre. Les parements liturgiques, parfois usés comme un bleu de travail, se retrouvaient dans les alentours des usines, des quartiers populaires. Les églises étaient ouvertes aux pauvres, auxquels on apportait des vêtements chauds, de la nourriture et autres nécessaires de vie. Les générations teylaises, depuis les années mille neuf cent quatre-vingts, avaient compris l'importance du tissu associatif dans le contexte social et économique teylais. Elles faisaient ce que l'État ne faisait pas. Le prêtre était l'une de ces associations locales sur laquelle on pouvait compter. Peut-on parler de Dieu à un homme que l'État salit et qui a faim ? C'était là la question, qui n'était toujours pas tranchée.
Mais malgré tout cela, l'Église Teylaise ne parvint pas à faire soulever les foules. On dénombre environ trois millions de croyants, sur plus de quarante-trois millions d'habitants. C'était faible, l'un des plus faibles nombres de croyants catholiques au Royaume de Teyla, depuis les divers recensements et sondages d'opinion. Les élites et les classes dirigeantes s'étaient converties à un anticléricalisme dur et une horreur de la religion dans les affaires de l'État. On n'avait pas construit de bâtiment religieux depuis au moins une décennie au Royaume de Teyla. La loi l'autorisait, bien évidemment, mais les actions du Gouvernement en justice pour ralentir le processus se faisaient nombreuses. La justice finissait bien évidemment par donner les autorisations, mais après de longs mois, de longues années de combat juridique.
Mais cela avait abouti, depuis plusieurs décennies, à une politique d'effacement de l'Église au sein de la société civile par le pouvoir politique. Certains y voient une réponse froide d'un système capitaliste face à un ennemi commençant à infiltrer les milieux populaires face aux politiques libérales. Mais cette réponse, cette volonté d'effacement avaient commencé bien avant la mue de l'Église Catholique Teylaise. Les Teylais acceptaient les actions de l'Église mais en refusaient l'esprit, la foi qui se cachaient derrière ces gestes. Les Teylais restèrent hostiles aux religions, en règle générale, et cela valait pour l'Église de Catholagne et la religion catholique.
Alors, les trois cardinaux teylais, quand ils regardaient les candidats à la papauté, tous conservateurs, réactionnaires, parfois pédophiles et assumés, avaient envie de rompre ce lien de loyauté. Les deux Teylais, comme des boomers, ne reconnaissaient plus l'Église et disaient en chœur que c'était mieux avant. Est-ce vraiment le cas ? Tout le monde avait un avis tranché sur la question, y compris les trois cardinaux teylais. Ils en avaient débattu pendant des heures, devant les immenses vitraux de la Cathédrale de Manticore. Selon Michaux, la situation actuelle n'était que la répétition de l'histoire et une scission finirait par avoir lieu, notamment si un candidat pédophile ou meurtrier de candidat déclaré à la présidence gagnait l'élection. Le cardinal Dubois, le plus jeune de la représentation teylaise, était désabusé de la situation, presque lassé par ces jeux de pouvoir. Il mit en avant que les Teylais, fidèles à leurs valeurs, devaient voter pour un candidat qui défendrait la Chrétienté même lorsqu'elle était attaquée de l'intérieur, en faisant référence au meurtre de feu le cardinal Alexius Palamas.
Le cardinal Côté appuya le fait que le cardinal Cesare Crezzini était l'un des hommes ouverts au compromis et sûrement le plus progressiste du conclave, même si la notion de progressiste était ici peut-être à revoir, selon les trois hommes de pouvoir. Est-ce un vote d'approbation ? Clairement pas. Est-ce un vote de dépit et d'élimination des autres candidats ? Oui, assurément. Ils ne s'en cachaient pas, mais ils ne faisaient pas le tour des médias pour annoncer leurs volontés avant le Conclave. En bons hommes d'Église, ce qui était au Conclave, resta au conclave.
Quoi qu'il arrive, il fallait voter, se dirent les trois hommes se regardant avant de voter durant le Conclave.
M. Abraham Michaux (73 ans - Progressiste) vote pour Cesare Crezzini alias Augustin.
M. Étienne Dubois (55 ans - Progressiste) vote pour Cesare Crezzini alias Augustin.
M. Didier Côté (69 ans - Progressiste) vote pour Cesare Crezzini alias Augustin.
Total : 3 votes pour Cesare Crezzini alias Augustin.