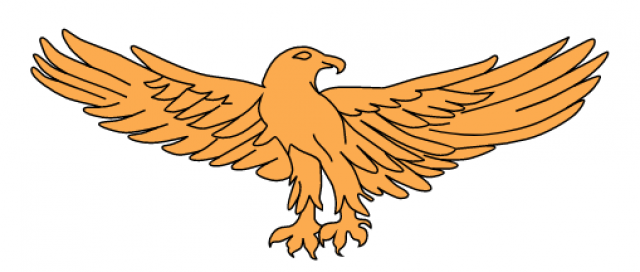Opération Libération
Arbitrage de ce post

Image d'illustration
Musique d'ambiance Ainsi, les Clovaniens voulaient sécuriser la rive sud du fleuve. Les Clovaniens, connaissant leurs adversaires, devaient se douter que ceux-ci allaient combattre avant de rendre les armes. Ce fut le cas, toutefois, avec plus de difficulté que sur le papier et dans la théorie. La stratégie de miner certains axes avec différents types d'explosifs aurait pu être efficace si des explosifs (des mines ici) avaient été véritablement engagés dans l'atlas. Les mines, bien que factices, et donc des leurres, avaient fait perdre du temps aux soldats clovaniens pour qu'ils comprennent la réalité de ces pièges, qui n'étaient que des leurres.
Les diverses autres stratégies tactiques étaient aussi utiles, mais significativement moins efficaces à cause des hélicoptères adverses. Ces derniers, en survolant constamment les zones d'engagement, réduisaient considérablement l'effet de surprise des actions du MLL. La plupart des embuscades et des tentatives de contournement étaient rapidement détectées puis neutralisées par des tirs clovaniens. Le MLL perdit assez vite et partout sur tout le front, une tragédie qui fut rapide pour les troupes du MLL. Le temps d'une journée, au maximum deux jours, suffit aux troupes clovaniennes pour nettoyer les dernières poches de résistance.

Cette attaque a eu des effets importants dans la région de cette partie du Gondo. La supériorité des Clovaniens et le soutien du gouvernement gondolais ne furent pas sans conséquences pour le MLL. Celui-ci se retrouva fort vite acculé et il était absolument évident qu'il dut se replier au-delà du fleuve. La conséquence est la sécurisation de l'aéroport, la dispersion des forces du MLL au sud du fleuve et leur retranchement autour de Toqubele.Pertes Armée Impériale : Généraux/commandement :- Hochette.
- Rieux.
Groupe A :-700 Armes légères d'infanterie niveau 5,
(-2)-30 Mitrailleuse lourde niveau 2,
(-2)-100 Mitrailleuse lourde niveau 10
-100 Lance-roquettes niveau 9
-10 Mortier léger niveau 1
-10 Véhicule blindé léger niveau 2
-10 Transport de troupes blindé niveau 2
-40 Véhicule léger tout-terrain niveau 2,
(-2)-100 Véhicule léger tout-terrain niveau 10
Groupe A :-3000 Armes légères d'infanterie niveau 5
-170 Mitrailleuse lourde niveau 2
-200 Mitrailleuse lourde niveau 10
-40 Mortier léger niveau 1,
(-1)-10 Lance-roquettes niveau 5
-100 Lance-roquettes niveau 9
-20 Mortier tracté niveau 1
-20 Canon tracté niveau 3
-3 Lance-roquettes multiple niveau 1
-40 Véhicule blindé léger niveau 2
-40 Transport de troupes blindé niveau 2
-160 Véhicule léger tout-terrain niveau 2
-16 Camion de transport niveau 1
-3 Hélicoptère léger polyvalent niveau 2
2 morts et blessésMLL :
Généraux/commandement :
- X, mort au combat.
Armée :
1000 armes d'infanteries légères, (-1000)
1000 morts et blessés* Ces pertes correspondent à une estimation des morts, disparus et déserteurs.