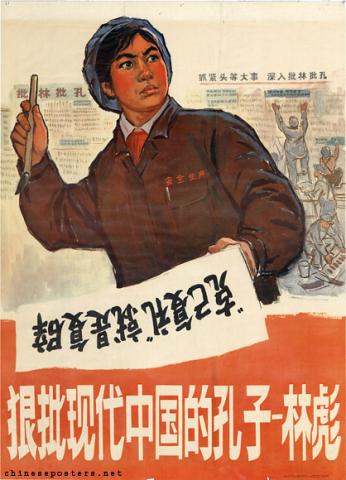Le modèle d’entreprises stranéens
De la République jusqu’aux entreprises, la logique stranéenne est évidemment socialiste, prônant l’égalité entre les individus et la mise en place de la démocratie. Afin de garantir la souveraineté du peuple et son unité, il est nécessaire que chaque travailleur puisse porter sa voix lors des différents processus décisionnels engagés. Ces enjeux inhérents à l’organisation des entreprises avaient été perçus par Viman Santoso, ancien ouvrier devenu héros de la Révolution le menant à être Premier Commissaire du Peuple durant plusieurs années. En effet, l’homme co-rédacteur de la Constitution 1962 y consacra plusieurs articles quant à l’organisation des Conseils des Travailleurs.
Concrètement, comment s’organise la démocratie dans les entreprises stranéennes ? Quels sont les Conseils des Travailleurs ?
Premièrement, chaque travailleur s’engage obligatoirement dans un syndicat. Théoriquement, plusieurs syndicats peuvent coexister au sein d’une entreprise, seulement en pratique, un syndicat a tendance à prendre le dessus sur les autres et à obtenir le monopole. Les travailleurs se réunissent en Conseil Local des Travailleurs pour prendre des décisions concernant l’unité locale de l’entreprise (une usine, une ferme, un centre, etc…) mais aussi élire, pour un mandat de deux ans révocable, un ou des Représentants d’Unité selon l’envergure de l’unité. Ces derniers, bien que égal aux autres travailleurs, disposent d’une autorité supplémentaire de fait et de jure pour diriger l’unité. Ils représentent leurs unité au Conseil Régional des Travailleurs, chargé d’assurer la cohésion des unités locales et de définir des objectifs communs afin de parfaire la production. Les Conseils Régionaux des Travailleurs, sous le même modèle que les Conseils Locaux des Travailleurs, élisent, pour un mandat de deux ans non révocable, des Représentants Régionaux au Conseil Central des Travailleurs. Ce dernier détermine la politique globale de l’entreprise, l’installation de futurs unités et élit le Président Directeur Général. Suite aux réformes de privatisation effectuées dans le cadre du Renouveau Socialiste, le Conseil Central des Travailleurs est également composé des actionnaires privés proportionnellement aux parts de l’entreprise. Enfin, tous les PDG font partie du Conseil de Direction Économique, un conseil consultatif présidé par le Commissaire du Peuple à l'Économie.
Historiquement, le Syndicat du Peuple Socialiste et Libéré a dominé, voire monopolisé la vie syndicale. Aujourd’hui, le pluralisme existe sur le plan national (car la tendance au monopole dans les unités est très forte, quel que soit le syndicat) mais aussi international. En effet, avec l’internationalisation des activités entrepreneuriales stranéennes, l’implantation de nouvelles unités à l’étranger a mené à la création de nouveau Conseil Régional des Travailleurs au sein des entreprises et a permis l’introduction les syndicats locaux dans le système stranéen. Ainsi, les travailleurs étrangers ont tout autant la possibilité de participer au processus décisionnel, étant impliqués dans la production de l’entreprise de façon égale.
Les entreprises stranéennes au Mokhaï
L’introduction des entreprises stranéennes au Mokhaï telles que l’Agence Coordinatrice des Industries Stranéennes (Badan Koordinatis Industri Strana, BKIS) et Asteneko Strana n’ont pas été sans conséquence. Après avoir pris connaissance du modèle organisationnel stranéen, l’impact de la participation des travailleurs locaux au processus décisionnel est la première conséquence, bénéfique aux peuples et à la démocratie. Néanmoins, un enjeu sous-jacent constitue une conséquence d’autant plus, voire plus importante que cela.
Si la participation des travailleurs étrangers influence les politiques des entreprises stranéennes, il est également incontestable que les entreprises stranéennes influencent les travailleurs étrangers. Effectivement, le modèle stranéen semble satisfaire les travailleurs mokhaïens. Selon un sondage réalisé auprès des travailleurs de la BKIS et d’Asteneko Strana, 86% d’entre eux déclarent être satisfait de ce type d’organisation démocratique, dont 72% voulant l’étendre nationalement. Partageant cette idée, Guanan Jin, travailleur d’Asteneko Strana et Représentant d’Unité au sein Conseil Régional des Travailleurs du Mokhaï, milite pour convaincre les mokhaïens: “Etablir la démocratie au sein des entreprises est nécessaire pour consacrer pleinement la souveraineté du peuple mokhaïen. Cela avait été rendu possible lors du régime précédent, largement influencé par les idées venues du Grand Kah. Aujourd’hui, nous sommes en période de changement mais il est primordial de garder ce genre de modèle. L’installation des entreprises stranéennes nous le permet et nous devons nous en inspirer pour l’étendre nationalement. C’est pour cela que le Mokhaï doit soutenir Lei Wuying lors des prochaines élections !”.
Effectivement, les prochaines élections présidentielles et législatives fédérales sont directement impactés par la diffusion du modèle stranéen. Parmi les différents partis et personnalités candidats se trouve Lei Wuying du Mouvement Anarcho-Communaliste, portant des idéaux favorables au Negara Strana et à son modèle démocratique d’entreprise. Aujourd’hui, l’essentiel des syndicats appelle à soutenir la jeune candidate, prenant en exemple le fonctionnement interne de la BKIS ou d’Asteneko Strana, souvent décrié par les conservateurs mokhaïens. Le Mouvement Anarcho-Communaliste et ses nombreux militants proposent un autre discours que celui relayé communément au Mokhaï quant à la présence stranéenne. Alors que ses opposants y voient un impérialisme criant, Lei Wuying souligne les opportunités qu’apportent le Negara Strana, proposant constamment au peuple mokhaïen une participation au processus décisionnel.