Posté le : 08 nov. 2022 à 23:16:57
Modifié le : 11 mai 2025 à 23:15:24
33946
Partie III : Le Déchaînement de la Raison Critique ? Zèle, Principes Fondateurs de 1781 et l'Héritage Disputé des "Lumières" Spécifiquement Kah-tanaises
Chapitre 5 : Les "Lumières Spécifiquement Kah-tanaises" Hors de leur Contexte Originel ? Critique Interne des Usages Dogmatiques des Principes de 1781 et de la Figure Sacralisée des Fondateurs
L'invocation des principes révolutionnaires de 1781 – la souveraineté populaire inaliénable, l'autogestion communale comme fondement de la vie politique, la critique radicale de toute autorité non émanant du peuple – est une constante dans le discours public kah-tanais. Ces principes constituent, à n'en pas douter, le socle de notre identité confédérale, l'horizon normatif de notre praxis. Cependant, la question cruciale qui se pose à chaque génération de citoyennes et citoyens est de savoir si ce legs constitue un corpus doctrinal figé, une sorte de texte sacré dont l'interprétation serait réservée à une caste d'exégètes autoproclamés, ou s'il représente plutôt un "programme de recherche" permanent, un ensemble de questions ouvertes et de défis à relever, dont la signification doit être constamment réactivée, réinterprétée et adaptée aux conditions nouvelles par la délibération collective au sein des communes.
Le Collectif "Vigilance & Praxis" estime qu'il est temps de dénoncer avec vigueur et sans complaisance les usages dogmatiques et sclérosants de cet héritage fondateur. Nous voyons trop souvent des "rentiers de la Révolution", installés dans les rouages des Commissariats ou à la tête de certaines communes influentes, invoquer l'esprit de 1781 et la mémoire sacralisée des Fondateurs non pas pour stimuler l'innovation et la critique, mais au contraire pour justifier le statu quo, pour freiner les réformes sociales et écologiques urgentes, ou pour imposer une orthodoxie idéologique étouffante qui se méfie de toute pensée dissidente. Ces "gardiens du temple" transforment un héritage vivant en une relique stérile, un appel à l'audace en un rappel à l'ordre. Leur "zèle" pour la lettre des principes de 1781 masque mal leur manque de zèle pour leur esprit.
Il est instructif, à cet égard, de transposer à notre contexte la figure (que nous construisons ici à des fins heuristiques) du "philosophe satiriste" kah-tanais, héritier lointain de certains esprits caustiques des Lumières eurysiennes. Ce critique acerbe de toute forme de zèle dogmatique, de toute prétention à détenir la vérité absolue, de toute rhétorique enflammée qui occulte la complexité du réel, verrait sans doute dans certaines manifestations contemporaines de "l'esprit de 1781" une forme de fanatisme laïc, une nouvelle religion civique avec ses propres prêtres, ses propres rites et ses propres hérétiques. Face à lui se dresserait la figure du penseur de la "volonté générale" et de la passion civique (un autre archétype inspiré des Lumières eurysiennes, mais profondément remanié par notre tradition communaliste). Pour ce dernier, l'engagement total, la ferveur populaire, le sacrifice pour la collectivité sont les conditions indispensables à la survie et à la vitalité du Kah. Loin d'être des pathologies, ces manifestations de "zèle" seraient l'expression même de la souveraineté populaire en acte. Ces deux figures archétypales, et les tensions qu'elles incarnent entre raison critique et passion collective, entre scepticisme et engagement, continuent de structurer en profondeur les débats politiques et intellectuels au sein de notre Confédération.
Chapitre 6 : Le "Philosophe Critique de Lac-Rouge" et la Distinction Cruciale, pour la Survie du Kah, entre Enthousiasme Révolutionnaire Constructif et Zèle Dogmatique Destructeur
L'enthousiasme civique, cette participation affective et désintéressée des citoyennes et citoyens (y compris de ceux qui, éloignés des centres de décision, observent et commentent les événements) lors des grandes avancées révolutionnaires de notre histoire – que ce soit l'abolition des derniers vestiges du servage agraire à la fin du XIXe siècle, la mise en place des premiers Communets dans les années 1970, ou le formidable élan de refondation démocratique après la chute de la Junte en 1992 – constitue, pour une pensée kah-tanaise inspirée par le philosophe critique de la lointaine Königsberg eurysienne, un signe tangible. Non pas un signe de la grâce divine ou d'une quelconque prédestination, mais un signe de la capacité de l'esprit humain collectif, lorsqu'il est guidé par des principes justes et qu'il agit dans la liberté, à progresser vers un mieux, à surmonter les obstacles et à se rapprocher de l'idéal du Kah.
Cependant, cette même tradition de pensée critique nous enjoint de distinguer avec la plus grande rigueur cet "enthousiasme" constructeur, qui est joie partagée et espérance active, d'une autre forme de ferveur, bien plus périlleuse : le "zèle dogmatique", l'équivalent de ce que le philosophe eurysien nommait la Schwärmerei. Ce zèle exalté et irrationnel, souvent porté par des individus ou des factions se croyant investis d'une mission particulière ou détenteurs d'une vérité supérieure, se caractérise par une illusion dangereuse : celle d'un accès direct et immédiat à la vérité absolue du Kah, court-circuitant ainsi la médiation indispensable et parfois laborieuse du débat communal, de la délibération collective contradictoire, et de l'expérimentation pratique prudente. Ce zèle dogmatique, au lieu de s'appuyer sur la raison partagée, se fonde sur une prétendue "intuition" privilégiée, sur une "révélation" intérieure inaccessible à la critique. Il est, par essence, anti-démocratique et potentiellement liberticide.
La question du "fanatisme moral" – concept que nous empruntons ici, de manière provocatrice, à un philosophe vitaliste eurysien qui l'utilisait pourtant pour fustiger la morale de l'abnégation, mais que nous retournons ici contre toute forme de rigorisme abstrait – se pose alors avec une acuité particulière. La morale exigeante du Kah, qui appelle chaque citoyenne et citoyen au dévouement envers la communauté, au sacrifice personnel pour la cause de la Révolution Permanente, à une vigilance constante contre les forces de la réaction, peut-elle elle-même, paradoxalement, devenir une source de "fanatisme" ? Oui, si elle est imposée de manière abstraite, dogmatique, déconnectée des réalités humaines et des aspirations singulières des individus et des communes. Le cas controversé des méthodes inquisitoriales parfois employées par l'Égide au nom de la "pureté révolutionnaire", ou l'extension rampante de la surveillance numérique sous prétexte de sécurité confédérale, sont des exemples de cette dérive possible où la vertu se transforme en terreur, et où le zèle pour le Bien commun devient l'alibi de la suppression des libertés.
L'héritage de cette pensée critique, que nous cherchons à acclimater et à radicaliser au sein de la tradition kah-tanaise, est donc clair : il réside dans la nécessité impérieuse d'une auto-critique permanente, d'une vigilance de tous les instants, au sein de toutes les instances de la Confédération, des plus modestes assemblées de quartier aux plus hautes sphères de la Convention Générale. Pour que l'adhésion fervente et nécessaire aux principes fondateurs du Kah ne dégénère jamais en un "zèle inconditionnel" aveugle, sectaire et destructeur, pour que la flamme de l'enthousiasme révolutionnaire continue d'éclairer notre chemin sans nous consumer, il nous faut sans cesse cultiver l'esprit critique, le doute méthodique, le respect de la pluralité des voix, et la soumission de toute conviction, aussi ardente soit-elle, à l'épreuve de la délibération collective et des conséquences pratiques. C'est à ce prix seulement que le Kah pourra demeurer un projet vivant d'émancipation et non une idole morte exigeant des sacrifices humains.
Partie IV : La "Révolution de l'Un" et ses Échos Dévastateurs : L'Idolâtrie de l'État-Nation Eurysien, le Dogmatisme des Sections et la Menace sur la Diversité Communale Kah-tanaise
Chapitre 7 : Le "Fanatisme de l'Un" dans la Dialectique Idéaliste Eurysienne et sa Pertinence Inattendue pour une Critique Radicale des Dérives Centralisatrices et Nationalistes au Sein et Hors de la Confédération Kah-tanaise
L'examen des pathologies du zèle ne saurait se limiter aux seules manifestations individuelles ou aux dynamiques de groupe restreintes. Il doit s'étendre aux formes structurelles de la pensée et du pouvoir qui, sous couvert d'universalité ou de nécessité historique, tendent à imposer une Unité abstraite et homogénéisante au détriment de la pluralité vivante des expériences et des autonomies. À cet égard, une relecture critique, depuis notre perspective kah-tanaise, des analyses produites par un certain philosophe idéaliste eurysien du début du XIXe siècle sur ce qu'il nommait la "Révolution de l'Orient" (terme par lequel il désignait, de manière symptomatiquement eurocentrée, des mouvements unificateurs puissants, notamment l'expansion de l'Islam) peut s'avérer d'une pertinence inattendue. Ce penseur voyait dans ces phénomènes un "enthousiasme pour l'abstrait", une aspiration à l'Un absolu qui, tout en possédant une certaine grandeur dialectique dans sa capacité à transcender les particularismes étroits, portait en elle le risque d'une suppression violente de toute différence et de toute médiation concrète.
Nous proposons ici une transposition audacieuse, mais, nous le croyons, fertile, de cette grille d'analyse. Nous soutenons que toute idéologie – qu'elle prenne la forme de l'État-Nation centralisé sur le modèle eurysien, qu'elle s'incarne dans le nationalisme militariste de certaines puissances comme l'Alguanera, ou même, et c'est là que notre critique se fait plus inconfortable, qu'elle émane d'une interprétation déviante et unificatrice du Kah lui-même – qui prétend imposer une Unité abstraite et monolithique (l'État-Nation fantasmé comme entité supérieure et indivisible, le Leader charismatique unique comme incarnation de la volonté populaire, la Section auto-proclamée comme seule avant-garde légitime et dépositaire de la vérité révolutionnaire) au détriment de la pluralité irréductible, de l'autonomie constitutive et de la diversité foisonnante des communes kah-tanaises, est une manifestation dangereuse de ce que nous nommerons le "fanatisme de l'Un". Ce "fanatisme" n'est pas nécessairement celui de la ferveur populaire déchaînée ; il peut être aussi celui, plus froid et plus calculateur, de la raison d'État, de la bureaucratie centralisatrice, ou de l'orthodoxie idéologique qui ne tolère aucune nuance.
Une relecture de notre propre histoire kah-tanaise à travers ce prisme critique s'impose. Les phases sombres des Premier et Second Empires Sukaretto, avec leur culte de la personnalité impériale et leur tentative d'imposer une administration centralisée directement inspirée des modèles eurysiens, furent des expressions évidentes de ce "fanatisme de l'Un". De même, la dictature brutale de la Junte militaire impériale (1985-1992), qui chercha à écraser l'esprit communaliste sous le poids d'une autorité militaire monolithique et à imposer une idéologie réactionnaire prétendument unificatrice, relève de cette même pathologie du pouvoir qui ne supporte ni la diversité ni l'autonomie. Ces expériences douloureuses doivent nous servir de rappel constant des dangers inhérents à toute concentration excessive du pouvoir et à toute tentative de substituer une Unité abstraite à la richesse concrète de notre fédéralisme communal.
Le risque contemporain le plus manifeste au sein de notre Confédération réside, selon nous, dans l'idéologie et les pratiques de la Section Défense. Sa vision d'un "Premier Citoyen" qui serait investi de pouvoirs exceptionnels pour "sauver le Kah", sa volonté affichée d'une centralisation accrue des instances de défense et de sécurité au nom de l'efficacité face aux menaces extérieures, son discours qui tend à présenter la diversité des opinions au sein des communes comme une faiblesse ou une trahison, ne constituent-ils pas une résurgence insidieuse de ce "fanatisme de l'Un" ? Cette tendance, si elle venait à prévaloir, serait incompatible avec les fondements polycentriques, délibératifs et anti-autoritaires de notre projet communaliste. La popularité croissante de Maiko et de ses slogans simplificateurs doit nous alerter sur la séduction que peut exercer, en temps de crise et d'incertitude, l'appel à l'Unité et au Chef providentiel.
Chapitre 8 : Terreur Unificatrice, Psychologie Politique du Sujet Soumis à l'Idole de l'Un, et Perversion du Zèle Révolutionnaire Authentique en Adoration Sectionnelle
Il ne suffit pas de dénoncer les manifestations structurelles du "fanatisme de l'Un" ; il faut aussi chercher à comprendre, sans pour autant la justifier, la psychologie politique qui sous-tend la soumission volontaire à une autorité unique et l'adhésion fervente à une idéologie homogénéisante. Nous proposons ici une esquisse d'analyse, menée par un collectif fictif de "psycho-sociologues communalistes" kah-tanais, qui s'inspirerait de manière critique des travaux produits en Eurysie et en Aleucie sur la psychologie des masses et le charisme, mais en les confrontant systématiquement à nos propres expériences et à nos propres catégories d'analyse. Comment l'aspiration légitime et profondément kah-tanaise à l'unité d'action face à l'adversité, à l'efficacité collective dans la poursuite des objectifs de la Révolution Permanente, peut-elle être pervertie en adoration acritique d'un individu ou d'une faction, en une négation de la complexité du réel et en un abandon de l'esprit critique individuel et collectif ?
Il est essentiel de se démarquer ici des approches eurysiennes qui, trop souvent, tendent à pathologiser d'emblée tout engagement radical ou toute adhésion fervente à une cause, en les réduisant à des mécanismes psychologiques irrationnels (frustration, ressentiment, besoin de soumission, etc.) sans analyser sérieusement leurs racines politiques, sociales et économiques, ni leur contexte spécifique de surgissement. S'inspirant des mises en garde d'un certain philosophe-polémiste eurysien contemporain (mais en ancrant fermement notre analyse dans le matérialisme historique et la tradition critique kah-tanaise), nous affirmons que le "zèle" n'est pas en soi une pathologie. Il devient pathologique lorsqu'il est instrumentalisé, lorsqu'il est détourné de son objet légitime (la lutte pour l'émancipation) pour servir des intérêts particuliers ou pour conforter un pouvoir autoritaire.
Le zèle dévoyé de figures comme Maiko aujourd'hui, ou des propagandistes stipendiés des anciens Empires Sukaretto hier, relève-t-il d'un "savoir" stratégique (une compréhension, même cynique et erronée, des dynamiques de pouvoir et des ressorts de la mobilisation populaire) ou d'une "croyance" aveugle et irrationnelle en la mission providentielle d'un chef, d'une race ou d'une faction ? Il est probable que les deux dimensions soient souvent intriquées. La question cruciale, pour nous, est de comprendre les mécanismes par lesquels la manipulation consciente des affects populaires par une élite cynique peut rencontrer et amplifier des aspirations diffuses à l'unité, à la sécurité ou à la grandeur, particulièrement en période de crise ou de désorientation collective. C'est en analysant ces mécanismes que nous pourrons développer des contre-stratégies fondées sur la raison critique, la transparence et la participation populaire, afin de prémunir la Confédération contre ces formes perverses de zèle qui menacent de la dévorer de l'intérieur.
Partie V : Le Choc des Abstractions Réelles : Le Kah face au "Capitalisme d'Occasion", à la "Religion Séculière" du Marché Mondial et à ses Propres Fétiches Internes
Chapitre 9 : Le Retour Impérieux de la Critique Matérialiste (Kah-tanaisée) et l'Analyse Implacable de la "Religion de la Vie Quotidienne" dans le Capitalisme Mondialisé Contemporain et ses Tentacules Confédérales
Si la critique des formes politiques du "fanatisme de l'Un" est essentielle, elle resterait incomplète, voire superficielle, si elle ne s'accompagnait pas d'une analyse rigoureuse des abstractions réelles qui structurent notre monde contemporain, et qui exercent une influence insidieuse, y compris au sein de notre Confédération théoriquement affranchie de ses logiques. Nous affirmons ici la pertinence renouvelée, et même l'urgence, d'une critique matérialiste historique, d'inspiration certes marxienne mais profondément "kah-tanaisée" (c'est-à-dire adaptée aux spécificités de notre histoire, de notre culture politique communaliste, et débarrassée de ses scories étatistes ou déterministes), pour comprendre le "réenchantement" paradoxal du monde. Non pas un réenchantement par des forces spirituelles transcendantes, mais un réenchantement par les logiques abstraites et fétichisées du capitalisme globalisé, qui se présentent avec la force d'une quasi-religion séculière, dotée de ses propres dogmes, de ses propres rituels et de ses propres prêtres.
Le concept de fétichisme de la marchandise, forgé par le grand critique matérialiste eurysien du XIXe siècle, demeure un outil d'une puissance analytique redoutable pour déchiffrer les mystifications du capitalisme. L'idée que les produits du travail humain, une fois entrés dans le circuit de l'échange marchand, acquièrent une vie propre, une "âme" mystérieuse qui semble dicter leurs mouvements et leurs valeurs indépendamment de la volonté de leurs producteurs, trouve une résonance particulière dans notre monde contemporain saturé de marques, de logos et de flux financiers dématérialisés. Mais qu'en est-il au sein du Grand Kah ? Notre stratégie ambivalente dite du "Capitalisme d'Occasion" – cette tentative pragmatique, incarnée par nos Keiretsus et par le Fonds Tomorrow, d'utiliser les mécanismes du marché mondial pour financer notre développement communaliste et soutenir les luttes anti-impérialistes – est-elle une ruse intelligente et maîtrisée du Kah, une forme de "jiu-jitsu économique" utilisant la force de l'adversaire contre lui-même ? Ou représente-t-elle, au contraire, une contamination insidieuse, une porte d'entrée pour la "religion du Capital" et ses impératifs implacables d'accumulation, de compétition et de marchandisation de tous les aspects de la vie ? Le débat est vif au sein des communes et de la Convention Générale, et il est crucial.
Le même penseur eurysien qualifiait le capitaliste de son temps d'agent mû par un "zèle respectable" pour l'accumulation, un zèle quasi ascétique qui le poussait à réinvestir sans cesse ses profits plutôt qu'à les dissiper dans une jouissance stérile. Ce "zèle capitaliste", bien que profane et matérialiste en apparence, possédait selon lui une structure quasi religieuse, une foi aveugle dans la croissance infinie. Comment ce "zèle respectable" (qui, bien sûr, n'a rien de respectable pour les exploités) se compare-t-il au zèle révolutionnaire qui anime notre projet kah-tanais ? S'agit-il de deux faces opposées d'une même logique d'engagement total envers une abstraction – le Capital d'un côté, le Kah (ou plutôt, une certaine idée abstraite et potentiellement fétichisée du Kah) de l'autre ? Ou bien la nature de l'engagement, les finalités poursuivies, les rapports sociaux qu'ils engendrent, sont-ils qualitativement et irréductiblement différents ? La question est complexe, car le risque existe toujours que le zèle pour la construction du communalisme, s'il devient purement formel et déconnecté des aspirations populaires, ne se transforme en une nouvelle forme d'aliénation, en un fétiche bureaucratique ou idéologique.
Chapitre 10 : Le Zèle Froid et Calculateur du Capital face au Zèle Ardent et Délibératif du Kah : Deux Formes Antagonistes d'Engagement Abstrait ou Risques Insidieux de Convergence Inavouée sous la Pression de la Mondialisation ?
Le "culte de l'homme abstrait", cette réduction de l'individu à une unité interchangeable, que le critique matérialiste eurysien voyait à l'œuvre dans certaines traditions religieuses monothéistes de son continent et qui trouvait son pendant séculier dans l'égalité formelle du citoyen devant la loi bourgeoise, résonne de manière troublante avec certains risques inhérents à toute entreprise politique d'envergure. Au sein du Grand Kah, existe-t-il un danger que l'abstraction nécessaire du "citoyen kah-tanais" – cet idéal d'un individu éclairé, participatif et solidaire – ne vire, dans certaines visions technocratiques ou bureaucratiques dévoyées, à une négation de la singularité des individus, de la diversité des cultures communales, des aspirations plurielles qui font la richesse de notre Confédération ? Le zèle pour l'uniformité administrative ou pour la rationalisation à outrance, s'il n'est pas constamment contrebalancé par le respect des autonomies et la vitalité du débat local, pourrait conduire à une forme d'aliénation nouvelle, où le citoyen ne serait plus qu'un rouage dans une machine confédérale prétendument parfaite.
La Confédération Kah-tanaise se trouve aujourd'hui confrontée, de manière inéluctable, à ce que nous avons nommé la "religion du marché" et à son universalisme abstrait et conquérant. Les institutions financières internationales (le "Consortium Monétaire Global", la "Banque Paltoterrane de Reconstruction", l'"Organisation Mondiale des Échanges Privilégiés" – noms fictifs pour désigner les équivalents de nos FMI, Banque Mondiale et OMC), avec leurs dogmes néolibéraux, leurs "ajustements structurels" et leur culte de la "concurrence libre et non faussée", exercent une pression constante sur notre modèle communaliste. Comment notre praxis, fondée sur la solidarité concrète, la délibération collective et la satisfaction des besoins humains, peut-elle éviter de devenir une simple "foi" désarmée, une utopie marginale, face à la puissance structurante et aux séductions matérielles de ce capitalisme mondialisé qui se présente comme l'horizon indépassable de la modernité ? Le "Capitalisme d'Occasion" est-il une réponse suffisante, ou ne fait-il qu'intégrer le Kah dans une logique qui, à terme, pourrait le subvertir de l'intérieur ? Ces questions sont au cœur des débats stratégiques qui animent la Convention Générale et les assemblées communales. Y répondre avec lucidité et courage est une condition de survie pour l'esprit authentique du Kah, qui ne saurait se réduire à une simple technique de gestion alternative de la rareté dans un monde dominé par d'autres.
Partie VI : La "Citadelle Assiégée" et l'Horizon du Messie Révolutionnaire Universel : De la "Religion Politique" Nationaliste à une Praxis Émancipatrice Internationaliste et Décoloniale
Chapitre 11 : Les Nouvelles Guerres Froides Idéologiques, la Hantise Tenace de l'Ennemi Intérieur et la Tentation Insidieuse de la "Religion Politique" au sein même des Structures de la Confédération Kah-tanaise
La situation géopolitique de la Confédération Kah-tanaise, marquée par une lutte prolongée et multiforme contre l'impérialisme agressif de la Confédération Alguanerane et contre les manœuvres déstabilisatrices d'autres puissances acquises au capitalisme mondial, a profondément façonné notre conscience collective. Le sentiment d'être une "Citadelle Assiégée", un bastion du communalisme libertaire dans un océan d'hostilité, est une réalité tangible pour de nombreux citoyens et citoyennes, et un puissant moteur de mobilisation et de zèle défensif. Cependant, ce contexte de menace permanente n'est pas sans risques. Ne risque-t-il pas, à terme, de transformer insidieusement le Kah lui-même en une sorte d'"ecclesia militans" assiégée, une communauté de croyants révolutionnaires où la fin (la survie et la défense de la Révolution Kah-tanaise) en viendrait à justifier des moyens de plus en plus autoritaires, dogmatiques et contraires à nos principes fondateurs de liberté et de délibération ?
Nous proposons ici une relecture critique, depuis notre ancrage kah-tanais, du concept eurysien de "religion politique", un concept souvent utilisé de manière polémique pour disqualifier les mouvements totalitaires du XXe siècle eurysien, mais qui peut, si on le manie avec précaution, éclairer certains de nos propres dilemmes. Le danger, pour le Grand Kah, n'est pas tant, comme le craignait une certaine philosophe politique eurysienne du siècle dernier, d'instrumentaliser des principes spirituels ou religieux (largement absents de notre sphère publique laïque) à des fins de mobilisation politique guerrière. Le danger est plus subtil : il réside dans la possibilité d'une sacralisation de la politique elle-même, d'une transformation des principes fondamentaux du Kah (l'autogestion, l'égalité, la Révolution Permanente) en dogmes intouchables, en une sorte de "foi civique" transcendante dont la défense justifierait la suppression des libertés, la surveillance généralisée des citoyens, et la diabolisation de toute dissidence interne comme une forme de trahison au service de l'ennemi extérieur. Ce glissement vers une "religion politique" kah-tanaise, même laïque en apparence, serait une perversion mortelle de notre projet.
L'héritage ambigu des théoriciens eurysiens de la "gnose sécularisée" ou de "l'anthropologie du sacré" – ces penseurs souvent conservateurs qui voyaient dans toute tentative de transformer radicalement le monde une forme d'hubris, une résurgence de schémas religieux dévoyés – doit être examiné avec une extrême prudence. Le Kah, dans sa radicalité et son ambition universaliste, est-il fondamentalement une "gnose" révolutionnaire moderne, une forme de "sacré" politique immanent qui chercherait à réaliser le paradis sur terre ? Ou peut-il au contraire, et c'est la thèse que nous défendons, offrir une alternative radicale à ces schémas de pensée enracinés dans l'histoire intellectuelle et religieuse eurysienne, en proposant une voie d'émancipation fondée sur la raison critique, la délibération collective et la praxis matérialiste ? Réfuter les accusations de "religion politique" ou de "messianisme séculier" portées contre le Kah par nos adversaires alguanerans ou par certains cercles libéraux du Liberalintern exige de notre part une clarification constante de nos propres fondements idéologiques et une vigilance accrue contre toute dérive dogmatique ou autoritaire en notre sein.
Chapitre 12 : Le "Messianique sans Attente Passive" et la Pratique Concrète de la Révolution Permanente comme Construction Active et Collective de l'Avenir Kah-tanais et Mondial
Le "spectre" toujours vivant de la Révolution Permanente, inscrit au cœur de l'idéologie kah-tanaise, est à la fois une source d'inspiration et un défi constant. Comment maintenir activement l'ouverture à l'événement émancipateur – la rupture créatrice, la nouveauté radicale qui vient bousculer les certitudes et les routines – sans pour autant succomber ni à une eschatologie passive (l'attente messianique d'un "Grand Soir" providentiel qui résoudrait toutes les contradictions) ni à une téléologie déterministe (la croyance naïve en un sens de l'histoire garanti qui mènerait inéluctablement au triomphe du communalisme) ?
La critique de toute "ontologie" politique figée, que nous empruntons ici librement à un certain courant de la philosophie eurysienne de la "déconstruction" mais que nous entendons ancrer fermement dans notre tradition matérialiste et communaliste, est essentielle. Le Kah n'est pas, et ne doit jamais devenir, un système achevé, un modèle parfait, un ensemble de vérités établies une fois pour toutes. Il est, par nature, une "promesse" révolutionnaire en constante redéfinition, une praxis collective qui se construit et se réinvente chaque jour dans la lutte, l'expérimentation, la confrontation avec les contradictions du réel. Cet "esprit du Kah" n'est pas une essence métaphysique, mais une dynamique ouverte, un appel permanent à la vigilance critique et à l'action transformatrice.
La figure du "Pionnier de la Frontière Révolutionnaire" – concept que nous forgeons ici pour désigner non pas un individu providentiel, mais un type d'acteurs collectifs et de pratiques politiques au sein du Grand Kah – pourrait incarner cette articulation dynamique entre l'héritage et la nouveauté. Qui sont ces "pionniers" aujourd'hui ? Sont-ce les militantes des communes les plus reculées qui inventent de nouvelles formes d'autogestion écologique et sociale ? Sont-ce les artistes et les intellectuels qui, par leur travail critique, bousculent les certitudes et ouvrent des brèches dans l'orthodoxie ? Sont-ce les membres du Syndicat des Brigades qui, parfois au péril de leur vie, soutiennent les luttes d'émancipation sur d'autres continents ? Il n'y a pas de réponse unique. Ce qui caractérise le "Pionnier de la Frontière Révolutionnaire", c'est sa capacité à incarner un universalisme kah-tanais concret, un universalisme qui ne nie pas les différences (qu'elles soient communales, culturelles, individuelles, ou liées aux singularités des luttes à l'échelle mondiale) mais qui cherche au contraire à les articuler, à les valoriser au sein d'un projet commun d'émancipation, tout en maintenant une exigence intransigeante de vérité égalitaire et de justice sociale. Le rôle crucial des femmes, des minorités culturelles, des communes périphériques souvent marginalisées dans les discours centraux, est ici fondamental pour éviter que l'universalisme ne devienne l'alibi d'une nouvelle forme d'homogénéisation.
La tension dialectique, et sans doute incontournable pour toute politique révolutionnaire digne de ce nom, entre la "foi" en la possibilité de l'événement émancipateur (cette conviction profonde, ce zèle réfléchi, en la capacité des peuples à transformer radicalement leur existence et à briser les chaînes de l'oppression) et le "savoir" stratégique (l'analyse rigoureuse des conditions matérielles, des rapports de force, des médiations nécessaires pour traduire l'aspiration en réalité) doit être assumée et gérée collectivement. Le "messianique" kah-tanais, s'il doit exister, ne peut être celui de l'attente passive d'une intervention extérieure ou d'une révélation soudaine ; il doit être celui de la construction patiente, collective et souvent conflictuelle, des conditions de possibilité de l'émancipation, ici et maintenant, au Grand Kah et au-delà.
Conclusion : Pour un Usage Dialectique et Vigilant du Zèle dans la Pratique Quotidienne de la Confédération Kah-tanaise et de la Révolution Permanente
1. Récapitulation Critique : Le Zèle Inconditionnel, cette Flamme Ambivalente mais Indispensable au Cœur de la Politique Kah-tanaise
Au terme de ce long parcours à travers l'histoire des idées et les dynamiques concrètes de notre Confédération, une constante se dégage avec la force de l'évidence : l'engagement passionné, la conviction profonde et l'adhésion à des principes abstraits mais structurants sont des composantes non seulement inévitables, mais absolument nécessaires à toute politique qui vise une transformation sociale radicale et l'instauration durable d'une société authentiquement communaliste et libertaire comme la nôtre. Le "zèle", dans son acception la plus noble – celle du dévouement à une cause juste, de la persévérance face à l'adversité, de la volonté de traduire l'idéal en praxis – est le souffle vital de la Révolution Permanente. Sans lui, nos institutions, aussi ingénieuses soient-elles, ne seraient que des coquilles vides, et nos principes, des lettres mortes.
Cependant, et c'est là toute la complexité de notre tâche, ce même zèle porte en lui des dangers intrinsèques, des potentialités de dérive que l'histoire kah-tanaise, dans ses moments les plus sombres comme dans ses défis contemporains, n'a que trop illustrées. Le dogmatisme sectaire qui refuse le débat et excommunie la dissidence ; l'intolérance répressive qui voit des ennemis et des traîtres partout ; la violence aveugle qui, au nom de la pureté révolutionnaire, finit par se retourner contre le peuple lui-même ; le culte du chef charismatique ou de la faction auto-proclamée avant-garde ; la déconnexion bureaucratique par rapport aux réalités vécues et aux aspirations concrètes des citoyennes et citoyens dans leurs communes : autant de manifestations pathologiques d'un zèle qui, ayant perdu sa boussole critique et son ancrage dans la volonté populaire, devient une force de destruction plutôt que de construction.
2. "Modes d'Emploi" Pratiques et Institutionnels pour un Zèle Communaliste Éclairé, Efficace et Toujours Soumis au Contrôle Populaire :
Face à cette ambivalence constitutive, la question n'est donc pas d'éradiquer le zèle – ce qui serait non seulement impossible mais suicidaire pour un projet révolutionnaire comme le nôtre – mais bien de le cultiver, de le canaliser, de l'éclairer en permanence par la raison critique collective, et de le soumettre au contrôle vigilant et constant des instances démocratiques de la Confédération. Pour ce faire, le Collectif "Vigilance & Praxis" soumet à la délibération des citoyennes et citoyens les "modes d'emploi" suivants, non comme des recettes infaillibles, mais comme des pistes de réflexion pour une praxis kah-tanaise plus lucide et plus efficace :
La Primauté Absolue et Non Négociable du Débat Communal Ouvert et de la Démocratie Directe à Tous les Échelons : C'est le garde-fou institutionnel fondamental contre toute dérive du zèle. Aucune conviction, aucune urgence, aucune "ligne juste" ne saurait justifier la suspension ou le contournement des processus délibératifs au sein des assemblées de quartier, des communes locales et supérieures, et de la Convention Générale. Le zèle doit se nourrir du débat contradictoire, non le fuir.
Le Rôle Indispensable, mais Strictement Encadré et Contrôlé Démocratiquement, de l'Égide et des Autres Institutions de Vigilance et de Régulation : Si des instances comme l'Égide sont nécessaires pour prévenir la corruption, les abus de pouvoir et la formation de factions dogmatiques ou d'intérêts privés contraires au bien commun, leur action doit elle-même être transparente, soumise à des règles claires et au contrôle ultime des représentants du peuple. Un zèle institutionnel non contrôlé peut devenir une forme de terreur bureaucratique.
L'Impératif de la "Critique de la Critique" au Sein du Kah : Nous devons institutionnaliser une culture de la vigilance constante envers nos propres tendances collectives (et individuelles) au "zèle inconditionnel", à l'orthodoxie sclérosante, à l'unanimisme de façade ou à l'exclusion des voix dissidentes mais potentiellement constructives. La critique et l'autocritique ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves de la maturité et de la vitalité de notre projet révolutionnaire.
La Nécessité d'Articuler Dialectiquement l'Urgence Révolutionnaire avec la Patience Stratégique et l'Analyse Matérialiste Concrète : Face aux crises internes qui secouent parfois la Confédération, face aux menaces persistantes de l'impérialisme alguaneran, face aux injustices qui subsistent encore en notre sein ou à l'échelle mondiale, l'urgence de l'action est souvent palpable. Mais ce zèle pour l'action immédiate doit toujours être tempéré par la patience stratégique, par une analyse rigoureuse et matérialiste des conditions concrètes, des rapports de force, des médiations nécessaires pour ne pas transformer l'aspiration légitime en aventurisme stérile ou contre-productif.
Le Zèle des Individus et des Groupes Doit Toujours Être Subordonné et Mis au Service de la Praxis Collective et de la Volonté Populaire Dûment Délibérée : Aucune prétendue "illumination" individuelle, aucune avant-garde auto-proclamée, aucune "ligne" sectionnelle ou de club politique, aussi juste puisse-t-elle paraître à ses promoteurs, ne saurait se substituer à la volonté collective qui émerge du processus complexe et parfois conflictuel de la délibération démocratique au sein des communes. Le zèle n'est légitime et constructif que s'il est l'expression d'une conscience collective en mouvement.
3. Perspective et Interrogation Ouverte : Le Zèle Disparaîtra-t-il un Jour de la Scène de l'Histoire Kah-tanaise, ou Fait-il Partie Intégrante de l'Horizon Infini et Toujours Fuyant de la Révolution Permanente ?
Il serait naïf, et sans doute contraire à l'esprit même du Kah, de rêver d'un avenir où toute passion, toute conviction forte, tout zèle pour la justice et l'émancipation auraient disparu, laissant place à une sorte d'administration placide et consensuelle des affaires courantes. Notre hypothèse dialectique est plutôt la suivante : tant qu'il y aura des contradictions à surmonter (et il y en aura toujours, car la société est un processus vivant et non un état figé), tant qu'il y aura des injustices à combattre (et l'horizon de l'égalité réelle est infini), tant qu'il y aura des oppressions à démanteler, que ce soit au sein de notre Confédération ou à l'échelle paltoterrane et mondiale (car la "Révolution Permanente" est, par essence, internationaliste), des formes de zèle, d'engagement passionné et de conviction radicale persisteront et seront même indispensables comme levier de transformation.
L'objectif ultime du projet kah-tanais n'est donc pas d'éradiquer toute passion ou toute conviction (ce qui serait le prélude à une utopie bureaucratique déshumanisante, à une société sans âme et sans histoire), mais bien de la canaliser constructivement, de l'éclairer en permanence par la flamme de la raison critique collective, de la soumettre à l'épreuve de la délibération démocratique, et de la mettre résolument au service de la construction patiente, collective, toujours recommencée et jamais achevée, d'une société réellement et toujours plus profondément fondée sur les principes vivants du Kah. L'urgence du moment, qui peut parfois exiger un zèle exceptionnel, doit toujours céder la place, non pas à une illusoire "fin de l'histoire" ou à une résignation satisfaite, mais à la temporalité complexe, exigeante et passionnante, de la réalisation collective et de l'émancipation humaine. Le zèle, ainsi compris et pratiqué, ne sera plus une menace pour le Kah, mais son allié le plus précieux dans la poursuite de cet horizon infini.

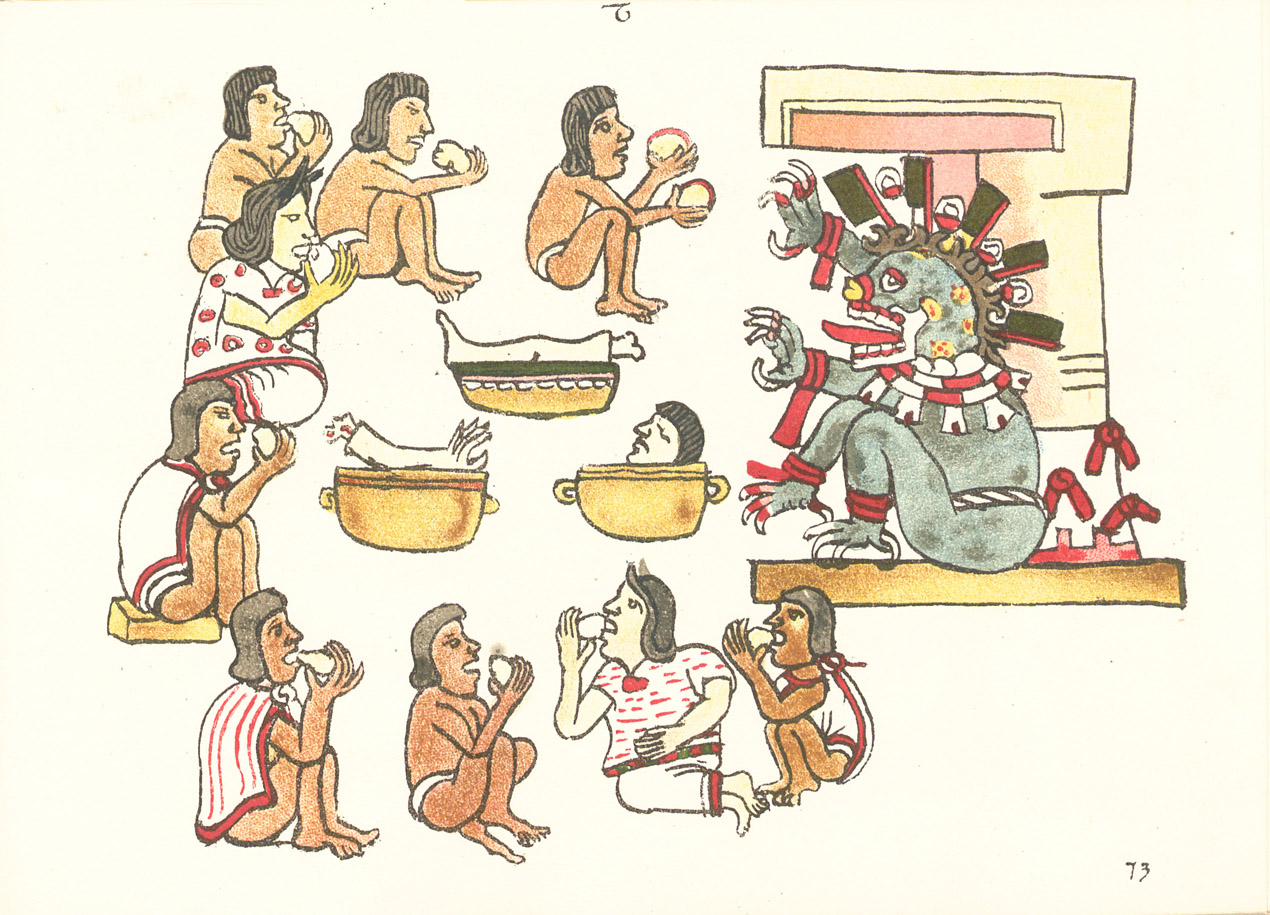

/the-celebration-of-unity--destroying-the-emblems-of-monarchy--place-de-la-concorde--10th-august-1793--detail-from-a-painting-by-pierre-antoine-demachy--1723-1807---french-revolution--france--18th-century--153415067-5c5b2b4846e0fb0001105cfd.jpg)






