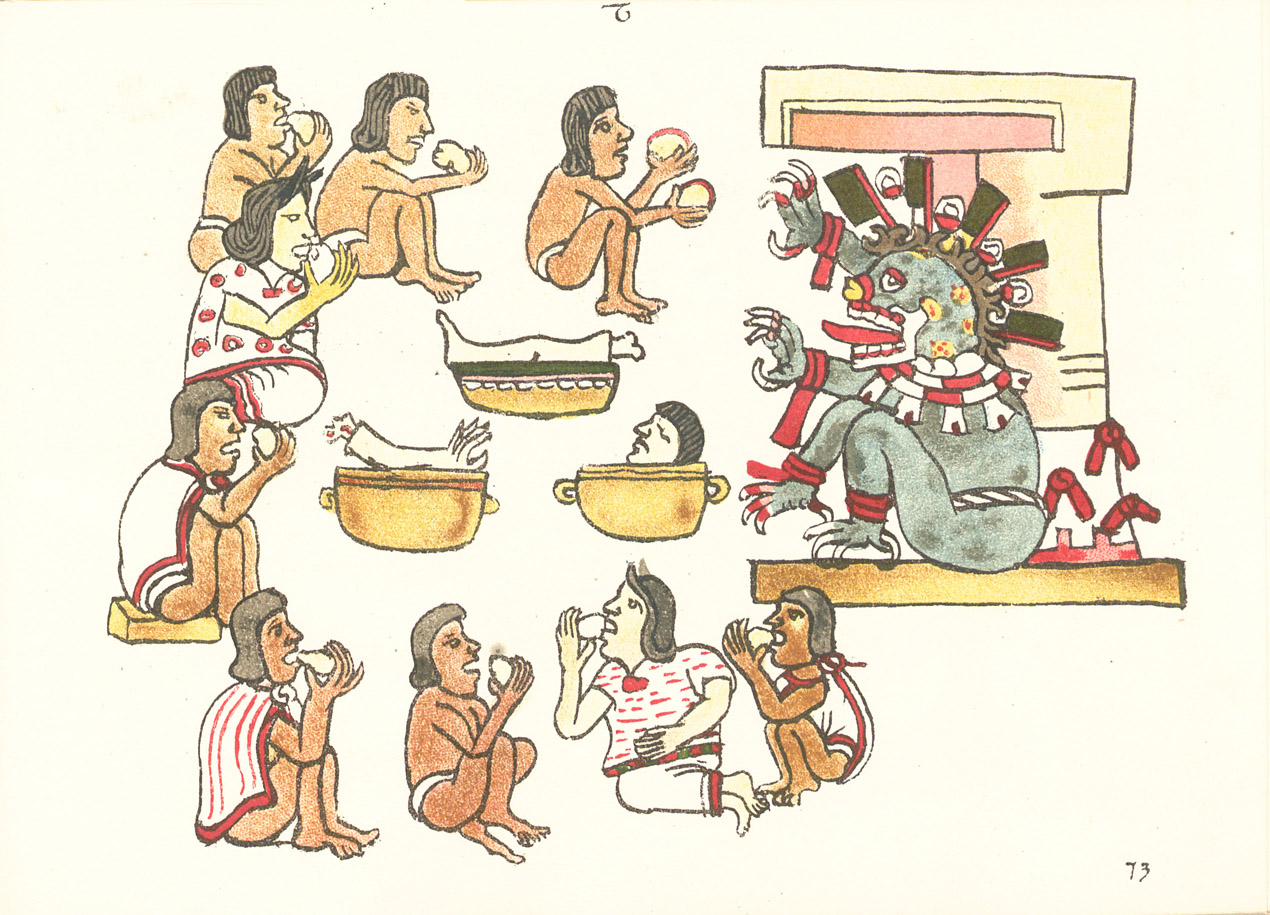Concernant les possibilités d’extension de l’Union et la stratégie à adopter en vue de répondre optimalement aux objectifs fixés par la Convention Générale.
Partie 1.
La principale erreur du précédent Comité de Volonté Publique ne se trouvait pas, selon nous, et contrairement à ce qu’expriment certains des critiques les plus virulents du côté des Modérés, dans une mauvaise interprétation de ladite Volonté Publique, mais dans une erreur d’analyse quant aux méthodes pouvant traduire cette volonté en action concrète et efficiente. La stratégie dite de la Tension Révolutionnaire, transformée lors des trois dernières années du Comité en doctrine de la Citadelle Assiégée, pose de nombreux défis et à jetée les bases de ce que nous considérons désormais comme les principaux défis auxquels doit faire face le Grand Kah.
Les erreurs du comité Estimable :
Le Comité estimable doit être compris et interprété pour l’ensemble de son œuvre durant les presque sept années de son existence. Si certains de ses membres étaient déjà des représentants influents au sein de la Convention entre 1990 et 1999, voir pour certains membres de Comités précédents, la politique du Comité Estimable lors de sa prise de fonction initiale restait une politique de rupture, et c’est sur la base de cette politique que la Convention a acceptée sa formation. La continuité relative dans la politique kah-tanaise des années 1990 1999 à 1999 2007 et l’influence politique antécédentes de certains membres du comité ne signifie en aucun cas que la période de reconstruction était similaire à la période estimable en termes d’approches et d’objectifs.
Le Comité estimable a été élu en vue de remplir des objectifs importants demandant un set d’expertises et une vision du monde entièrement différente de celles des comités précédents : en termes brefs, la reconstruction de l’Union après la révolution de 1990 ayant été jugée suffisante, les mouvements modérés et conservateurs qui avaient prévalu à la fin de la libération ont laissés la place à une nouvelle génération d’individus défendant une estimation définitivement moderne de ce que devait être le Grand Kah et des méthodes à adopter pour y arriver. Cette alternance bien connue entre les comités dits Modérés et Radicaux - qu’il ne convint pas d’analyser en détail ici - se traduit tout de même par la relative méfiance séparant les deux groupes, imposants à la Convention d’importants débats et consensus avant de pouvoir nommer un Comité. Estimable, en ça, n’a pu exister que grâce à l’apport décisif de certains de ses membres.
En effet, la composition d’Estimable était indéniablement surprenante, surtout pour cette période où les Kah-tanais, se remettant à peine des cicatrices laissées par la junte militaire, n’étaient pas encore très sûrs de la position à adopter vis-à-vis du monde extérieur. La plupart des observateurs nationaux et étrangers ne s’attendaient ainsi pas nécessairement à ce que le gouvernement nommé pour organiser la réouverture du Grand Kah le fasse sur les bases d’une radicalité que nous savons désormais excessive.
Cela nous le devons en fait à l’accord trouvé par les principales factions représentées à la Convention. Se trouvait déjà l’arrière-garde des modérés, au sein desquels les membres les plus influents - le citoyen Maxwell Bob et le citoyen De Rivera - étaient en fait bien conscients des enjeux de la réouverture politique et jouissaient du reste d’une popularité très importante au sein de l’ensemble des communes. Si seuls, ils ne pouvaient obtenir le capital politique suffisant pour réellement imposer aux modérés la réouverture rapide de l’Union, ils étaient au moins capable de se présenter comme tête de proue du programme politique du Comité, et ainsi espérer en garder le contrôle tout en y intégrant des jeunes «chiens fous» des radicaux, qui eux seraient capables de défendre et d’établir les politiques jugées nécessaires. Les dits chiens fous ne sont pas non-plus sortis de nul-part et c’est un cartel politique étonnant qui se retrouva à négocier avec le duumvirat modéré. Plus précisément, le très jeune et nationaliste citoyen Aquilon, représentant les mouvements les plus radicaux de l’Union et porteur d’un projet ouvertement militariste, et la populaire citoyenne Actée, qui pour sa part connaissait bien le monde extérieur et jouissant d’un capital politique intrinsèquement lié aux nombreux essais qu’elle avait rédigée sur le rapport hypothétique que pourraient entretenir les communes avec les acteurs étatiques et non-étatiques qui semblaient se profiler à l’orée du nouveau millénaire.
Les deux, bien que représentant, comme un miroir inversé, un duumvirat radical, n’étaient cependant pas tout à fait comparables aux deux modérés. En effet, Maxwell Bob était un très ancien membre de la Convention, actif avant la junte, dirigeant du Comité de Volonté Publique Clandestin durant la guerre, et présent au sein de divers instances confédérales (y compris deux comités de volonté publique) des années 70 à 80. De Rivera, pour sa part, avait une carrière de militaire dans l’armée régulière confédérale (ce qui peut sembler étonnant au vu des positions opposées à la remilitarisation de l’Union qu’on lui connaît), et a été un commandant de milice très important durant la guerre civile, puis présent dans tous les commités de 1990 à 1999. Deux figures centrales de la politique et de la reconstruction, dans la discrétion relative tendait à renforcer leur popularité.
Actée et Aquilon étaient, pour leur part, des figures ne pouvant pas, du simple fait de leur jeunesse, prétendre à une telle notoriété. Ils représentaient en fait le renouveau de la politique kah-tanaise : une incarnation de cette nouvelle génération post 90, au fait des enjeux et des dangers qui menaçaient l’Union car ayant grandi dans une période extrêmement éloignée du grand apaisement qui avait caractérisé les deux tiers du siècle et, par conséquent, tous les représentants élus en émanant. Rétrospectivement on peut qualifier leurs positions de populistes et d’instinctives, ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils agissent sans méthode ou efficacité.
Le principal point commun entre les deux citoyens et leur importante réputation de théoricien, dont les textes ont pleinement participé à caractériser le débat public depuis la révolution. De plus, à cette époque où on ne les connaissait que de loin, les deux citoyens semblaient assez similaires : des individus taiseux, sans prétentions de tribun, écrivant du texte et dont la prétention à rejoindre le Comité semblait découler d’une pure volonté d’appliquer leurs théories. Celles-là leur apportaient de plus une certaine image d’expertise conforme aux attentes technocratiques que l’on a envers les élus confédéraux. Les détails, cependant, laissaient déjà percevoir des différences importantes de profil.
Le citoyen Aquilon, pour commencer, vient d’un club politique. Membre très proche des Splendides, il détone au sein de ceux-là par son opposition ferme aux mesures isolationnistes qui le pousse rapidement dans les bras des mouvements plus accélérationistes. Féru d’Histoire et marqué dans son historie familiale par la dictature militaire, les obsessions d’Aquilon ne sont pas aussi esthétiques que celles des autres élus de l’ultra-radicalisme. Son projet de société est concret, pragmatique, et envisagé sous un angle extrêmement factuel : il parle de la nécessité de créer une démocratie brigadière (comme un écho avant-coureur des actuels nouveaux mouvements nationalistes). Son obsession est la sécurité de l’Union. La Brigade - groupement militaire autonome issue d’une commune - est un terme encore populaire et qui lui permet en fait d’ouvrir le débat public à la question de la remilitarisation, qu’il envisage cependant sous un point de vue central. S’il envisage la révolution comme confédérale et démocratique il considère ces aspects comme un idéal final intenable en cas de crise, or pour lui le monde est constamment, systématiquement en crise tant qu’il suit l’ordre capitaliste. Par conséquent, il convient de confédéraliser - centraliser, en fait, - certains domaines. L’Armée, la Diplomatie, la Gestion de l’économie. Sur le plan géopolitique il envisage aussi de revenir à la doctrine de l’Armée de la Révolution, consistant à développer d’importants moyens militaires et humains pouvant être mis à disposition des révolutions étrangères, pour leur permettre de se développer plus sereinement : le principal obstacle à la révolution mondiale étant, chez Aquilon, les nécessités liées à la situation de crise, imposant aux jeunes révolutions de se dévoyer et de muter en quelque-chose d’autre, de réactionnaire. Ainsi, le Grand Kah, qui est une révolution accomplie et solide, peut se permettre de faire les efforts nécessaires pour le compte des autres, leur épargnant ainsi le risque d’une contre-révolution intérieure.
C’est un point qui se rapproche beaucoup de la philosophie diplomatique travaillée par la citoyenne Actée et il est tout à fait possible qu’il en soit directement inspiré. On sait en tout cas que les deux se sont rencontrés à plusieurs reprises en qualité d’auteurs, lors de conférences, classes de maître et autres évènements ayant justifié et donnés lieu à de nombreux échanges.
Actée était beaucoup plus connue du grand public, mais probablement assez mal comprise. L’étiquette de radicale lui a été attribuée ultérieurement à son élection, après l’étude des politiques qu’elle mis en place avec la Convention Générale et au sin du Commissariat aux affaires extérieures, largement remodelé selon ses perspectives. Universitaire profondément cosmopolite, Actée n’a pas vraiment connue la Révolution et, pour une moitié de sa vie, observa le Grand Kah d’un point de vue extérieur : celui d’une expatriée. Née dans la commune d’Heon-Kuang, la Junte ne la priva pas tant de proches que de la perspective d’aller étudier dans les communes centrales de l’Union. Elle termina un brillant cursus universitaire en Eurysie, et passa le reste de sa vie à écrire, théoriser, donner des classes dans plusieurs des académies les plus prestigieuses des cinq continents. Hyper-polyglotte, avec des contacts et des amis au sein de nombreuses administrations, pour beaucoup, sa nomination au sein du Comité Estimable visait surtout à capitaliser sur cette espèce de réseau diplomatique qu’elle entretenait déjà à titre personnel. Dans les faits, cet aspect participait simplement à un tout plus grand. En tant que Kah-tanaise «exilée», Actée n’a pas pris part à la révolution, et fut considérée par beaucoup comme une femme très modérée. Ses textes, moins destinés à un public kah-tanais qu’international, déployaient des trésors d’ingéniosité stylistique pour adapter des théories liebrtaires à des contextes culturels capitalistes, la faisant passer entre autre-chose pour une espèce de sociale-démocrate. Le fait de parcourir le monde à une époque où l’Union en étant coupée, puis ne désirait pas s’y rouvrir, lui permit de développer des perspectives passant pour innovantes au sein de l’Union, et une conscience extrêmement aiguë de l’importance de la diplomatie et du dialogue interculturel. Si sa position sur la révolution est mal connue, l’analyse rétrospective de sa politique diplomatique est claire : le meilleur moyen de protéger l’Union des influences extérieures n’est pas de les fuir, mais de les accepter dans un contexte contrôlé. Du reste, une bonne connaissance des démocraties représentative la rendait moins dogmatique sur la question de démocratie économique.
Elle et Aquilon ne formèrent un duumvirat politique que par erreur. Chacun avait ses poulains et ses éléments programmatiques à intégrer à la politique du futur comité. Chacun avait aussi assez d’influence pour défendre certaines de ces inclusions uniquement. Leur alliance se fit sous le signe d’un premier consensus avec pour objectif assumé de mettre en commun leur capital politique en vue d’imposer de plus importantes concessions aux modérés. Leurs accords concernaient notamment la question de la réouverture politique et de ce qu’ils nommèrent bien vite le Grand Projet, dont la traduction concrète fut la fondation du Liberalitnern, semblait rassembler leurs ambitions respectives au sein d’une organisation capable de satisfaire les membres plus modérés du Commité.
Il est difficile d’établir si le citoyen De Rivera - Maxwell Bob ayant en fait eut un rôle principalement représentatif et une influence, somme toute, négligeable - pensait pouvoir maîtriser la radicalité des factions les plus avant-gardistes de la Convention, où s’il comptait justement sur cette radicalité - mal perçue par les mouvements modérés qui lui vouaient une confiance totale - pour diriger l’Union vers de nouvelles directions. Quoi qu’il en soit et quels qu’aient été ses plans, il y eut une véritable révolution institutionnelle, se traduisant par l’acquisition de plus en plus importante d’influence des radicaux du comité durant les neuf années de son existence. Cette révolution, si elle apporta de nombreux résultats conformes aux attentes de l’Union, s’acheva cependant comme on le sait, par la dissolution volontaire du Comité après l’humiliation de l’armée de l’air kah-tanaise.
La remilitarisation de l’Union, un facteur clef :
Dans l’imaginaire populaire Kah-tanais, l’Union est au choix l’Armée des hommes libres, ou la Citadelle Assiégée. Un vocabulaire militaire sans équivoque. Dans l’imaginaire étranger; les Kah-tanais sont, selon les régions du monde, de sanguinaires coupeurs de tête, l’arsenal de la décolonialisation ou l’allié fidèle des pays souhaitant préserver leur indépendance. Dans tout les cas, le rôle géopolitique et symbolique de l’Union est généralement compris comme militaire ou, à minima, liée aux instances de crise. Ce qui peut sembler étonnant considérant l’immense méfiante que es citoyens de l’Union ont développés envers l’idée de force armée après la Junte de 1990, caractérisée par une idéologie militariste et nationaliste violente. L’aspect le plus étonnant est que les vieux officiers de l’armée confédérale, ayant pour beaucoup rejoints la clandestinité pour combattre la Junte, étaient les premiers avocats, dans la sphère publique, d’une non-remilitarisation de l’Union. Pendant longtemps ce fut de façon notable la principale différence entre les revendications des communes Paltoterrannes et des communes exclaves au niveau confédéral : les communes exclaves, elles, souhaitaient la réinstauration d’une force militaire commune.
C’est que le rôle de l’armée est suspect pour de nombreuses raisons, dans une compréhension communaliste des choses. Répondant à une forme de centralisation généralement jugée nécessaire à l’établissement d’une stratégie cohérente, en cause dans la plupart des régimes violents, coup d’État réactionnaires, tendances nationalistes, le rejet de l’Armée s’établissait sur de nombreux arguments, pour beaucoup moins liés à une position strictement rationnelle qu’au récent traumatisme d’un peuple s’étant déchiré et ayant vu et subit des hommes en uniforme, au service d’un gouvernement central, tirer à vue dans la foule.
Cependant l’Union n’était pas sans défense et comme bien souvent au Grand Kah, le rejet par la majorité d’une institution ne la rendait pas moins, dans la compréhension commune des choses, nécessaires. De telle manière que l’Union se retrouva d’une part à rejeter l’idée de remilitarisation tout en développement, par l’intermédiaire de ses nombreux acteurs des réponses aux formes divers et détournées. Dans les faits, l’Union ne fut jamais désarmée, quoi qu’en disait la Convention, les communes ou les particuliers. Elle est, plus encore que toute autre société moderne, une nation en arme, ce qui s’explique très concrètement par la dernière révolution et la forme qu’elle avait adoptée.
Dans les années 70/80, la Confédération avait raffiné un système militaire hérité de 1870. De nature plutôt centralisée et favorisant la création d’une armée de métier, cette armée suivait une stratégie défensive qui s’était, à l’heure des missiles intercontinentaux, développée selon une stratégie visant à résister à une première frappe, de façon à pouvoir répondre et rendre toute invasion ou poursuite des hostilités extrêmement coûteuse. Cette priorisation de la défense répondait à une stratégie politique plus générale visant à éviter de s’aliéner des puissances étrangères. Les interventions étrangères Kah-tanaise étaient bien souvent camouflées par le financement de milices locales ou l’envoie de forces volontaires formées au sein de structures d’échelon communal. Cette armée, quoi qu’il en soit, avait une structure et une façon d’opérer extrêmement centralisée. D’importantes batailles liées à des guérillas monarchistes puis fascistes au sud du pays (des années 1870 à 1930, avec différents degrés d’intensité selon les périodes) avaient rendu la Convention relativement méfiante des initiatives militaires locales, jugées incapables d’efficacement lutter contre les tentatives réactionnaires de renversement et impropres à toute défense nationale face à une force organisée. C’était aussi une question de prestige. Le Grand Kah de l’époque étant une puissance majeure moins par la force de son réseau diplomatique d’influence que par son prestige. Devant démontrer à un monde majoritairement libéral que l’anarchisme pouvait se doter de structures cohérentes. Faute d’ennemi clairement identifié, cette période fut celle d’un relatif apaisement. L’armée, centralisée, servait ainsi principalement d’objet de prestige et de gage diplomatique, ce qui s’inscrit dans une tendance plus générale des comités successifs des années 40 80 à mimer et adapter des institutions et structures libérales classiques.
Cette ouverture sur le libéralisme fut, comme bien souvent, récompensée par un pur et simple déni de souveraineté, incarné par le coup des années 90. S’il est souvent qualifié de coup d’État militaire, ce n’était pas exactement un soulèvement des forces armées contre la Confédération, en témoigne les nombreux officieux qui prirent les armes contre le nouveau régime. Dans les faits ce coup, financé et organisé à l’étranger, avec des cadres des mouvements Blancs en exil, fut principalement incarné par des mercenaires étrangers, des volontaires et des milices radicales formées à l’étranger et infiltrées au sein de l’armée Kah-tanaise en profitant des failles de ses structures, selon le procédé que l’on qualifie désormais d’influence. Ce ne fut donc pas le coup d’État de l’armée, mais d’une frange visant à la subvertir. Faute de soutien populaire, cependant, le gros des effectifs ne suivit pas, il est à ce titre bon de rappeler que la Dictature ne fut au grand jamais stable. Son contrôle de la capitale et des régions contingentes lui fut assuré par l’effet de surprise, celui des côtes par l’intervention de forces étrangères, mais dans les fait ce régime ne contrôla jamais l’ensemble du territoire et fut assez systématiquement force de se battre pour sa survie. Il s’agissait, par de nombreux aspects, d’un pur régime d’occupation soumis aux mêmes contraintes. Pour chaque collaborateurs on trouvait autant de militants armés près à donner leur vie pour libérer leur terre, et peut-être dix fois plus d’hommes et femmes silencieux, attendant passivement que la situation ne s’améliore tout en faisant le maximum pour ne pas aider le nouveau régime, à comprendre : le minimum possible. Cette guerre civile vit donc une force militaire d’abord très centralisée, puis rapidement divisée entre seigneurs de guerre, groupes étrangers, commandements, lutter contre une résistance d’abord désorganisée par la dissolution de l’Armée centralisée mais rapidement incarnée par un véritable maquis héritier de la longue tradition kah-tanaise des citoyens en arme. Loin de prendre une forme centralisée, cette révolution fut la plus pure traduction de l’entrée dans la clandestinité des structures communales qui, d’abord privées d’échelons supérieurs, s’armèrent chacun à leur échelle en enchaînèrent les actions de sabotage et de résistance armée. Les milices se multiplièrent, puis les brigades (milices professionnalisées), et l’arrivée massive d’officiers et militaires de métier de l’ancienne armée dans la résistance eut tôt fait d’accentuer le phénomène de telle manière qu’à la chute du régime dictatorial on estime qu’il y avait en moyenne deux à trois armes de guerre par foyer, contre zéro deux avant le coup. Paradoxalement, c’est peut-être la dissolution de l’armée dans les mouvements de résistance locaux qui finit de convaincre les kah-tanais des limites de son utilité. Et si le Grand Kah fut officiellement une nation désarmée pendant presque quinze ans, les milices et brigades révolutionnaires ne furent jamais dissoutes de telle façon que chaque région comptait encore d’importants réseaux informels de militants circonscriptibles et des brigades de plus en plus équipées, formées, financées par les communes et agissant en fait à l’étranger en toute indépendance de la Confédération, au point de pouvoir prétendre à une situation roche de celle des communes, républiques, syndicats et coopératives constituantes de l’Union. Ce phénomène donna même lieu à la création d’un club politique, le Syndicat des Brigades, visant explicitement à défendre la ligne commune de ces nébuleuses militaristes. C’est d’ailleurs l’influence croissante des brigades (et leur financement par leurs communes d’implantation) qui poussa la Convention à accepter les plans d’Aquilon pour une remilitarisation centrale de l’Union. Là encore il s’agit d’une situation assez paradoxale, la militarisation générale des communes étant justement le fer battu par le citoyen. Ce dernier, cependant, considérait aussi et surtout les nécessités d’une guerre à grande échelle, demandant des moyens que les brigades, avançant en ordres dispersés, ne pourraient obtenir en l’état.
Dans les faits, maintenant, il existait une force armée répondant directement à la Convention Générale, et qui fut utilisée comme matrice pour toute la remilitarisation de l’Union. Il s’agit de la Garde d’Axis Mundis.
Officiellement, la GAM était une émanation de la Protection civile, qui à sa recréation absorba plusieurs brigades pour créer une structure anti-terroriste visant avant tout à éliminer les résidus de guérillas réactionnaires dans l’après-révolution. La GAM, cependant, ne répondait pas aux inquisiteurs de l’égide ou à la magistrature mais bien à la confédération. Composée d’anciens soldats de métier et dirigés par les plus éminents officiers de l’ancienne armée, cette force de dix mille hommes était la seule autorité pouvant pénétrer au sein de la commune d’Axis Mundis avec des armées, et servait plus ou moins de gendarmerie de Commune Ville-Libre. Son rôle assumé était d’empêcher tout nouveau coup d’État. Désormais la GAM est un élément comme un autre de la Garde Communale de l’Union, bien que conservant ses privilèges.
L’Armée de l’Union, cependant, n’est pas strictement centralisée et conserve vivant l’héritage brigadier via un système de recrutement et d’administration localisé à l’échelle des communes supérieurs, s’étendant en autant de commandements et instaurant une plus grande participation démocratique des soldats dans la gestion administrative et la nomination des officiers. Cette Garde, moderne, est en fait une armée hautement moderne et modulaire, dont l’organisation flexible permet de répondre extrêmement efficacement aux différentes situations militaires pouvant justifier son action, ce que son ancêtre, plus rigide et centrée sur la pure question de la défense territoriale, n’aurait pas été capable de faire. De plus, malgré son nom de Garde, cette force armée semble résolument s’orienter vers une la création d’une force de projection et d’occupation importante. Les fonctions strictement défensives étant en fait organisées en coopération avec les cellules communales de la Protection Civile, chargées d’établir des milices de volontaires et soldats de métier strictement spécialisées dans la défense traditionnelle de leur territoire d’implantation et, accessoirement, dans les méthodes de guerre asymétriques.
Dans les faits, l’établissement de ces structures fut, comme bien souvent, le fait de nombreux débats et consensus au sein de la Convention Générale. Une offensive politique menée par plusieurs fronts par le Comité Estimable et qui vint progressivement à bout de la plupart des résistances, soit par pur lobbyisme, soit en traduisant en décisions concrètes les inquiétudes soulevées par les représentants des communes. Outre le cas déjà évoqué de la prolifération des brigades, compris comme un risque par une Union résolument prudente (au moins dans ses conceptions politiques) et ne souhaitant pas voir sa politique orientée vers de l’aventurisme par ces structures militantes, il faut aussi parler de la signature du pacte anti-bolshevik d’Albel, et le cas Francisquien incarnant peut-être mieux que tout autre la réalisation par les kah-tanais que les régimes les plus réactionnaires ou contre-révolutionnaires ne laisseraient pas l’Union en paix sous prétexte que cette dernière luttait pas directemen contre eux. Accessoirement, la décision opportune de mobiliser la Garde d’Axis Mundis sur des opérations extérieures - nommément la guerre civile de Damannie et la protection de Kotios - achevèrent les dernières résistances et permirent de faire passer non-pas une simple extension de la Garde en tant que force opérationnelle hautement professionnelle, mais la création d’une véritable nouvelle structure confédérale d’importance égale à la Protection Civile ou la Planification Démocratique. Pour ça, le comité Estimable doit aussi beaucoup à l’intervention des communes exclaves et de leur représentant élu auprès du comité, dont la position était que le coup réactionnaire n’avait jamais atteint les communes extra-marines, et que celles-là avaient ainsi conservées les structures militaires - notamment administratives - malgré leur dissolution dans l’Union. Argument contré par le sabordage de la flotte militaire de l’Union et le départ de la plupart d’un tiers des effectifs au sein de l’Union, qui rendait dans les faits ces résidus militaires impropres à mener la moindre opération. Tout de même, la ferveur des communes exclaves, traduction d’une inquiétude réelle quant à leur sécurité, permis d’établir un cadre clair d’extension des forces armées, à comprendre que le nouveau modèle militaire serait, en priorité, implanté dans ces communes en vue de répondre à leurs inquiétudes sécuritaires d’une part, et d’expérimenter le modèle critiqué par certaines des communes continentales de l’autre.
Quoi qu’il en soit, et en dehors des succès indéniables que représente cette remilitarisation pour le Comité, et des portes qu’elle ouvrit effectivement sur le plan de la diplomatie et de l’influence étrangère de l’Union, on ne peut pas nier qu’en l’absence de structure véritablement claire servant à contrôler la gestion de cette armée, et malgré son organisation confédérale, les critiques voulant faire d’Aquilon un dangereux centralisateur cherchant en fait à mettre la main sur une force armée soumise au comité plutôt qu’à la convention ou aux communes semblaient, en termes strictement factuelles annonciatrices des échecs qui amenèrent à la fin du Comité Estimable et à l’actuel important travail intercommunale cherchant à clairement définir les formes de ce Commissariat à la Paix dont on nous promet désormais la prochaine structuration.
L’économie, succès ignoré du Comité :
L’un des plans où le Comité engraina peut-être le plus de succès, ou plus précisément, où il n’engraine pas le moindre échec venant contrebalancer ses succès, fut celui de l’économie. Il est un fait que les kah-tanais semblant désormais prendre pour acquis, c’est que l’économie va bien, et que ce que les pays capitalistes qualifient de croissance, qu’on nommerait plutôt ici d’augmentation des moyens locaux de production, va bon train. C’est l’héritage d’une politique qui précède Estimable, mais qu’il a participé à renforcer et à institutionnaliser de façon extrêmement efficace, notamment grâce aux efforts de la citoyenne Isabella Zeltzin et du citoyen Suchong.
La stratégie économique sur laquelle s’est reconstruite l’Union est bien connue : assurer une forme d’autarcie dans la production des ressources et des biens stratégiques et vitaux, permettre un plus grand accès au marché dans le domaine des ressources inaccessibles sur le territoire national et des biens de consommation. La reconstruction économique de l’Union s’est faite par étape, en suivant une politique prudente de cloisonnement des dépenses selon l’origine des fonds de telle façon que l’économie du Grand Kah ne saurait être, par exemple, dépendante des investissements étrangers ou des fonds soulevés par la le commerce extérieur, pour son fonctionnement quotidien. L’argent obtenu via l’exportation de ressources et de produits à forte valeur ajoutée sert strictement non-pas à assurer le fonctionnement quotidien de l’Union ou à importer des ressources, mais à financer des infrastructures et des industries, dont l’entretient est cependant à la charge de sommes déployées de façon autonome ou autarcique par l’Union. Cette conception hautement protectionniste, qui évite la rigidité excessive grâce à la décentralisation de l’économie, a d’une certaine façon limitée ce qui aurait pu être une croissance explosive de l’Union. C’est que la croissance actuelle est déjà qualifiée de « miracle économique ». En un sens le mieux est l’ennemi du bien : il a été jugé plus important d’assurer la sécurité de l’Union que sa prospérité rapide. Cette politique s’est métamorphosée durant les neuf années d’opération du Comité Estimable, de façon à s’adapter aux circonstances et objectifs diplomatiques affichés par ce dernier. Ainsi, une importance toute particulière fut donnée au fait de trouver des marchés « amis », suivant une logique au moins partiellement idéologique les rendant plus sûrs, ou bien défendus par une nation suffisamment puissante pour se prémunir de toute tentative impérialiste de guerre commerciale visant les exportations ou importations kah-tanaise avec la dite nation. Parallèlement, il s’agissait aussi pour l’Union de cannibaliser le monde capitaliste. Soit en devenant un partenaire économique essentiel pour l’équilibre économique de régies libéraux (en développant un quasi-monopole sur la vante ou l’achat de certains biens, produits, services), soit en exploitant le système financier international, à la nuance près que les fonds d’investissement kah-tanais ne font pas s’échouer leurs richesses dans l’abysse sans fond que compose les comptes en banque d’un milliardaire, mais dans des caisses coopératives visant spécifiquement à renforcer la capacité d’action et de nuisance de ces fonds, dans un but avoué et assumé de porter le marché au paroxysme de sa logique libérale, sachant que le Grand Kah serait, par son fonctionnement, relativement épargné en cas de grande crise économique mondialisée. Une logique accélérationiste qu’on pourrait synthétiser dans les paroles cyniques d’Elan Klaus, ancien commissaire au Maximum : « En cas de crises, leurs économies s’effondreraient. Le prix des denrées éclaterait et les systèmes d’inter-dépendance tireraient tout le monde vers le bas. Sauf le Grand Kah. Faute d’investissement il cesserait de croître... Aussi rapidement qu’il ne le fait. C’est à peu près tout. ».
Du reste, le développement d’une économie destinée à l’exportation a donnée lieu à la création de plusieurs industries se caractérisant par une faible demande en personnel humain pour un fort degré de rentabilité. Outre les domaines prestigieux du luxe, de la mode, de la culture, ce sont des domaines aussi variés que la robotiques, l’aérospatial ou les pièces mécaniques de haute précisions qui caractérisent désormais le dynamisme du Grand Kah moderne. Leader dans plusieurs domaines et sur plusieurs marché, l’île isolée de l’anarchie est plus que jamais un acteur important du marché mondial, parfaitement modernisé et démontrant peut-être que la prospérité n’est pas dépendante d’une libéralisme strictement capitalisé.
Les affaires étrangères, entre succès concrets et échecs cuisants :
L’aspect, peut-être, le plus caractéristique du Comité Estimable est la politique étrangère qu’il a insufflé à l’Union pendant neuf ans. Le plus caractéristique, oui, car le plus remarquable : contrairement à la bonne conduite des affaires sociales et économiques, qui tiennent de l’acquis, de l’attendu, la diplomatie menée par le Commissariat aux affaires étrangères suit une logique beaucoup plus novatrice et détonante aux yeux d’une population kah-tanaise qui ne savait pas nécessairement à quoi s’attendre. Dans la perception populaire, l’importance de la diplomatie prend en fait des proportions hypertrophiées tendant à minimiser l’impact pourtant central de tout les autres domaines, et leur tendance à s’entre-influencer. Il faut donc s’enlever de l’esprit l’idée selon laquelle le commissariat agirait seul. Il agissait de concert avec toute l’Union et ses décisions, bien que marquées par les plans de la citoyenne Actée, n’étaient rendus possibles que par la coopération des autres commissariats, comités, communes. Le lead apparent du dit commissariat vient surtout de l’impressionnante capacité qu’a ce dernier à mettre en scène sa fonction et à communiquer sur ses missions, quand bien même elles ne sont que l’émanation d’une logique discutée entre instances administratives, politiques, et suivant une logique entendue à l’avance.
D’un autre côté, c’est bien cette hypertrophie ressentie qui a, d’une certaine façon, donné lieu à la situation d’hypertrophie potentiellement réelle, pouvant être l’une des explications de la crise finale ayant imposée au comité sa propre dissolution.
Sur le principe, le principal enjeu d’Estimable était, dans la forme qu’il a adoptée au courant des anées 2000 et plus précisément lors de la deuxième moitié de son existence, à partir de 2003, de former un nouveau réseau diplomatique propre à répondre aux besoins du Grand Kah en termes tant sécuritaires que commerciaux. La question d’avec qui établir ces partenariats était d’autant plus centrale qu’une large division séparait les différents élus de la Convention générale. Il était globalement admit qu’il allait falloir, du simple fait de la domination des systèmes capitalistes, pactiser avec certains de ces derniers en vue, au moins, d’assurer la crédibilité internationale du Grand Kah au cas où il lui viendrait l’envie de reprendre en main le destin révolutionnaire mondial. Cependant les limites à établir n’étaient pas claires. Devait-on s’entendre avec des gouvernements progressistes uniquement ? Dans quelle mesure ? Les éventuels opportunismes de droite pouvant être profitables à l’Union devaient-ils être facilités ? De même, la question des dictatures se prétendant d’idéologies socialisantes fut à l’origine de bien des débats. Devait-on, très concrètement, s’autoriser de pactiser des régimes que seule la couleur des drapeaux séparait du fascisme le plus pur et simple sous prétexte que ceux-là prétendaient, à terme, mettre un terme à l’oligarchie capitalisante ? Cette idée semblait parfaitement exécrable à une grande majorité de la Convention et encore aujourd’hui les initiatives portées par les régimes Euryso-communistes tendent à faire grincer une Union pour qui la fin des oppressions ne peut pas se faire au prix de nouvelles oppressions. Ces nombreuses discussions amenèrent à la création d’un important corpus de textes et de compromis qui servirent de matière première que la citoyenne Actée, et c’est là son véritable génie, fit en sorte d’adapter à ses propres positions. Il fut donc décidé de soutenir les régimes révolutionnaires en priorité et d’établir rapidement une entente solide pouvant se comporter de façon autonome et sans compromis. Un partenaire étonnant s’avéra être le Pharois, notamment après l’élection d’un gouvernement largement dominé par la liste écologiste-communiste, et donc le système profondément parasitaire faisait aussi un ennemi des puissances capitalistes standards tout en assurant à sa population une dose tout à fait satisfaisante de liberté individuelle. Un autre partenaire tout trouvé furent les Églises Australes Unies, dont le gouvernement fut renversé par une révolution populaire d’inspiration libertaire peu de temps après l’adoption par le Commissariat aux Affaires Extérieures du plan qui allait mener à la création du Liberalintern.
Accessoirement, des pactes furent liés avec plusieurs régimes démocratiques sur la base d’intérêts économiques et géopolitiques communs, de telle façon que le Grand Kah échappa progressivement à son image de régime illibérale pour entrer, pleinement et entièrement, dans le rang des puissances légitimes - ce qui aboutit finalement à la création d’un important réseau informel de soutiens, notamment en rapport à la question de l’Alguarena sur laquelle nous reviendront ultérieurement.
Enfin, la question des dictatures socialisantes fut traitée de façon extrêmement pragmatique. Reconnaissance diplomatique minime, rien qui ne puisse renforcer outre-mesure le régime, installation de liens au plus haut niveau visant à faciliter l’éventuelle exploitation de ces dictatures. Enfin, mise en place de mesures visant à renforcer ou affaiblir leur capacité de nuisance selon les besoins du moment, en vue de pouvoir créer de nouveaux fronts diplomatiques voir militaire contre les ennemis de l’Union.
Par ordre, on trouve ainsi des alliés, des partenaires et, finalement, des outils. La ligne Actée faisait la part-belle à l’idéologie est on peut donc remarquer que les régimes rangés dans ces trois catégories sont tous extrêmement similaires sur le plan de ce qu’ils défendent, de telle façon qu’il est pour l’heure impossible de savoir, par pure analyse empirique, si ces pays se retrouvent traités de la sorte parce que leur idéologie les pousse à adopter une politique rendant nécessaire ce genre de réponse, ou si les réponses sont indépendantes de la politique géopolitique de ces régimes et se contente uniquement de prendre en compte leurs postures idéologiques. Dans tous les cas, Actée ne se cachait pas de défendre une ligne « morale » visant avant tout à favoriser les droits de l’homme, la démocratie directe et le respect mutuel entre partenaires. Suivant, toujours selon elle, une logique globale considérant la lutte du Grand Kah comme mondiale, un partenariat enrichissant peut ne pas en valoir la peine s’il enrichit un ennemi factuel des principes moraux défendus par l’Union.