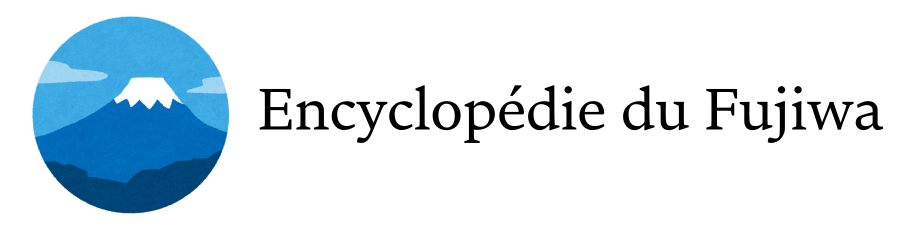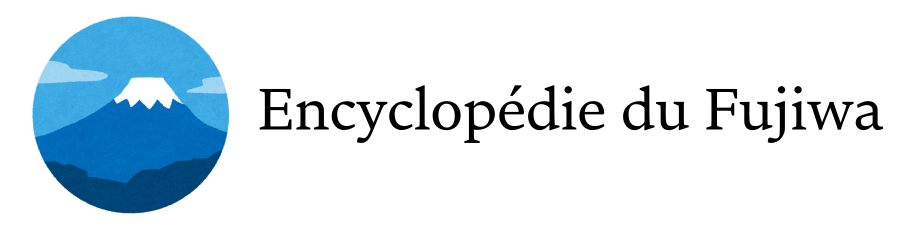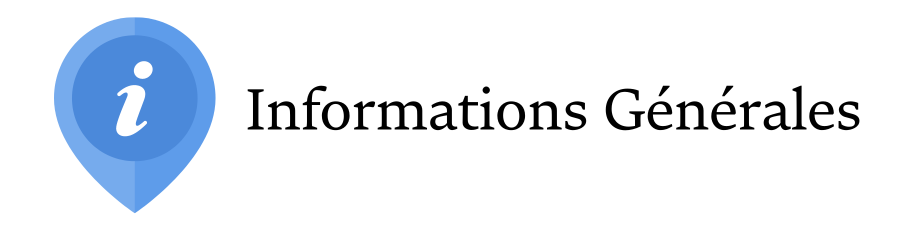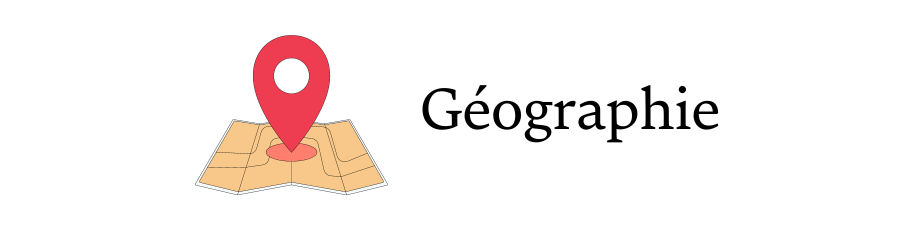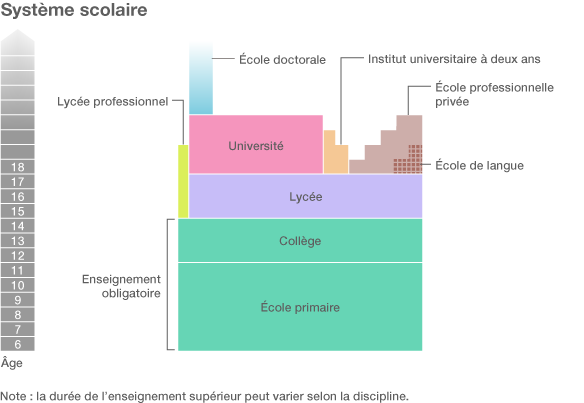Les premières mentions du Fujiwa en tant que territoire occupé remontent à la période préhistorique, aux alentours de 12 000 av. J.-C., avec une culture de chasseurs-cueilleurs et le développement des premières poteries au monde. Vers 300 av. J.-C., la population adopte la riziculture ainsi que le travail du métal, marquant l'émergence des premiers systèmes agricoles. C’est à cette époque que les premiers groupes sociaux se structurent et forment une société sur ces terres nazumis.
En 250, la formation du premier État est attestée. L'État de Wano adopte un régime impérial dirigé par des institutions issues directement de la dynastie Kozuki, la première et unique divinité shintoïste sur Terre.
Progressivement, Wano se développe sous l’influence de cultures étrangères, notamment avec l’introduction du bouddhisme depuis le Nazumi et du christianisme apporté par des missionnaires de Listonie. Cette période voit également la centralisation de l’État et l’essor d’une culture écrite propre.
En 1185, la ville de Kamakaru devient le centre d’une nouvelle ère, marquant le début du Moyen Âge à Wano. Durant cette époque, une classe guerrière et noble, les samouraïs, émerge et façonne l’avenir du pays. La culture connaît un essor remarquable grâce à l’adoption du bouddhisme zen et au développement d’une éthique guerrière. Cependant, cette classe échappe rapidement au contrôle de l’Empereur, relégué à un rôle symbolique. Le clan Adachi, dominant en 1185, renverse ses rivaux et instaure le shogunat Adachi.
Durant leur règne, en 1232, le Goseibai Shikimoku, premier code de droit militaire de Wano, est élaboré. Ce document, aussi appelé Formulaire des Adjudications, marque la transition d’une bureaucratie confucéenne vers un État militaire. Les Adachi poursuivent une lutte incessante contre diverses sectes bouddhistes au fil des générations.
La période unifiée de Wano, s'étendant de 1333 à 1640, est désignée sous le nom d’ère Haku. Le shogunat Nakamura instaure une hiérarchie sociale et politique rigide, mettant en place une structure féodale où le shogun détient le pouvoir militaire, tandis que les daimyos gouvernent sous son autorité. L’Empereur, toujours issu de la dynastie Kozuki, conserve un rôle purement symbolique.
Les relations avec les Eurysiens, notamment l’Empire de Listonie au XVIe siècle, apportent armes à feu, nouvelles idées et technologies, renforçant la puissance de Wano tout en posant de nouveaux défis. Le pays reste uni grâce à une bureaucratie efficace et une diplomatie isolationniste, limitant le commerce aux chrétiens listoniens et aux peuples nazumis. Cette stabilité favorise un développement culturel sans précédent dans les domaines de l’art, du théâtre, de la littérature et de la philosophie.
Toutefois, un changement s’amorce progressivement, fragilisant la structure du shogunat. Les évolutions politiques, philosophiques et scientifiques ébranlent l’ordre établi. Au début du XVIIe siècle, ces tensions atteignent un point critique. En 1640, l’incapacité du shogunat à s’adapter entraîne la fragmentation du pays, mettant fin à la dynastie des shoguns et ouvrant la voie à la division de Wano en deux royaumes distincts.
La période Aiyama débute en 1640 avec l’éclatement de Wano en deux entités : le Royaume de Jinse et le Royaume d’Aichi. Jinse, un État puissant, adopte un système de gouvernance relativement libéral et une monarchie constitutionnelle où le pouvoir du monarque est encadré par un corps d’élus. Favorable aux influences extérieures, Jinse devient un centre d’innovation, attirant intellectuels, artistes et scientifiques, tout en préservant sa culture et son identité.
Aichi, en revanche, conserve une structure gouvernementale plus conservatrice et féodale. Fort de sa position stratégique et de ses ressources, il devient un bastion agricole et commercial, valorisant les traditions shintoïstes et culturelles ancestrales.
Durant la période Aiyama, les deux royaumes alternent entre guerres et coopérations, notamment face à des menaces communes telles que les pirates et les bandits. Malgré ces conflits, la culture continue de prospérer. Jinse joue un rôle majeur dans la formation de l’identité fujiwane, tandis que l’héritage historique de Fujiwa influence la culture jinsee. Jinse s’ouvre aux influences étrangères, tandis qu’Aichi se replie sur ses traditions millénaires.
Entre 1870 et 1927, Wano traverse une phase révolutionnaire marquée par la centralisation politique. Le Royaume d’Aichi, dominant le nord de Wano et la région de Hoenn, s’industrialise rapidement et modernise ses institutions. Il adopte des modèles étrangers, tandis que son dialecte et son alphabet (japonais) s’imposent dans l’administration et l’éducation, renforçant son hégémonie.
Le Royaume de Jinse, ancré dans la région de Moon et l’ouest de Hoenn, lutte pour préserver son identité face à l’influence croissante d’Aichi. Il adopte une langue et un système d’écriture distincts (inspirés du coréen) afin de se différencier. Toutefois, la position politique et territoriale de Jinse demeure fragile, souvent remise en question par Aichi.
À noter que la famille impériale Kozuki réside au sein du Royaume d’Aichi, consolidant sa légitimité spirituelle, culturelle et politique, tant sur le plan intérieur qu’international.
Les conflits sociaux et politiques atteignent leur apogée en 1900, lorsque la guerre entre Aichi et Jinse éclate véritablement, redéfinissant les frontières et les alliances politiques au sein de Wano.
L’année 1927 marque un tournant dans l’histoire de Wano avec la formation de l’Empire d’Aichi. De manière audacieuse et méticuleusement planifiée, le Royaume d’Aichi se transforme en une puissance impérialiste. Cette année est également témoin de l’une des plus grandes tragédies de l’histoire de Wano : l’annexion complète du Royaume de Jinse. Avide de pouvoir, l’Empire d’Aichi attaque Jinse et l’annexe à son territoire. Cette conquête brutale constitue un revers majeur pour le peuple jinséen, marquant le déclin de son indépendance culturelle et politique. L’offensive est rapide et redoutablement efficace pour l’époque : en seulement trois ans, un si vaste territoire est conquis sans laisser à ses habitants le temps de s’organiser pour se défendre. Après cette victoire, l’Empire d’Aichi impose sans hésitation ses modèles culturels et linguistiques. Les institutions jinséennes sont démantelées et les marqueurs identitaires de la nation sont effacés. Les noms des villes et régions sont modifiés, et une politique d’assimilation systématique est instaurée pour faire disparaître toute distinction jinséenne.
Face à la répression culturelle et politique, de nombreux jinséens choisissent l’exil entre 1931 et 1935. Ils se regroupent sur les îles de Moon, à l’ouest de Wano, près du Jashuria. Relativement isolées de l’influence d’Aichi, ces îles deviennent un refuge pour les jinséens. Là, ils bâtissent une société où ils peuvent vivre selon leurs traditions, parler leur langue et préserver leurs coutumes. Les îles de Moon deviennent ainsi un bastion de la culture et de l’identité jinséenne, tandis que ceux restés sous domination aichienne subissent une pression et une oppression croissantes.
À partir de 1936, l’Empire d’Aichi amorce une expansion coloniale au-delà de ses frontières traditionnelles. Cette période est marquée par des conquêtes impérialistes, notamment celles du Haekang et du Negara Strana. Ces nouveaux territoires, riches en ressources, sont essentiels pour l’Empire. Une administration efficace y est mise en place, imposant la langue, la culture et le système éducatif aichiens. Toutefois, cette intégration se fait souvent au détriment des cultures locales, dont l’effacement progressif accompagne la domination impériale. En parallèle, l’Empire introduit de nouvelles infrastructures et technologies, contribuant à la modernisation et à l’essor économique de ses colonies.
Durant cette phase expansionniste, l’Empire d’Aichi accorde une attention particulière au développement militaire et industriel. Entre 1946 et 1955, il renforce sa défense et son industrie, grâce notamment aux ressources et aux richesses de ses colonies. L’armée est modernisée dans l’espoir de consolider la domination impériale et d’affirmer son rôle de puissance nazumienne. Cette période voit également une croissance économique significative : les industries se développent, propulsant Wano dans l’ère industrielle. Toutefois, cette prospérité s’accompagne d’une concentration accrue du pouvoir au sein de l’élite impériale et d’une aggravation des tensions sociales et ethniques.
Les dernières années de l’Empire d’Aichi sont marquées par une instabilité croissante. Dès 1956, les premières fractures au sein de l’establishment politique et militaire se manifestent, annonçant le déclin imminent du régime impérial. La situation s’aggrave en 1960 avec la mort soudaine de l’Empereur, survenue sans qu’il ait désigné d’héritier. Une crise de succession éclate, entraînant une lutte de pouvoir qui paralyse l’administration impériale. Finalement, l’Empire d’Aichi s’effondre sous le poids de ses contradictions internes et de son incapacité à gérer un territoire aussi vaste. En 1960, l’Empire disparaît, laissant derrière lui un pays divisé et en quête d’une nouvelle direction.
Après la chute de l’Empire d’Aichi, un changement systémique s’opère dans la structure politique de Wano, qui devient officiellement le Fujiwa. Le nom, conservant la racine "Wa", est associé à Fuji, le Kami ayant révélé la nouvelle voie à suivre après l’effondrement d’Aichi. En 1960, le pays adopte une monarchie constitutionnelle, marquant une rupture nette avec l’ancien régime autoritaire. Cette décennie est caractérisée par un processus profond de démocratisation : les institutions impériales sont démantelées et de nouvelles structures démocratiques sont mises en place. Un parlement élu voit le jour, soutenu par la société fujiwane. La constitution, rédigée à cette époque, est un texte progressiste garantissant les droits et libertés fondamentaux, ainsi que les principes de justice, d’égalité et de démocratie. Cette période de transition est empreinte d’optimisme et de reconstruction, et les citoyens du Fujiwa participent activement à la refondation de leur nation.
Bien que son rôle soit désormais essentiellement symbolique, la famille Kozuki demeure une figure essentielle de l’unité nationale et de la continuité historique. Dans les années 1970, elle joue également un rôle de médiation entre l’héritage féodal de Fujiwa (anciennement Wano) et son avenir démocratique. Elle incarne une réconciliation entre tradition et modernité et inspire la population par son exemple de dignité et de sagesse. Cette période connaît aussi un regain d’intérêt pour l’histoire et la culture nationales : des valeurs et pratiques culturelles, autrefois marginalisées, sont redécouvertes et célébrées, renforçant ainsi l’identité fujiwane.
Les années 1980 marquent la consolidation de la démocratie fujiwane. Le parlement devient un organe dynamique et représentatif, favorisant les débats et la prise de décisions reflétant la diversité sociale. D’importants progrès sont réalisés dans les domaines de l’éducation, de la santé et des services sociaux, témoignant d’une volonté d’améliorer la qualité de vie des citoyens. L’innovation sociale et le libéralisme deviennent des piliers du gouvernement, et de nouveaux projets de développement économique et social transforment le pays.
À l’aube du XXIe siècle, l’économie du Fujiwa amorce une nouvelle phase. S’éloignant des modèles centralisés du passé, le pays s’oriente vers le libéralisme économique et s’ouvre aux investissements étrangers, favorisant ainsi un marché compétitif. Les années 2000 voient l’émergence de géants industriels et financiers, dirigés par des entrepreneurs ayant su exploiter cette dynamique économique. Nombre de ces entreprises trouvent leurs racines dans d’anciennes familles féodales, ayant transformé leur héritage en puissantes corporations influençant la politique et la société fujiwanes. Ces évolutions économiques et sociales façonnent le Fujiwa moderne, ancré dans la tradition tout en s’ouvrant à la mondialisation.
À partir de 2016, l'État du Fujiwa est frappé par une déstabilisation intérieure majeure, marquée par une polarisation croissante de la société par la crise de Moon. La discrimination historique des Jinseens refait surface, menaçant l'unité nationale et exacerbant les tensions communautaires. Cette fracture sociale entraîne une vague d'assassinats politiques, des conflits ethniques et un retour du shintoïsme au cœur des affaires politiques, culturelles et sociales. Bien que la démocratisation et la libéralisation amorcées dans les années 1960 aient apporté de nombreux bénéfices, elles n'ont pas produit l'effet escompté sur la cohésion du peuple fujiwan.
Face à cette situation, des figures conservatrices, principalement issues de l'héritage de Aichi, émergent sur la scène politique. Le clan Shimura prend une place centrale et instaure un shogunat constitutionnel, renforçant les pouvoirs de l'exécutif afin de contrer la menace extérieure du libéralisme et de préserver les traditions. Le discours nationaliste s'appuie sur la montée en puissance du Grand-Kah au Nazum, grande puissance mondiale, pour justifier la nécessité d'un État fort et sécuritaire.
Dans cette dynamique de recentralisation et de retour aux racines culturelles, l'État du Fujiwa reprend son appellation historique d'État de Wano, réaffirmant ainsi son identité traditionnelle. Le peuple, désormais désigné sous le nom de peuple Wa, se voit réinscrit dans un cadre politique et culturel marqué par l'héritage shintoïste et l'affirmation des valeurs ancestrales.