Activités étrangères dans l’État valinoréen
Posté le : 11 jan. 2024 à 13:58:28
434
Posté le : 24 mars 2024 à 22:10:57
3000

Des exercices militaires simulent un combat forestier dans la vallée de Førdeild sur la frontière avec l'Etat valinoréen

La forêt de Førdeild présente de nombreux attouts selon le ministère justifiant l'exercice. La proximité avec la frontière ne veut aucunement faire passer un message offensant et l'Etat-Major général a indiqué qu'il autorisait sans problème quelques observateurs valinoréen à venir s'en assurer. Non, c'est surtout que cette forêt a quelque chose de très intéressant : elle ressemble à toutes les autres. Loin de la particularité des forêts boréales halviennes ou des terres marécageuses de l'arrière pays Norjien, la vallée de Førdeild ressemble à la forêt eurysienne la plus classique. Les mêmes arbres, les mêmes collines légères mais sans trop être marquée, le même terrain boueux à l'automne et les mêmes sols gelés l'hiver. Changez la langue et vous y changez le pays. C'est ces raisons là qui font d'une partie de cette forêt, sur quelques 20 000 hectares, le champ d'entraînement favori de la Force de Défense Territoriale Tanskienne.
Une fois par an environ, le terrain s'anime, on y bâtit à la hâte et en placo de fausses villes, on recreuse des réseaux de tranchées, on y simule des champs de mines, on inonde quelques champs, en bref, on modèle cette immense champ pour y manœuvrer. Et en ce petit matin, alors que la compagnie B dormait tranquillement dans les fausses maisons d'un village au doux nom auccit, la surprise fut complète. Pendant toute la journée, et sans le soutien de l'artillerie, la compagnie défendit le village - sans tir à balles réelles évidemment - contre une large incursion d'infanterie. Il fallut attendre la reconnaissance aérienne et l'assaut blindé des renforts du 104th Expeditionnary Cavalry "Blackhorse" Regiment pour finalement arracher le village aux assaillants. Quelques minutes plus tard, il était virtuellement rasé par l'artillerie adverse. Le 104th n'y était pas entré, la compagnie B elle, était la encore virtuellement dans un état opérationnel amoindri. Au petit soir, un bref résumé fut fait aux hommes et femmes qui retournèrent ensuite dormir dans des tranchées, le son de quelques drones, amis ou ennemis, perturbant un sommeil déjà bien léger.
Au total, cette manœuvre durait un total de trois semaines se passant avant tout en forêt. Les forces retournèrent évidemment à leur caserne de même que les blindés. Cette fois-ci les attaquants avaient fini par l'emporter au bout de la seconde semaine, le village perdu au milieu de la forêt avait fini par être pris. Les résultats plus précis, l'armée ne les communiqua pas, ils sont secret défense. Le seul mot qui nous fut donné fut "satisfaisant." Pour la défense ou pour l'attaque, ça, la Muette fédérale n'en dira pas plus.
Posté le : 26 juin 2024 à 18:17:37
1714

Ouverture de l'Institut Brøndum à Orostar
Indépendants et autonome de la gestion de l'Etat fédéral, les instituts Brøndum sont les héritiers d'une longue politique linguistique descendant des grandes explorations et des volontés de présentation et d'exportation du modèle tanskien à l'étranger, principalement porté par l'Eglise, aujourd'hui quasiment disparu, des mouvements humanistes abolitionistes puis, à la fin du XIXe siècle, par l'émergence du Costanskisme. Ainsi les instituts Brøndum ont des fonctionnements régulièrement différents d'un institut à l'autre. Plus qu'un système, il s'agit d'une chaîne, d'un nom, d'un label qui est apposé par le ministère fédéral de la Culture auprès d'établissements tanskiens à l'étranger remplissant des conditions et en faisant la demande. Mais un institut peut ainsi être particulièrement centré autour des questions linguistiques, humanitaire, associative, culturelle ou encore, dans un certain nombre de cas, costanskiste.
L'institut Brøndum d'Orostar est lui classique. Centré sur la culture et la langue. lié aussi à l'université centrale d'Haapislmi, il peut être un vecteur important de lien avec des entreprises tanskiennes et donc pourvoyeur de facilité d'accès aux visas de travail, nécessaire à toute obtention d'un emploi en Tanska dès lors que l'on est étranger, à l'exception de certains pays. Cet établissement pourra entre autre délivrer des diplômes en langue tanskienne pouvant grandement faciliter l'accès à un meilleur avenir et à un meilleur emploi pour les populations valinoréenne désireuses.
Posté le : 02 sep. 2024 à 21:58:50
0
Pour la formation d'une ligue de défense de nos intérêts communs
"A toutes les forces de bonne volonté en ce continent et du reste de ce monde, j'en appelle à toutes les nations libres et désireuses de le rester, du danger que représente ces choses qui composent notre paysage politique eurysien actuel. Ces organisations supra-nationales qui défigurent le sens du mot "souveraineté" et qui se servent de tout leur poids pour interférer dans l'existence de ceux ne désirant que la tranquillité d'âme, d'esprit, et dont l'unique volonté est d'exister dans la paix de leur foyer, sans que l'on ait à les invectiver de vivre d'une mauvaise manière. Que ces Hommes soient libres de vivre selon leurs valeurs et conscience propre, c'est là mon seul désir. La Grande République de Velsna sera toujours l'ennemie de toutes les volontés d'hégémonie d'un petit groupe de nations, quelle que soit les valeurs dont ces dernières se targuent ou les convictions politiques qu'elles brandissent. Cela n'a toujours et éternellement que la même finalité: une hégémonie politique, économique, culturelle ou les trois à la fois. Je suis de ces hommes qui estime que c'est la seule volonté d'un peuple qui est légitime à la direction qu'il prendra: si celui-ci désire la démocratie, que l'on ait pas à lui imposer par les armes, et il en va de même avec le communisme et tous les régimes ne mettant pas en péril le droit de leurs voisins à faire de même. OND, Liberaltern, ONC...ce sont là des appellations différentes pour une même méthode de terreur et de pression politique sur les petits, les faibles et les nations isolées. Le seul horizon politique auquel ces nations ont le droit est le suivant: quand est-ce que notre tour sera venu d'être la cible d'une intervention criminelle d'une armée qui causera bien davantage de mal que de bien à notre patrie ? Alors que le sens de l'Histoire devrait être dédié aux particularismes et à l'exception que représente chacun d'entre nous, nous nous complaisons à éterniser un monde ne nous laissons d'autre choix que la conformité. La conformité ou la disparition, tels sont les deux seuls choix de ces nations.
C'est pourquoi, en vertu de l'état politique désastreux d'un monde partagé entre des organisations au but noble, mais dont la finalité est mortifère, que nous annonçons le présent projet validé par le Sénat des Mille de la Grande République de Velsna: à savoir la mise en place d'une Ligue d’États souverains et indépendants, dont le seul et unique but sera la préservation de leur indépendance à tout prix. Notre organisation ne sera pas une union économique, ni même une union politique ou culturelle artificielle et dont les contraintes seraient bien trop nombreuses à notre goût. Il ne s'agira pas là non plus de nous affilier à raison d'une idéologie commune, car nous n'avons que faire que de la manière dont vous concevez votre monde. Il ne s'agira en réalité là que de deux choses: un pacte défensif commun, et uniquement dans ce cas de figure, et la mise en place d'un marché de l'armement interne à tarifs préférentiels. Ni plus, ni moins, car nous pensons qu'il n'y a guère meilleure organisation supra-nationale que celle que l'on voit le moins souvent.
En vertu de ces principes que l'on pourrait qualifier à juste titre de minimaliste, nous n’exigerons des futurs intéressés que deux choses:
- De ne faire partie d'aucune des trois organisations suivantes: ONC, OND ou Internationale Libertaire.
- De respecter votre engagement vis à vis de ce pacte de défense, qui mettra en jeu nos paroles et notre dignité."
Si vous êtes intéressés par ce projet, veuillez remplir ce formulaire dans l'éventualité d'une conférence qui se tiendra en la cité de Velcal, en Grande République de Velsna:
[b]Entité participante (nom complet du pays):[/b]
[b]Nom du représentant ou de la représentante:[/b]
[b]Observations personnelles et attendus de cette future organisation:[/b]
Posté le : 10 sep. 2024 à 09:16:54
1651

Le Norjien Defense - VALINOR
Le programme balistique valinoréen inquiète Tanska
Par Bjarne Henriksen (Norja), le 18 juillet 2014.
La porte-parole du gouvernement, Anneli Huttunen, a indiqué hier que le gouvernement avait été briefé par les services de renseignements sur le développement d'un programme balistique valinoréen. Dans un contexte de tensions croissantes avec l'Union Economique Eurysienne, elle-même en proie à des difficultés politiques, la dotation d'un tel programme "n'envoi pas un bon message" a reconnu un proche de la Première Ministre en sortie de conférence de presse.
"Nous sommes au courant d'informations crédibles fournies par les services sur le développement d'un programme balistique valinoréen" a reconnu Anneli Huttenen. "Nous essayons de découvrir si il s'agit la uniquement d'un programme national ou bien d'un programme permit par une assistance étrangère. Dans les deux cas cela représente une escalade substantielle dans la région de la part de l'Etat de Valinor" a-t-elle précisé.
Si le gouvernement estime bien évidemment que l'Etat de Valinor est souverain dans sa constitution de forces défensive, il estime que de telles constructions pouvant directement cibler le territoire fédéral tanskien sont inutiles et hautement dangereux. Aucune mesure n'a été annoncé par le gouvernement mais un "suivi" attentif du dossier sera effectué plus régulièrement. Le gouvernement a indiqué ne pas avoir de nombre précis sur les missiles en dotation au sein de l'Etat de Valinor ni leur caractéristiques techniques précises. Le déploiement d'unités anti-aériennes proche de la frontière a pour le moment été rejeté par le ministère de la Défense fédérale.
Posté le : 10 sep. 2024 à 23:35:56
6669
Une salle attira mon attention, son bureau. Régulièrement pour ne pas dire quotidiennement, mon oncle formait des petits châteaux de livres variés sur le bois massif de son meuble favori. Trop fragiles, aux fondations incertaines et à la position aléatoire, les forteresses temporaires de mon oncle ont toujours suscitées en moi mépris et fascination. Pourquoi un homme d'une telle sagesse, doté de tant de pierres solides s'enfermait-il dans de si fragiles fortifications. Trop jeune, je ne comprenais pas alors qu'il bâtissait en lui un autre domaine. La révolution vint quand, un jour, je fis tombé par hasard une pierre qui s'ouvrit en deux. Devant moi, deux feuilles noircies venaient d'apparaître. Ce jour là, j'ai rencontré les mots, l'écriture et sans doute un certain amour pour les textes justifiés, correctement ordonnés et parfaitement normés qui font le charme et la perfection de l'administration tanskienne. Les fortifications médiévales s'effondraient, ma Renaissance venait de débuter.
Mon oncle compris rapidement mon attrait particulier pour ces livres et m'introduit progressivement aux joies de son royaume. Pour cela, nous partions régulièrement dans l'arrière pays d'Haapislmi. Une terre si belle qu'aucune cité valinoréenne ne lui arrive à la cheville. En m'emmenant là-bas, plus que la lecture, il me donna l'amour du pays. Nous nous baladions à travers les villages, les vieilles maçonneries ou des briques de pierre remplaçaient mes briques de papiers. Nous visitions régulièrement des églises. Curieuse activité d'une famille athée. Il leur reconnaissait la des "compositions" singulières, des formes vitraux, des chorals, des décorations que les livres ne suffisaient pas à décrire. Rare manquement qu'il leur autorisaient. Mais ce qu'il préférait avant tout était l'anonymat absolu de ces édifices. Loin de la grande cathédrale de Norja signée des mains de ses créateurs, ces églises là reflétaient selon lui l'Humanité la plus pure, le don de l'Homme à Dieu. Il y trouvait une forme de religion plus intime que les messes, plus proches que les prières, là, dans l'admiration constante de ces anonymes pierres taillées. Pourtant, il connaissait l'architecte de Notre Dame de Norja. Certes, il est mort il y a de ça quelques siècles, mais l'homme avait écrit, et mon oncle l'avait lu. Les églises représentaient le Divin et seuls les livres pouvaient s'en accommoder. Un même souffle modelait les œuvres humaines et les ouvrages dédiés à Dieu. Un arc-boutant lui rappelait les descriptions d'Ibsen ; il voyait en les détails de Grieg la symbolique des vitraux ; L'Esprit de Munch ne pouvait que faire partie de la Trinité ; la Beauté divine, elle, proche au possible de la vérité, se reflétait en la plume de Flagstad. Tant de noms et de comparaison ont inscrit en moi une religion et elle avait un nom. Bibliothèque.
Par passion, je me suis longtemps destiné à lire ces églises de la religion littéraire tanskienne. Mon oncle m'en appris les noms, je tâchait d'en maîtriser les Actes, les Testaments. Je les récitait tels des Saints et des Prophètes vouant un culte simple au panthéon de ma bibliothèque. Pourtant, lui les lisaient rarement. Uniquement en ma présence. Il nourrissait en réalité une intime préférence pour les anonymes. Aux architectes des grandes cathédrales il préférait les bâtisseurs de modestes églises. Pour ceux qui, face l'œuvre qu'ils dédiaient à Dieu, invités à la modestie, s'effaçaient devant leur propre cathédrale. Jamais il n'a détesté Ibsen, il pouvait réciter des vers entier de Grieg ou citer un monologue entier de Munch, mais ils n'étaient pas en son propre panthéon. Il les appréciaient parce qu'ils étaient morts, là était l'excuse. L'anonyme n'avait rien à se reprocher, l'œuvre se suffisait à elle-même et au bonheur de son bâtisseur. Quelle idée d'y adjoindre un nom. De cette réalité est née ma vocation, celle de la passion pour l'absence, l'indifférence, l'auteur muet sur l'œuvre achevée dont il ne parlera pas. En ces petites ruelles isolées des contrées d'Haapislmi, j'ai bâtit posé les fondations de ma cathédrale, vouée entièrement à Tanska et ceux dans le plus grand anonymat.
Lorsque les leçons à l'Institut s'arrêtent, je rompt ma comédie. Finit le Panthéon, finit La peste des sœurs Kjær, au revoir Les Tribulations du paysan de l'Empire Xin. Je range néanmoins avec une attention certaine Les Lamentables d'Ibsen. Chaque homme à ses faiblesses. Place à la beauté, place aux anonymes bâtisseurs d'Eglise. Elle se trouve dans les rapports et les notes de l'administration. Bien que certaines ont généralement une attention plus singulière à l'ajout de quelques mots savamment calligraphiés qui font offices de sublimes vitraux, rares sont les hommes et les femmes à reconnaître la beauté d'une belle note de renseignement. A admettre la parfaite suffisance d'une série d'informations rapportée sous l'anonymat le plus complet. Une lettre pour une direction, un nombre pour le bureau. De l'auteur de chaque papier, je ne saurais rien de plus. Si Tanska et son administration ont imposes des formes, des normes et des cadres à ces papiers, chaque bâtisseur y apporte des touches personnelles. J'apprécie particulièrement la fermeté des mots de cet administrateur-analyste - il ne peut qu'être un homme - de la direction C lors de ses descriptions de l'économie locale. Je le reconnait régulièrement, il éprouve une constante antipathie à l'égard des locaux. L'homme n'est sans doute jamais venu en Valinor, il ne manque rien. Il y a aussi cette femme - le soucis du détail me fait penser à une femme - qui, volontairement, reconnait les efforts de nombreuses personnes à apprendre le tanskien. Comme quoi, ce ne sont pas de si mauvaises gens. Enfin, là n'est qu'une minorité : je n'ai encore rencontré aucun Valinoréen qui sait différencier l'église de la Cathédrale. Ils en admirent les formes mais aucun ne sait en faire la louange. Dès lors, il est inutile de leurs faire confesser leurs péchés. Qu'ils restent ignorants de la beauté des choses...
Cependant, ma bibliothèque m'incline à l'indulgence et amènera leur reconnaissance : Les Valinoréens sont des être inférieurs qui ont la chance d'être nos voisins; nous leur donnerons nos lumières.
Posté le : 25 oct. 2024 à 15:57:31
2413
Depuis quelques temps, la police Kartienne avait un suspect dans ses radars: Un dénommé Feldon.
Feldon était un homme d'origine Valinoréenne, il avait demandé la nationalité Kartienne et s'était installé en Karty. Un tel profil avait attiré l'attention du gouvernement Kartien, rares étaient les migrants venant du Valinor demandant la nationalité Kartienne. De plus, cet homme a déclaré à son pays d'origine ne plus vouloir être d'origine Valinoréenne. C'est ainsi que Feldon fut sous les radars Kartiens, néanmoins, il y eut une journée. C'était un jour comme les autres au commissariat de la ville d'Hafen, le policier Fiodor Detchev commença sa journée, il était au bureau des plaintes. Soudain, une femme d'environ la trentaine arriva.
Policier Fiodor Detchev: Que puis-je faire pour vous chère madame ?
Irina Sastöy: Je... suis là pour déposer une plainte...
Fiodor Detchev voyait que quelque chose n'allait pas, la femme avait les yeux rouges (elle avait pleuré) et n'arrivait pas à correctement parler.
Policier Fiodor Detchev: Tout va bien madame, vous êtes en sécurité, comment vous appelez vous ?
Irina Sastöy: Irina, Irina Sastöy...
Policier Fiodor Detchev: bien, que vous est-il arrivé ?
Irina Sastöy: Je viens dénoncer mon voisin, un certain Feldon, il m'a menacé...
Policier Fiodor Detchev: Dans quelle situation ?
Irina Sastöy: Il était dans ma maison, il ne pensait que je n'étais pas là, dès qu'il m'a aperçu il ...
Policier Fiodor Detchev: Vous dites qu'il vous a cambriolé en pensant que vous étiez absente, puis qu'il vous a menacé en vous voyant ?
Irina Sastöy: Oui...
Policier Fiodor Detchev: Avec quel arme vous a t-il menacé ?
Irina Sastöy: Un pistolet...
Policier Fiodor Detchev: Vous a-t-il simplement menacé ?
Irina Sastöy: Non, il m'a assommé en me mettant un coup de crosse de son arme...
Le policier avait remarqué un gros bleu sur le front de son interlocuteur, il savait désormais la source de cette blessure.
Policier Fiodor Detchev: D'accord, comment l'avez vous identifié ? Il n'était pas cagoulé ?
Irina Sastöy: Si, mais quand il m'a menacé, il a d'abord essayé de me frapper, en me débattant, j'ai enlevé sa cagoule et j'ai aperçu son visage, il a cru que je ne l'avais pas vu car il faisait noir...
Policier Fiodor Detchev: Avait-il des gants ?
Irina Sastöy: Je ne crois pas, je n'ai pas vraiment fait attention...
Policier Fiodor Detchev: S'il n'en avait pas, nous retrouvons ses empreintes digitales chez vous ainsi que son arme. Je vais envoyé une patrouille l'arrêtait immédiatement.
Dès la fin du témoignage, le policier Fiodor Detchev prit la tête d'une patrouille de police et alla au domicile du dénommé Feldon. Sa porte fut enfoncée.
Policier Fiodor Detchev: A terre !
Feldon fut surpris, n'ayant pas eu le temps de réagir, il s'exécuta. Il fut emmener en détention dans le centre de police, une plainte pour cambriolage à main armée, agression et intrusion fut posée contre lui.
Feldon était un homme d'origine Valinoréenne, il avait demandé la nationalité Kartienne et s'était installé en Karty. Un tel profil avait attiré l'attention du gouvernement Kartien, rares étaient les migrants venant du Valinor demandant la nationalité Kartienne. De plus, cet homme a déclaré à son pays d'origine ne plus vouloir être d'origine Valinoréenne. C'est ainsi que Feldon fut sous les radars Kartiens, néanmoins, il y eut une journée. C'était un jour comme les autres au commissariat de la ville d'Hafen, le policier Fiodor Detchev commença sa journée, il était au bureau des plaintes. Soudain, une femme d'environ la trentaine arriva.
Policier Fiodor Detchev: Que puis-je faire pour vous chère madame ?
Irina Sastöy: Je... suis là pour déposer une plainte...
Fiodor Detchev voyait que quelque chose n'allait pas, la femme avait les yeux rouges (elle avait pleuré) et n'arrivait pas à correctement parler.
Policier Fiodor Detchev: Tout va bien madame, vous êtes en sécurité, comment vous appelez vous ?
Irina Sastöy: Irina, Irina Sastöy...
Policier Fiodor Detchev: bien, que vous est-il arrivé ?
Irina Sastöy: Je viens dénoncer mon voisin, un certain Feldon, il m'a menacé...
Policier Fiodor Detchev: Dans quelle situation ?
Irina Sastöy: Il était dans ma maison, il ne pensait que je n'étais pas là, dès qu'il m'a aperçu il ...
Policier Fiodor Detchev: Vous dites qu'il vous a cambriolé en pensant que vous étiez absente, puis qu'il vous a menacé en vous voyant ?
Irina Sastöy: Oui...
Policier Fiodor Detchev: Avec quel arme vous a t-il menacé ?
Irina Sastöy: Un pistolet...
Policier Fiodor Detchev: Vous a-t-il simplement menacé ?
Irina Sastöy: Non, il m'a assommé en me mettant un coup de crosse de son arme...
Le policier avait remarqué un gros bleu sur le front de son interlocuteur, il savait désormais la source de cette blessure.
Policier Fiodor Detchev: D'accord, comment l'avez vous identifié ? Il n'était pas cagoulé ?
Irina Sastöy: Si, mais quand il m'a menacé, il a d'abord essayé de me frapper, en me débattant, j'ai enlevé sa cagoule et j'ai aperçu son visage, il a cru que je ne l'avais pas vu car il faisait noir...
Policier Fiodor Detchev: Avait-il des gants ?
Irina Sastöy: Je ne crois pas, je n'ai pas vraiment fait attention...
Policier Fiodor Detchev: S'il n'en avait pas, nous retrouvons ses empreintes digitales chez vous ainsi que son arme. Je vais envoyé une patrouille l'arrêtait immédiatement.
Dès la fin du témoignage, le policier Fiodor Detchev prit la tête d'une patrouille de police et alla au domicile du dénommé Feldon. Sa porte fut enfoncée.
Policier Fiodor Detchev: A terre !
Feldon fut surpris, n'ayant pas eu le temps de réagir, il s'exécuta. Il fut emmener en détention dans le centre de police, une plainte pour cambriolage à main armée, agression et intrusion fut posée contre lui.
Posté le : 04 jan. 2025 à 21:56:01
50213
Page 1
Aux possibilités de la Lettre de Valinor
ou l'analyse d'une philosophie perdue
Version Abrégée
Auteur: Marsile Valéron
Date de Parution: 17 Juin 2015
Catégorie: Philosophie, Argumentation, Commentaire
Lieu de Publication: Académie des Lettres Modernes et Anciennes (ALMA), Ville de Roncevaux
Code d'Identification ALA: UR-77251-XC
Chapitre Premier
De l'Ordre d'une Trouvaille Précieuse ou les antécédents à l'analyse
En me baladant dans les couloirs de l'Alma, on dira ce qu'on voudra des intentions et passe-temps de chacun, rien n'aurait pu attirer mon attention comme cela. Oui, c'est quelque chose que j'écris rarement. Des livres de qualité, il y en a par milliers. Des livres excellents, par centaines. Mais des écrits exceptionnels, hors du commun, sans plus ni moins, eux sont d'une rareté incroyable. Malheureusement, les machineries de l'Alma ne parviennent toujours pas à classer les livres selon leur qualité, on n’en serait pas là. La beauté d'une bibliothèque, c'est qu'il faut débusquer soi-même les conditions de possibilité, soit comment se munir d'un écrit qui convient à nos attentes ou qui les dépasse. Dans ce cas, je suis heureux d'affirmer que mes attentes aient été dépassés. Je ne saurais dire pourquoi, ni comment, mais c'est un ouvrage que je n'ai jamais su avoir eu besoin, et que je chéris désormais. Tellement de profondeur, de sens, de caractère... Quiconque l'ait écrit, que sa plume soit bénie. Il n'arrive que quelques fois dans la vie d'un homme où la raison fait part d'une illumination telle qu'elle envoie sur le papier ce qu'il y a de plus vif, ce qu'il y a de plus admirable. La noblesse d'esprit parue dans cet écrit était absolument remarquable.
Oui, quiconque l'ait écrit. Le petit ouvrage, il ne conviendrait pas de l'appeler livre mais plutôt nouvelle, était écrasé par deux autres bien plus grands. Pas d'auteur, pas de code ALA, pas de genre même. Même pas un titre ! D'aucuns pourront se dire que ne pas titrer un livre résulte en une grande barbarie de la part de l'auteur. Ne pas titrer un ouvrage, c'est ne pas achever sa pensée, ne pas avoir les idées claires et n'avoir aucun esprit de synthèse. Mais à qui devrions nous reprocher le fait que l'ouvrage n'ai pas de titre ? Il n'avait pas plus d'auteur, ni même une information périphérique. Il n'avait pas de code barre, ce qui signifiât qu'il faisait partie des ouvrages qu'on ne pouvait même pas emprunter. Quel mystère, quelle découverte ! Il m'a semblé de trouver une plante au milieu d'un désert aride et chaud. Contrairement à certains qui auraient osé jeter cet ouvrage aux oubliettes, j'ai voulu le prendre sous mon aile pour l'étudier plus en détail. Après tout, personne n'aurait remarqué qu'un si fin ouvrage avait disparu des étagères, et je faisais partie du Salon de toute manière. Personne n'interdira à un homme de sortir ce livre de là où il avait été placé, sinon la raison morale de ne pas s'éterniser sur un ouvrage quelconque. Je suis allé au-delà de cette raison, j'ai pris le livre sans même l'ausculter plus que cela et je suis monté quelques étages pour monter au Salon.
Aujourd'hui, c'était un jour de pluie. Il n'y avait rien à faire dans mon appartement, comme d'habitude. Depuis maintenant trois ans que je fus là, je n'ai jamais évité une occasion de me rendre au Salon. J'ai rencontré des dizaines de personnalités littéraires antariennes qui m'ont appris à apprécier plusieurs types de littérature. De même, j'ai tenté d'apprendre aux autres la beauté de la littérature catacombienne. Je passais mes journées dans les niveaux les plus inférieurs de l'Alma, à la recherche d'ouvrages que personne n'avait jamais encore ouvert, avec des tournures de phrase mystérieuses. Je rêvais à l'idée de trouver des ouvrages perdus et de les remonter à la surface. C'était pour moi une ambition littéraire majeure, et cela l'est toujours. Et ce nouvel arrivage dans ma collection, il était des plus prometteurs. Arrivé au Salon, Palatine était en train de gribouiller quelques schémas comme à son habitude, à planifier visuellement son prochain écrit. Face à la grande fenêtre se tenait Tristan, revenu de son escapade dans les plaines de Laxande, en train de regarder le ciel comme il le faisait bien souvent. Personne d'autre n'était présent, c'était l'occasion parfaite pour m'asseoir à un bureau et commencer l'étude de ce nouvel ouvrage que j'avais débusqué.
Je commençais par regarder la couverture. Le livre était intégralement blanc. Immaculé, presque, si ce n'était pour le fait qu'il était un peu abîmé. Surement les bibliothécaires n'ont pas pensé à faire attention à un ouvrage si petit et si dénué de sens... pour eux. Une seule petite icône était présente, dans un coin au dos du livre. Un œil peut être, un hiéroglyphe. C'était le même que celui qu'arborait le drapeau de Valinor. Au moins, on savait à quel genre de littérature on avait à faire. À présent, comme l'analyse superficielle était manifestement achevée, il était temps d'en lire les pages. Très peu de pages, certes. Mais je sentais qu’elles cacheraient un plaisir des plus vivaces à le lire. Après une esquisse rapide de ces quelques feuillets, l'ouvrage était vraisemblablement divisé en quatre lettres. Il était temps de les lire et de s'en faire une idée. Peut-être que je me trompais, il s'agissait peut-être d'un roman pseudo-philosophique qu'avait écrit un homme âgé sur son lit de mort. Ou peut-être que j'avais trouvé un vrai trésor de la littérature moderne (je ne puis savoir si l'ouvrage était réellement moderne à l'instant, mais au vu de ma lecture il en semblait ainsi). Quoi qu'il en soit, il était bien trop mystérieux pour être seulement médiocre.
Chapitre Deux
Au plaisir d'en lire son entièreté ou l'aperçu de l'ouvrage
J'avais commencé ma lecture à neuf heures vingt-six du matin. J'ai enfin fermé le livre vers vingt-et-une heures trente-trois. Ma tête me faisait mal, j'avais pris des centaines de notes sur des feuilles à côté du bureau. Je ne voulais pas prendre de comprimés, il fallait que l'histoire se dilue par elle-même sans en être annihilée par les médicaments. Et quelle histoire ! J'ai posé le livre, enfin, après des dizaines d'heures de lecture. Je l'ai lu, relu, appris des tournures de phrase par cœur, noté assez d'observations pour réécrire le livre au moins vingt fois... Quelle aventure. Une fois que mes mains se décidèrent à enfin lâcher ce livre, je me suis appuyé sur le dossier de mon fauteuil j'ai lâché malgré moi une petite injure. Où m'avait apporté cet ouvrage ? Où étais-je ? Qu'avais-je donc fait pendant tout ce temps ?
J'essayais de fermer les yeux pour rassembler mes idées. C'est ainsi que je sentis une main se poser sur mon épaule. À ce moment-là, je fus tellement pris par surprise que mon sursaut fut assez puissant pour me chasser de mon fauteuil et me redresser debout. Je n'en revenais pas, j'étais si crispé que cette simple main m'a mis dans un état d'alerte presque burlesque. Cette main, c'était celle de Palatine qui avait elle aussi fini sa journée. Inquiétée de mon état, elle me posa des questions par rapport à ce que je venais de lire. C'était le membre du Salon que j'appréciait le plus car elle comprenait mon attachement pour la littérature perdue comme celle-ci. Il m'était assez simple de me fier à elle et de lui raconter mes trouvailles. Et pourtant cette fois-ci, elle me regardait d'un air inquiet. On était soudés entre intellectuels du Salon, mais les aventures que nous vivions individuellement laissaient parfois à désirer. Palatine m'avait réveillé au milieu de ma transe valinoréenne, après la lecture d'un ouvrage si intense. Il était normal de se faire du souci, je n'avais pas bougé de ma position de toute la journée.
Nous nous assîmes tous deux dans des fauteuils en face de la grande fenêtre. Tristan était déjà parti depuis un bon moment, il ne restait que nous deux. Peut-être allions nous dormir ici ce soir ? Les couchettes étaient disponibles, nous n'aurions pas à nous faire du souci. En tout cas, je ne me faisais pas de soucis pour ma part. Palatine en revanche avait l'air pressée de rejoindre son domicile. Elle prenait quand même le risque de s'assoir à mes côtés et de me demander sur quoi j'avais travaillé toute la journée, un risque considérable sachant qu'il était bientôt onze heures et au vu de ce que j'avais témoigné en ouvrant ce livre, nous étions sur de bons fondements pour faire nuit blanche. Par où commencer ? Le livre n'avait ni de début ni de fin, pas en termes de discours, mais plutôt en termes de compréhension. Il faut avoir lu la fin pour comprendre le début, et ce sont ce genre d'ouvrages qui sont les plus durs à expliquer. Mais Palatine était patiente. Son visage perdu entre ses longs cheveux noirs, à siroter une tasse de thé, elle avait l'air attentive. Si elle le voulait, alors j'allais lui expliquer.
L'ouvrage, encore une fois, je ne saurais le réitérer moins que cela, était d'une beauté spectaculaire. Les mots étaient agencés avec une prouesse somptueuse et les figures de styles étaient présentes par milliers. C'est réellement un livre que n'importe quel amateur de littérature devrait lire pour s'en inspirer. L'histoire, bien qu'elle soit extrêmement floue, traite de quatre lettres. Ces quatre lettres ont été écrites supposément par un scientifique, un scientifique qui perd la raison au fil des lettres. Il est à la recherche de ce qu'il appelle l'équation universelle, pour quantifier le monde. C'est quelque chose d'osé, de grand, peut-être d'irréalisable. Mais il le dit avec tellement de ferveur qu'on en vient à se demander si elle existe réellement. Lettre après lettre, mot après mot, on a l'impression qu'il se rapproche sans relâche de son but. Et en même temps, sa raison commence à flétrir. Il en perd complètement ses repères, on ne le reconnait plus. Et au final, il se reconvertit dans une autre idée, que le monde est pluriel, et que chaque pluralité contient encore plus de pluralités. Ce n'est pas très clair dit comme cela, je vous l'accorde. Il m'a moi même fallu l'expliquer plusieurs fois à Palatine pour qu'elle comprenne. C'était réellement un texte obscur, mais c'est justement dans cette obscurité que réside son charme. Elle voulait bien y croire et fournissait visiblement des efforts. Lorsque ma courte description fut achevée, il était minuit passée. Nous devions nous rendre à l'évidence, nous allions passer la nuit ici.
Ce n'était pas la première fois que je restais au Salon plus de vingt-quatre heures. Je l'ai déjà fait en rédigeant les plus longs de mes ouvrages. Quant à Palatine, elle fréquentait les lieux si souvent que plusieurs doutaient du fait qu'elle possède vraiment un appartement. Ou peut-être que si, mais il ne lui servait à rien. L'Alma était pourtant si accueillante, il est absolument justifié de penser que passer ses jours ici serait la meilleure chose à faire. Mais revenons-en à l'ouvrage, ne nous égarons pas. J'avais décidé par ma liberté en tant qu'explorateur de ce récit de le nommer « Lettre de Valinor » par ses origines et le fait qu'elle soit constitué de lettres. Il ne fallait pas donner un nom pompeux à quelque chose d'aussi mystérieux. Au contraire, il faut préserver dans mon avis le mysticisme et le mystère qui plane sur cet ouvrage. Il est fort intéressant grâce au fait qu'il est mystérieux. Un titre aussi mystérieux que Lettre de Valinor ne pouvait qu'accentuer cela. Ainsi, posés sur nos couchettes, il nous fallait un argument pour trouver sommeil. Nous avions parlé de cette lettre pendant presque deux heures maintenant, et Palatine comprenait mieux sa disposition. Jusqu'au moment où elle dit, d'un ton fort et clair: « Ce roman est quand même assez fascinant ». J'ai trouvé cela très bon de sa part, et j'en était fier malgré le fait qu'il ne m'appartenait pas. Mais j'ai tiqué sur le mot roman. Je lui ai donc dit d'une voix douce qu'il s'agissait clairement d'un ouvrage philosophique. Et là, nous sommes tombés sur un désaccord.
Palatine pensait fermement qu'une histoire aussi garnie que celle-ci (elle l'avait lue entre temps, après cent explications de ma part) se devait d'être de la littérature. Les tournures de phrase, le fait que l'homme perd doucement sa raison... C'est évidemment du roman. Moi au contraire, j'avais passé la journée dessus. Le texte présentait une philosophie très importante sur le thème de l'Unité et de la Science. Une philosophie qu'on ne peut que déceler en s'y plongeant complètement. Il est compréhensible que Palatine, à travers quelques lectures seulement, peine à voir ce côté enrichissant de l'histoire. Mais elle résistait. Ce livre était de la grande littérature, et la philosophie n'est qu'une surinterprétation. Il ne fallait pas se faire d'idées.
Même si nous nous préparions à nous endormir, nous nous sommes levés pour prendre place dans des fauteuils face à face dans la grande chambre du Salon. Nous étions décidés à faire valoir nos arguments, même si cela allait prendre toute la nuit. Ainsi, notre débat pouvait commencer. S'agissait-il de littérature ou de Philosophie ?
Chapitre Trois
De la dualité de l'ouvrage ou le Débat avec Palatine de Rigault
Le présent chapitre n'est pas disponible dans la version abrégée.
Chapitre Quatre
De l'issue littéraire du présent ouvrage ou l'objet périphérique à nos recherches
Le débat avec Palatine de Rigault s'est donc achevé aux aurores, vers cinq heures et demie du matin. Nous nous sommes tout de même couchés pour bonne mesure, il fallait avoir l'esprit frais. Durant mes dernières discussions avec elle, j'ai décidé de prendre ses notes sur l'ouvrage et issues de notre débat et je lui ai promis que j'en ferais une analyse littéraire poussée. Cependant, je n'ai pas abandonné mon drapeau pour autant. L'ouvrage est peut-être purement littéraire. Mais la philosophie qu'il soulève est bien trop intéressante pour être ignorée. Peut-être serait-ce accidentel, ou bien une métaphore. Quoi qu'il en soit, la partie importante de mon écrit cherchera à développer cette philosophie dans son entièreté, en utilisant la lettre comme rampe pour propulser mes arguments. Mais n'allons pas vite en besogne. Il nous faut réfléchir d'abord à comment aborder le texte dans sa forme entendue, c'est à dire purement littéraire.
Lorsque je me suis réveillé vers onze heures du matin le jour suivant, Palatine était déjà partie je ne sais où. Probablement à la messe, c'était dimanche. Pour ma part, j'y vais le plus souvent le soir, pour clôturer la semaine. Mais à chacun ses préférences. Cela m'a permis d'avoir le salon entièrement vide et à ma disposition au moins pour quelques heures. Mon bureau était toujours dans le même cafouillis que je l'avais laissé la veille, la grande fenêtre me piquait les yeux (signe que je n'avais pas bien dormi, mais peu importe) et les fauteuils de notre débat étaient désordonnés. Je me souviens qu'à un moment, nous nous étions levés et le débat s'était presque enflammé. Cela a dû les pousser de partes et d'autres. Mais que faisons-nous ? Il n'est pas temps de vous conter mon histoire. Il y a une autre histoire fort intéressante qui mérite notre attention bien plus en détail. Plongeons-nous ainsi dans l'analyse littéraire de la Lettre de Valinor, on ouvrage absolument remarquable qui a conquis mon cœur.
Le plus grand et le plus intéressant des sujets est sans doute le personnage principal qui perd la raison. En effet, lorsqu'on lit, on s'aperçoit au fil du texte que ses phrases simples au début deviennent puis confuses, saccadés, dans un rythme cassé et précipité. Dès lors, cela nous fait comprendre l'importance que nous devons attacher à ce personnage, son rôle clé dans l'établissement d'une finalité frappante et le point de pivot qui servira à retourner la conscience du lecteur en confirmant ce qu'il rejetait depuis le début. Le fait que le scientifique se perde dans ses explications, qu'il en vient à perdre la raison, cela est fort intéressant et témoigne d'une construction très bien établie. En effet, le scientifique « normal » si nous pouvons l'appeler comme cela est d'habitude porteur de raison. C'est lui qui effectue des tentatives, expériences, qui confirme ce que nous savons ou bien vient le compléter. Si l'on remonte à l'époque, aux débuts de la philosophie antarienne, nous savons que la méthode scientifique a pris son envol vers le XVIIème siècle, voire au XVIème. Depuis ce jour, ou plutôt cette période, nous vivons dans un paradigme où le scientifique suit une méthode ordonnée pour parvenir à ses résultats, des résultats fiables qui prouvent la véracité des faits. Nulle confiance ne peut être faite aux écrits non validés, et c'est ainsi que la bible et l'évangile furent pris pour cible. Mais ne divaguons pas. Le scientifique est celui ou celle qui est censé donner raison. Dans un débat, des discussions, c'est lui qui apporte les preuves au service d'une partie ou de l'autre. Lui ne discute pas, il fournit. Le scientifique est celui de qui on attend les réponses concrètes, et à partir de celles-ci des décisions peuvent être prises. Dans la Lettre de Valinor, le scientifique est bien dépassé par tout cela. Il nous fait croire qu'il adhère à ces standards en effet, on peut le voir alors qu'il réitère savoir une équation universelle ou du moins être au bord de la posséder. Il prétend posséder le savoir, mais sans nous donner plus d'informations. Tenez, c'est la même chose qu'on reprochait à la bible autrefois ! Un texte flou, mais la chose est certaine. Dites-moi si ce n'est pas de l'hypocrisie ! Oui en effet, notre personnage est tout sauf scientifique. Dans son basculement, nous nous rendons compte qu'il vire au mysticisme au fur et à mesure que le texte évolue. L'évolution même du personnage représente cela. Le rythme déliquescent de ses phrases montre ainsi la progression, d'un modèle paradigmatique du scientifique à la réalité des faits où le scientifique n'est plus.
Cela me permet de transitionner vers le deuxième point, tout aussi important. C'est bien sûr le choc entre raison et mysticisme. En effet, les deux se chevauchent à merveille. D'une part, le texte est plein de terminologies scientifiques et techniques, nous pourrions facilement croire qu'il sait ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Or, la fin nous en apprend plus. Il ne donne point d'informations. Parle avec un langage flou. Nous parle de termes abstraits comme l'Unité ou la pluralité. Tout porte à croire qu'il ne s'agit pas d'une revue scientifique mais une espèce de prospectus religieux d'une certaine secte basée sur une pseudo-science. Oui, le scientifique représente la pseudo-science, et le moyen dont cela est représenté rend les passages légendaires. Il existe certes ce choc entre superficiel et discours, entre les mots choisis et comment ils sont mis entre eux. Une disposition que je trouve absolument fascinante: Les mots seuls montrent que l'homme est clairement un scientifique qualifié. Mais quand ils sont arrangés de cette manière, il s'agit plutôt d’une espèce de moine ou d'adepte à une église ou secte curieuse. N'exagérons rien non plus. Mais réellement, cela illustre la richesse et la beauté du texte. Il n'a jamais été fait meilleur que cela en terme d'agencement: utiliser les dimensions pour combiner deux terrains radicalement différents, une autre embuscade littéraire qui piège les lecteurs superficiels et laisse passer ceux qui s'y intéressent plus en détail. De plus, toujours dans le même registre et par la même technique, on observe une deuxième juxtaposition entre cette fois ci l'ordonnance et le dérèglement. La confusion et la linéarité. Ce sont deux valeurs qui sont encore une fois lourdement confrontés à travers le texte. Oui, d'une part cela nous semble ordonné. Les mots sont visiblement choisis, l'homme est expert dans son domaine et le champ lexical témoigne d'une vraie structure. Mais dès qu'on regarde la périphérie, qu'on compare et qu'on se rende compte de la syntaxe, le désordre arrive sous nos yeux. Oui, c'est ce qu'on appellerait un « bordel organisé » dans le jargon populaire, pardonnez mon expression puissante. Mais il est nécessaire de visualiser telle chose. Les oppositions comme celles-ci œuvrés sur plusieurs dimensions du texte en même temps témoignent d'un savoir-faire incroyable. Et c'est ainsi un autre point littéraire de ce texte qui doit être absolument mentionné.
Enfin, une autre prouesse de ce récit réside sans aucun doute dans sa force de nous communiquer le malaise. N’importe qui en lisant l'ouvrage sentira une certaine forme de malaise. Et pourtant, lorsqu'on lit, on se rend compte que le scientifique essaye d'être le plus certain de lui-même possible. Il continue à essayer de nous convaincre et surtout de convaincre à lui-même que cette équation existe bel et bien. Non seulement le fait de forcer cette information pour que nous l'intériorisions dans notre esprit, cela ne peut que nous faire penser l'inverse. Le scientifique n'est visiblement pas si sûr de lui même ou il n'aurait nul besoin de se justifier à maintes reprises. Pire encore, nous avons l'impression qu'il se ment à soi-même. Et c'est là où l'ouvrage devient des plus intéressants. Le scientifique ne nous parle pas à nous, il se parle à soi-même. Il cherche à se convaincre soi-même de cette folie absurde, il sait que personne n'y croira et c'est une partie perdue d'avance. Pourquoi donc chercher à nous convaincre ? Si cela avait été son but, il aurait été plus charismatique et aurait avancé de meilleurs arguments. Non, il ne cherchait pas à faire cela. Il se cherchait lui-même, il voulait se mentir, il voulait penser différemment. De notre point de vue externe, une seule sensation peut être retenue lorsque nous voyons quelqu'un se faire du mal de cette manière: le malaise. Oui, c'est ce malaise en effet que nous sentons, peut-être une empathie certaine pour le scientifique. Il hésite de plus en plus, et dès qu'il arrive enfin à en être convaincu il comprends la vraie nature du sujet: l'équation n'existe tout simplement pas. Cette idée de malaise rejoint celle des oppositions mis en place dans le récit, ainsi que son rythme cassé qui laisse clairement entendre une sorte de bégaiement. Cette attitude est bien assez pour pouvoir mettre chaque homme normal dans cet état de malaise vis à vis de ce qui est lu. Vraiment, cet ouvrage est des plus intéressants. Palatine avait peut-être raison tout compte fait. Celui-ci était vraiment d'une beauté littéraire qui ne pouvait être accidentelle, et cette idée du scientifique malaisant ne fait qu'embellir un bouquet déjà bien garni.
Il y a bien d'autres analyses, plus fines et plus poussés encore. Nous pourrions peut-être parler des métaphores employées, voire la ponctuation. Mais ces trois thèmes sont dans mon avis les plus importants. Je laisserais à Palatine la chance de s'exprimer à propos de cela, toujours si elle le souhait bien évidemment.
Chapitre Cinq
D'une connexion reliant sens à interprétation ou la transformation philosophique et progressive de l'ouvrage
Si j'ai passé peu de temps sur l'analyse littéraire (peu de temps, tout est relatif), ce n'est pas pour faire une mauvaise blague à Palatine. Vous n'avez pas l'air de comprendre les enjeux qui se cachent derrière texte. Il me faut donc connecter les analyses et relevés littéraires avec des débuts d'idées philosophiques pour que s'en suive une extension bien plus pertinente et détaillée de la philosophie que j'ai extraite de cet ouvrage. Qu'il vous soit bon ou non, je suis conscient que le texte n'est pas principalement de la philosophie ou n'a pas vocation d'être (j'ai d'ailleurs perdu le débat contre Palatine, mais elle ne m'a convaincu qu'à moitié). Cependant, il me faut aller au bout des premières idées discutées dans le texte. Ce serait comme laisser un édifice inachevé. Certes, le côté littéraire est absolument poignant. Mais ce que réussit à aborder le texte se doit d'être continué et étendue. À partir de là, nous pourrons divaguer enfin vers de nouveaux horizons de notre raison.
Débutons ainsi ces connexions en nous penchant sur justement la signification philosophique de la perte de raison du personnage. Nous avons établi ensemble le fait qu'un scientifique se doit d'être raisonnable pour parvenir à son travail de scientifique. Or, l'homme fait tout l'inverse à mesure que l'histoire se produise. Il néglige sa raison au profit de son scientisme, de son mysticisme et de la croyance pure. Ce n'est certainement pas quelque chose de recommandable, encore moins si l'on écrit des lettres pour en parler. À la Fantassine ceux et celles qui écrivent pour n'arriver à rien ! Si l'on commence sur une lignée, il faut la terminer. Ce n'est pas un bon exemple que de penser à cela par rapport à cet ouvrage dans cette même optique. La raison semble donc le premier chapitre à aborder, celui qui connectera notre raisonnement philosophique à cette écriture. La raison, déjà. Comment peut-on parler de la raison sans la définir. Dans ma vision et dans celle de Pétra (Je l'ai consultée rapidement alors qu'elle regardait au-dessus de mon épaule pour savoir ce que je faisais), la raison se divise principalement en deux grandes catégories: La raison morale et la raison logique. La raison morale est notre fil directeur imprégné de la société, c'est celle qui nous fait obéir aux mœurs et normes sociétales. C'est celle souvent qui nous induit en erreur quand placés dans un territoire inconnu, comme dans un pays étranger. Nous voulons appliquer la raison morale que nous avons appris depuis jeune âge, mais il s'avère peut-être que les habitants du pays que vous visitez ont une conception différente de cette raison morale. Dans cet ouvrage, il n'est pas question de voyage, certes. Mais ces nuances de raison morales vont nous revenir en aide plus tard. D'un autre côté, la raison logique est plus universelle et plus généralisée. C'est, comme son nom l'indique, l'application de principes logiques dans son raisonnement. Que ce soient des mathématiques, comme en additionnant un plus un qui serait égal à deux selon cette raison logique, ou quand nous approchons un sujet en employant des déductions, inductions et syllogismes pour parvenir à des conclusions ou théorèmes applicables à tous. C'est celle-ci qui va nous intéresser le plus. En effet, quand on décrit l'individu comme "perdant la raison", il s'agirait surtout en mon avis de la raison logique. Nous-mêmes pouvons reconnaître qu'une équation universelle semble une théorie des plus farfelues. Comment serait-il même envisageable de quantifier l'univers dans son entièreté par une simple équation ? Si l'on traduit cela en jargon plus compréhensible, trouver une équation universelle signifierait trouver potentiellement une réponse à tout. Les plus optimistes d'entre nous penseront certes qu'il existe bel et bien une solution à tout, et je ne le renie pas. Mais mettre toutes ces solutions sous forme d'équation, c'est bien plus complexe. Qu'elle existe (la solution) ne veut pas dire qu'on la connaît, après tout. Ainsi, partir déjà du principe que ce genre d'équation puisse exister va déjà à l'encontre de notre raison logique d'une certaine manière. Qui plus est, au fil de la lettre, la logique de son discours se détériore au fur et à mesure, la syntaxe devient obscure et il est plus complexe de distinguer les faits et arguments qu'il porte. Cette confusion n'est pas digne d'une raison logique poussée, autre connexion entre ce qui est constatable textuellement et la philosophie de la raison qu'on peut en ressortir. Cependant, comme je l'ai dit, la raison morale n'est pas à négliger. En voyant ce scientifique perdre la raison logique, nous pouvons nous demander s’il est même moralement acceptable de perdre cette raison logique. Si nous nous baladons dans la rue en prétendant qu’un et un égalent trois, n'allons-nous pas à l'encontre de l'opinion publique ? Et si nous prétendons qu'une équation universelle existe ? Cela ne reviendrait-il pas au même ? D'autant plus que la folie dans laquelle il s'embarque, surtout à parler de mysticisme, cela n'est guère un comportement conforme aux normes sociétales que nous avons... si l'on suppose qu'il en fait partie. Bien oui, là rentre en jeu cette nuance. Il est possible de sauver le côté moral de sa raison, ou du moins justifier son comportement en supposant que les mœurs de là où il provient acceptent cette tenue. Peut-être que la recherche d'une équation universelle est quelque chose de valorisé dans ladite société. Qui sommes-nous pour juger de la qualité de la culture d'autrui, après tout ? Donc, laissons le doute planer sur ce qui est de la raison morale. Cela nous servira d'antithèse plus tard pour prouver qu'il y a des limites à notre thèse d'une perte de raison et que celle-ci ne concerne que la partie logique. Quoi qu'il en soit, nous avons déjà trouvé un lien entre la partie textuelle et la réflexion philosophique que nous pouvons en faire.
Venons en maintenant à un deuxième lien que nous pouvons établir. Celui-ci sera peut-être un peu plus court mais tout aussi notable. En effet, le scientifique transitionne au fur et à mesure de son discours vers un état secondaire, un état de mysticisme. C’est certainement fascinant, surtout après qu’il avait essayé de nous convaincre qu’il était un scientifique raisonnable ! Bien sûr, il est dur de le croire, là est toute l’ironie. Mais bien d’autres choses auraient pu remplacer cette tournure. Il aurait pu être corrompu, il aurait pu cacher sa honte de ne pas avoir réussi à parvenir à son but comme il nous l’avait tant promis. Non, il fait tout autre choix, celui de perdurer dans son idée et de la retourner sous forme mystique. Sans garanties, n’ayant que des croyances et des illusions à disposition, il décide de les suivre. À ce moment-là, les idées étaient encore dures à organiser pour moi. Devait-on enchaîner sur une discussion sur la question religieuse ? Il ne s’agissait cependant pas de religion ici. Bien au contraire, on frôlait le sectarisme. Mais après tout, rappelons-nous ce que nous avons établi dans le paragraphe antécédent. Nous ne sommes pas placés correctement pour juger des mœurs et coutumes, surtout des siennes. Parvenons ainsi à rejeter l’idée de pouvoir dicter ou juger d’une personne delà notre raison morale. Et si nous ne pouvons user de notre raison morale, la question religieuse devient de plus en plus abstraite. Oui, nous ne pouvons parler de religion ici, car celle-ci se voit enchaînée au principe de raison morale que nous avons explicitement omis dans notre discours pour éviter de prendre de mauvaises routes dans nos pensées. Tout de même, il nous faut converser d’un autre sujet. Sachons-le, il en faut pour qu’un scientifique bascule vers le scientisme et ce mysticisme aberrant. Et pourtant, cela n’a tout de même pas l’air de nous surprendre pour autant. Réfléchissons, cet homme est parti dans ses discussion dans l’unique but de trouver des réponses. En effet, on avait dit auparavant qu’on pouvait traduire une recherche de l’équation universelle par une recherche de réponse universelle. Que fait donc un homme lorsqu’il n’a pas de réponse ? Il se tourne vers la religion, bien évidemment. Nos ancêtres bien avant le catholicisme pensaient que les événements naturels comme la pluie ou le vent étaient l’œuvre d’une entité suprême de part du fait de leur manque de connaissances sur la situation. C’est justement la science qui est venue apporter les réponses dont nous avions besoin. Et c’est ce qui est matérialisé dans cette histoire. En effet, le scientifique représente la science, un homme qui cherche à savoir et à expliquer le monde. Or, dans son périple, il arrive à un stade où il n’a plus d’appui. Il n’a aucune preuve, aucune rationalité ou raison logique qui le supporte. Dans cette position, en haut d’une tour instable, deux choix s’offrent à lui: tomber à terre et mourir, donc abandonner son idée et se reconnaitre vaincu dans la plus grande des hontes ou bien s’envoler plus haut, grâce à rien, seulement par le pouvoir de la croyance. Il ne faut pas trop réfléchir pour comprendre le choix qu’a fait notre ami (je l’appelle comme cela à notre stade, l’appeler « scientifique » serait redondant et nous voulons construire un rapport spécial avec cet ouvrage et son protagoniste). Ce qui est extrêmement intéressant, c’est que par ce choix il abandonne une des parties qui font de lui ce qu’il est, c’est-à-dire un scientifique, en décidant de poursuivre la recherche coûte que coute pour avoir une réponse, mais la contrepartie étant qu’il doit se corrompre et se livrer à la croyance. Il parvient ainsi à trouver une réponse, mais c’est une réponse non tangible. À tout exemple pour mes lecteurs mathématiciens, cela ressemble aux nombres complexes. Certaines équations ne peuvent pas être résolues si l’on reste dans le monde réel. Mais en imaginant de nouveaux principes et en sortant de la réalité tangible, on peut utiliser le nombre complexe pour pouvoir trouver une solution à cette équation. Nous avons donc sacrifié un de nos objectifs pour avoir l’autre : nous avons eu une réponse, mais à quel prix ? Cette réponse est tout aussi non-tangible que les outils utilisés pour y parvenir. Pour résumer, le scientifique a deux objectifs : Obtenir une réponse et l’obtenir grâce à des preuves et appuis concrets. C’est comme diviser l’addition un plus un par trois. Si nous voulons que cette division soit égale à un, alors un plus un doit être égal à trois. Nous avons une solution, mais elle est absurde. Nous avons donc échoué à respecter les deux principes fondateurs de la science. Et notre cher ami (Oui, il a été promu au rang de cher ami désormais) travaille dans cet esprit-là. Il décide de se corrompre à moitié pour obtenir une solution. Il a un pied dans la science et l’autre dans la croyance. Il a une réponse, mais elle est trop abstraite. Ainsi, grâce à cette question du mysticisme, nous pouvons connecter ce texte aux thèmes de la science et de la croyance, deux sujets qui vont enrichir notre thèse et notre philosophie.
Concluons ce chapitre long mais nécessaire qui nous permet de passer au rayon philosophique de mon ouvrage. Le dernier point que je souhaiterais aborder que nous n’avons toujours pas couvert dans notre résumé littéraire mais qui est d’une importance capitale est le principe d’Unité et de Vérité. Ces deux thématiques sont probablement les plus importantes pour comprendre la finalité du récit, et c’est sur celles-ci que va s’appuyer majoritairement ma philosophie qui en débouchera. Mais pour ce faire, nous devons y établir une connexion au texte. En effet, le scientifique parle beaucoup d’unité, ce qui est normal me diriez-vous, il cherche tout de même à trouver une équation universelle. Si l’on voit le terme d’unicité comme d’un seul et même conglomérat, d’une seule particule, alors je voudrais bien vous donner raison. J’aurais moi-même pensé comme cela, que rassembler l’univers en une équation nous donne parfaitement cette idée d’unicité. Mais Pétra, qui est revenue faire un tour derrière mon dos, m’a tout de même illuminé sur une définition de l’unicité que je n’avais pas pris en compte. En effet, par unicité on peut tout aussi bien entendre le fait que quelque chose soit unique, qu’il se démarque du reste. On voit donc deux tranchants de la lame de l’unicité, celle quantitative qui décrit cela comme le rassemblement de tout en une seule et même unité de mesure, et celle qualitative où l’un est unique car il est différent du reste. C’est sur cette définition que j’aimerais me concentrer. Si l’on parle d’unicité de façon qualitative, on suppose qu’il existe d’autres unicités aussi. En effet, au nom de quoi disons nous que quelque chose est unique ? Ironiquement, je ne cesse de clamer le fait que cet ouvrage est l’un des plus uniques que je n’ai jamais lu. Mais si je peux le dire ainsi, c’est car j’ai pu en lire d’autres et en juger par expérience passée. L’Unique qualitatif est donc un jugement, une comparaison. Si le scientifique qualifie cette équation d’unique, c’est qu’il existe bien d’autres équations pour qu’il puisse affirmer son unicité. Ainsi, on se perd en confusion. L’équation unique est elle vraiment unique si elle est unique ? Nous avons ainsi trouvé une antithèse supplémentaire dans le discours de notre ami, une antithèse qui nous servira plus tard lors de notre développement philosophique. Mais avant cela, terminons sur notre thèse au sujet de l’unité. Oui, car il nous faut encore aborder le sujet de l’unité quantitative. Là encore, il nous est possible de trouver des connexions intéressantes entre une philosophie profonde et la nature littéraire du texte. Le scientifique suppose qu’il existe l’Unique en faisant référence à l’équation universelle, car par principe si une équation universelle existe elle est unique. Nous reviendrons plus tard sur cette théorie en parlant de l’emboîtement, soit comment l’infinité peut se contenir en elle-même, mais à cet instant comprendre cette nuance nous reviendra utile. Si le scientifique est convaincu qu’il existe une unique solution à tout problème, qu’il existe l’unique, alors c’est que l’équation n’est logiquement pas plurielle. C’est simpliste me diriez-vous, mais on bascule progressivement vers une autre contradiction. Car l’équation universelle contient tout, donc elle contient aussi des aspects pluriels. Le but entier de l’opération du scientifique est de condenser cette pluralité en unique. Mais elle ne disparait tout de même pas, le pluriel est toujours bel et bien dilué dans l’Unique ! On en vient donc à la conclusion que l’Unique est Pluriel, ce qui est vrai par deux définitions : Il existe plusieurs uniques et l’unique universel et composé de pluriels. Mais si nous avions dit que l’Unique n’est pas pluriel, comment pouvons-nous conclure que l’unique est pluriel ? L’unique est et n’est pas pluriel en même temps ? Non, nous venons de faire un raisonnement par l’absurde, et la conclusion de celle-ci est que la supposition de départ existe. Cette supposition était que l’Unique existe. Nous avons donc montré que dans les faits, il ne peut pas exister, et le seul moyen d’en parvenir est via la croyance et l’espoir qu’elle puisse exister comme mentionné précédemment.
Ces trois connexions pourront ainsi, je l’espère, vous donner un avant-goût des dissertations philosophiques que nous étudieront durant les pages à suivre. Passons à présent sans plus attendre en une brève analyse linéaire philosophique de la Lettre de Valinor, ainsi que pour nous soyons sur les mêmes repères lorsque nous philosopherons par la suite.
Chapitre Six
D’un aperçu d’ensemble sur la Lettre ou l’analyse philosophique brève exécutée de façon linéaire
Ce chapitre sera sans aucun doute le plus important à ceux qui cherchent à lire mon ouvrage rapidement et n’ont pas le temps que je leur parle de sottises philosophiques. Que Dieu vous garde, vous aurez la chance un autre jour de le lire dans son entièreté si vous ne l’avez pas à l’instant. Ainsi, faisons de ce chapitre l’un des plus brefs. Commençons dès à présent l’analyse linéaire.
L’ouvrage se compose en quatre lettres distinctes. Intéressons-nous donc à la première. Cette note décrit avant tout un aspect intéressant toujours pas exploré dans mon discours jusqu’à présent, soit une élimination de la « variance ». Ce terme a plusieurs définitions qui peuvent toutes nous amener dans différents chemins. Ainsi, il peut être interprété comme tout d’abord la variance statistique, autrement dit, le risque. En statistiques, elle représente le carré de l’espérance, c’est-à-dire l’espoir de succès. La variance mesure si pour arriver à cette espérance il y aura beaucoup de fluctuations (comme dans un jeu où il est possible de gagner beaucoup mais perdre beaucoup aussi). Cela est cohérent avec le raisonnement de quantification de l'univers qu’entreprend le scientifique, éliminer les risques voudrait dire pouvoir tout prévoir, et ainsi avoir une mesure de l'univers. Par la destruction du risque, il est possible d'atteindre une vérité mathématique universelle. Mais cette définition pose problème: si atteindre une équation universelle signifie supprimer cette variance, ou autrement dit d’avoir une variance égale à zéro, cela entend que il n’y a ni chance de gagner ni de perdre si l’on reprend l’explication statistique. Pire encore, si la variance est l’espérance au carré, et que la variance vaut zéro, alors l’espérance aussi vaut zéro. Et l’espérance n’est nulle autre que la moyenne de toutes les possibilités. Dans ce cas, nous nous retrouvons en une fourchette. Soit cela entend qu’il n’y a donc aucune possibilité et que l’espérance fasse donc zéro, soit l’expérience admet en effet des possibilités mais elles sont toutes nulles. Dans le premier cas, s’il n’existe aucune possibilité alors l’expérience ne peut tout simplement pas exister. Et si elle n’existe pas, cela veut dire que l’équation universelle non plus. Dans le deuxième, si toutes les possibilités sont nulles alors on retrouve le problème identifié dans le précédent chapitre. L’unique ne peut pas être composé de plusieurs possibilités et être unique en même temps, d’où une contradiction. Selon cette définition, l’Unique est donc inatteignable, mais le scientifique ne s’en rend pas compte à l’instant. Je devrais demander à des amies mathématiciennes d’une grande renommée, elles pourront certainement élargir mes connaissances sur la variance statistiques qui sont pour le moins assez limités à l’instant. Cependant, nous avons toujours une autre définition à explorer. En effet, la variance peut aussi être interprétée comme une pluralité d'interprétations. Dans cette situation, nous nous mettons nous-mêmes en position d’échec et mat, dans un cul de sac philosophique et logique. Puisque la variance elle-même est variante, il y a une infinité de variances et donc forcément des aspects complètement uniques. La variance est variante, donc on ne peut pas partir de son principe pour trouver l’unique. C’est les débuts de la théorie de l’emboitement formulée plus tard, d’autant plus que cette variance variante va plus tard rejoindre la conclusion du scientifique lorsqu'il parle de l'Unique dans sa dernière lettre. Pardonnez si je divulgâche, mais c’est assez compliqué déjà de pouvoir vous fournir un résumé philosophique comme celui-ci sans faire d’allusions.
Passons ainsi à la deuxième note de notre ami, qui est dans les faits plus obscure. Les raisonnements qu’il utilise pour nous convaincre de l’existence de cet unique me sont assez familiers, car j’en suis un fier utilisateur. Il s’agit là de raisonnements par emboîtement si vous n’aviez toujours pas deviné. Le principe est des plus simples: On suppose d'abord qu'on peut transformer l'existence finie en chiffres par nature infinis, le principe dont part notre ami. S’il peut passer du premier stade ou échelon à la quantification, c'est grâce à la mesure de l’univers. Or, par domaines de définition, toute chose finie est obligatoirement contenue dans l'infini. Donc, il est possible de contenir toute l'existence qui est finie dans une suite de chiffres. Des théories ont notamment été émises sur le chiffre pi, le plus célèbre de ces suites infinies. D’après certains mathématiciens réputés, toute notre vie et celle de l’univers sous forme de film sont contenues dans pi sous forme de binaire (je crois, je ne connais pas très bien ces faits-là, je suis bien loin d’être mathématicien moi-même). L’infini peut ainsi contenir toute l’existence puisqu’il est par principe infini. Or, cela devient plus intéressant si l'on réduit cette suite de chiffres de l'infini à quelque chose de fini, on trouvera donc un emboitement parfait qui contient parfaitement le domaine de l'existence. C’est comme essayer des boites de plus en plus petites jusqu’à ce que cette existence puisse rentrer parfaitement sans le moindre espace. Or, ce que nie ici le scientifique, c'est qu'il n'y a pas un ordre spécifique, qu'il est possible d'avoir une infinité de ces suites de chiffres "univers" mais ordonnés différemment. Oui, en effet, si l’on reprend notre exemple avec pi, il existe forcément un film qui décrit notre vie, mais celui-là est joué à l’envers ou bien notre adolescence qui est montrée avant notre enfance. C’est toujours en soi le même film de notre vie, mais ordonné différemment. Cela nous rapproche beaucoup de sa conclusion de l'Unique, puisqu’en essayant de prouver qu’il existe il se rend compte qu’il a prouvé que plusieurs uniques existent, rendant absurde son hypothèse de départ.
Dans la troisième note, l'équilibre est en train de chuter, on peut le voir à son langage qui est incroyablement saccadé. À présent, Il fait face au paradoxe qu'il avait mis en évidence par mégarde dans la première note en essayant de nous démontrer sa stratégie pour parvenir à l’unique, c'est à dire celle où variance aurait des définitions variantes. Eh oui, là est toute l’ironie: le mot variance lui-même a plusieurs définitions variantes ! Je dois dire que cela m’a un peu fait ricaner (on s’amuse comme on peut), car cette ironie n’arrange pas son travail. La suite logique est donc toute trouvée: Il tente de définir donc la variance d'une seule définition, grave erreur ! Il va en effet se rendre compte peu à peu de ce en quoi il vient de s’engager. Il n’existe pas ou très peu de mots qui peuvent être interprétés d’une seule façon. Et essayer de borner les définitions est certes d’une part un outrage à la littérature mais n’amène que à la contradiction. Dans le langage familier, on aurait dit qu’il se tirait une balle dans le pied, et je dois dire que cette expression représente parfaitement la situation. Et je ne vous ai toujours pas dit le pire ! J’ai dû m’arrêter d’écrire à cet instant tellement je rigolais dans mon coin. Une part de moi avait honte, comment j’étais devenu aussi fou pour rire tout seul, surtout à propos d’un ouvrage comme celui-ci ? Palatine, qui était revenue enfin après une longue matinée d’absence semblait s’inquiéter pour moi. Cette fois-ci, je lui donnerai raison, il n’y a pas de quoi rire comme cela. Ou peut-être que si ? Vous allez probablement rire vous aussi. Que l’ironie du sort fasse du mot « variance » un mot à définition variantes, c’est déjà assez drôle. Mais que croyez-vous que notre scientifique fait lorsqu’il tente de définir la variance en une seule définition ? Bien évidemment, il essaye d'utiliser d'autres mots qui sont eux-mêmes variants ! Il s’est heurté au pire obstacle que tous les philosophes rencontrent lorsqu’on parle du langage. Car il est impossible de remettre en question ce langage si nous sommes en train de l’utiliser pour justement le remettre en question. C’est comme un interdit mathématique, comme diviser par zéro. C’est le grand mur de la philosophie du langage, et notre scientifique se l’est pris dans le nez pour tout dire. S’il veut définir la variance sans variance, ses mots doivent être sans variance. Il doit donc définir ces mots sans variance avant de les utiliser. Mais les autres mots qu’il utilise pour définir ceux-ci doivent aussi être sans variance ! C’est un enfer sans fin, c’est ridicule. Comprenez à présent les raisons de mon fou rire. Pour ajouter un peu de scepticisme à la soupe (pardonnez la locution familière), il part du principe que les chiffres sont le meilleur moyen pour représenter l'univers. Et si c’étaient des formes ? Des sons ? Une autre entité que nous n'avons pas découvert ? Il ne remet pas en question son système de définition, il part donc sur des bases instables qui le mènent peu à peu vers l'écroulement. Un écroulement qui ne va sans doute pas le déranger s’il décide de s’appuyer sur la canne invisible et toute puissante de la croyance.
Enfin, la note ultime. La quatrième note. Le scientifique comprend qu'il est entré dans plusieurs contradictions en essayant de décrire son processus à voix haute et en essayant de nous convaincre. Si vous vous rappelez plus haut, nous avons dit que l’homme ne chercherait peut être même pas à nous convaincre nous mais à essayer de se convaincre lui-même d’abandonner sa raison. Non seulement cela, notre ami n'a fait que renier le « paganisme » pendant toute son exposition, un nouvel élément qui vient enrichir notre philosophie de la religion. En parlant de paganisme, il fait une autre grave erreur puisqu’il suppose que la science est en fait une croyance (ce qui ne croient pas à son potentiel sont en effet des mécréants). Bien pire encore, il identifie justement l'Unique, une présence, presque un être transcendant au fond de l'univers qui le porte à se redéfinir et croire au fait que l'univers est réellement variable. En s'imaginant qu'il existe ce genre d'entité supérieure, il bascule dans le mysticisme et oublie complètement la science qu'il se devait de respecter, rigoureuse et précise. Il abandonne donc la méthode scientifique pour atteindre un nouveau paradigme, la science par mysticisme de l'infinité et de l'unicité variante. Nous retrouvons ainsi tous les repères énoncés auparavant, tous réunies dans cette conclusion finale qui nous apporte à étendre cette philosophie soulevée.
Je vous l'accorde, le texte est vraiment obscur. La syntaxe est compliquée par moments, les raisonnements sont même complexe à comprendre. Comme discuté avec Palatine, l’ouvrage est majoritairement de la littérature, presque exclusivement de la fiction. Cela pourrait très bien être un roman, comme elle le voulait. Ce texte n’a pas vocation à être philosophique en soi, mais il soulève des points que je ne peux pas négliger. La philosophie qui en ressort doit être étendue, l’ouvrage fait déjà un très bon début mais il est de notre sort de la continuer. Tout ce que le récit raconte en somme, c'est l'histoire d'un homme obsédé par l'élimination de toute divergence pour trouver une unique vérité. Or, en trouvant cette vérité, il se rend compte qu'il la fait au moyen de croyances et que c'est dans la pluralité qu'on ne peut que trouver l'unique. Le seul moyen de trouver une équation universelle, c'est par la croyance. Le scientifique croit qu'il y a une réponse à la fin de la découverte ultime, mais cette réponse c'est de croire qu'elle existe.
Si vous êtes un minimum littéraire, vous comprendrez sûrement pourquoi je suis aussi excité en lisant cet ouvrage. Relisez rapidement ces dernières pages, voyez tout le chemin qu’on a traversé ensemble ! Et ce n’est que l’introduction, je ne pensais jamais avoir à écrire autant sur un livre tombé du ciel sans titre ni auteur ni même une couverture. Je ne sais pas vous, mais je trouve cela absolument fascinant. La philosophie qui ressort de ce texte est absolument magistrale, et je pèse mes mots.
Après avoir achevé ce chapitre, je me suis donc reposé un instant. C’était intense mais divertissant. Palatine était revenue sur ses schémas de la veille, les autres travaillaient comme à leurs habitudes. Seulement Pétra était disponible pour qu’on puisse en discuter ensemble. J’ai tenté de lui faire lire ce que j’avais écrit jusque-là. C’était une grande philosophe d’une renommée exceptionnelle, je doutais qu’elle puisse trouver mon écrit d’une si grande qualité. Et pourtant, contre toute attente, elle avait l’air de l’adorer. J’étais réellement tombé sur un ouvrage exceptionnel, et mes analyses étaient très intéressantes d’après ses dires. Je la remerciais chaleureusement, au fond j’étais un peu gêné. Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas reçu d’approbation pour des projets délirants comme celui-ci. Pétra avait cependant l’air de sincèrement l’aimer. Mieux encore, elle voulait en discuter avec moi.
Nous avons ainsi passé les prochaines trois heures assis face à face sur des fauteuils comme avec Palatine la veille (ou plutôt devrai-je dire tôt ce matin, vu l’heure à laquelle nous avions achevé notre débat). Mais cette fois, ce n’était pas une confrontation. Pétra voulait m’aider à formuler un plan concret, à trouver une ligne directrice et à étendre ce début de philosophie de la Lettre de Valinor le plus possible. C’était évident, cet ouvrage méritait bien sûr un tel honneur vu sa qualité surprenante.
Chapitre Sept
Dialogue avec Pétra Scudier ou la complicité d’un projet philosophique ambitieux
Pétra Scudier est réellement une femme d’exception. Philosophe majeure dans la littérature contemporaine antarienne, elle a l’esprit le plus aiguisé que je n’ai jamais vu. Et en plus, elle était jeune. Seulement vingt deux ans (je crois, il n’est pas bien poli de demander l’âge aux femmes) d’après ce que j’ai entendu dans les fameux couloirs aux rumeurs. En même temps, j’étais assez jeune aussi, j’ai personnellement vingt neuf ans et je veux bien croire qu’elle soit plus jeune que moi (non pas que cela me dérange, absolument pas ! Même en étant plus âgé, les autres salonistes me considèrent toujours comme le cadet de la troupe). Plus brièvement, j’avais une chance considérable que de me faire conseiller par elle.
La discussion pouvait ainsi commencer. Je devais mettre au clair d’abord mes idées. J’ai commencé par lui parler des termes clés que j’avais identifié jusque-là. Tout d’abord, les plus importants étaient sans aucun doute l’Unité et la pluralité. J’ai rapidement explicité mes trouvailles par rapport à ces deux-là, en expliquant ma théorie de l’emboitement (ce n’est pas vraiment la mienne en fin de compte, je me la suis un peu appropriée). Elle n’était pas non plus championne en mathématiques, mais a parfaitement compris mes idées sur la variance. Ensuite, j’ai enchaîné sur la raison logique et morale. Nous avions mis en évidence ces deux définitions, tout en barrant celle morale d’intervenir dans notre raisonnement pour être plus cohérent dans notre discours. Et enfin, le choc entre science et croyance fut établi. J’ai longuement décrit à Pétra cela, notamment où il s’agissait de la corruption et des deux principes d’un scientifique. Nous en avions faits du chemin, et nous étions lourdement armés pour amorcer un essai philosophique de plusieurs dizaines ou centaines de pages.
Une fois mon discours achevé, Pétra voulu m’applaudir. Ce n’est pas pour me jeter des fleurs, mais cela ne m’arrive pas souvent. On arrive rarement à la cheville d’une telle femme, la dépasser est hors de question. Mais dans tous les cas, je me suis rapproché de manière considérable à cette limite. Elle avait tout compris, et elle trouvait cela fascinant. Même Palatine avait levé l’oreille de l’autre côté de la pièce pour essayer de comprendre. Elle n’était pas très philosophe, cela ne l’intéressât que quelques minutes. Après tout, j’ai eu une complicité avec elle hier soir aussi, il est normal de vouloir garder des nouvelles de ma progression.
Pétra a donc pris la parole, en essayant d’évidence ce qui pourrait être amélioré. Tout d’abord, il manquait beaucoup de structure dans mes idées. Il me fallait une thèse et une antithèse, et pour l’instant je n’avais que quelques bouts pour les former. ¬¬Elle me proposa d’établir un plan en quinconce (sa spécialité) en étudiant d’abord « d’après un autre » soit en donnant raison au scientifique notamment sur les parties concernant la raison. Ensuite, j’aurais pu enchainer sur quelques limites d’après observation extérieure. Je pouvais ensuite faire une transition entre cette partie très textuelle grâce à une approche avec les thèmes de la science et du mysticisme. Enfin, je pourrai lâcher complètement le texte pour m’envoler dans une troisième thèse philosophique sur l’unique et la pluralité. Trois axes, six parties (deux chacun), dix-huit sous-parties (trois pour chaque partie). Pour le dépassement, elle m’a dit que serait une mauvaise idée, car nous partons essentiellement d’un ouvrage. À la place, elle me conseille de rattacher cette philosophie dans une sorte d’uchronie en donnant un autre sens au livre qui n’a jamais été entendu ainsi. Réinventer l’ouvrage, c’est l’objectif qu’elle m’a donné. Et je ne pourrais jamais la remercier autant pour tous ces conseils. Je ne plaisantais pas quand je disais que Pétra était réellement talentueuse.
Nous avions discuté encore plusieurs heures sur comment introduire, comment conclure, les contenus des sous-parties. Nous faisions la dissertation à l’oral, nous deux. Après bien trois heures, je voyais qu’il était bientôt dix-sept heures pile. Il me fallait marcher rapidement en direction de l’Abbaye de Sainte Esther pour la messe du dimanche soir, écrire cet ouvrage m’avait déjà pris plus de vingt quatre heures de ma semaine. J’ai demandé à Pétra si elle voulait venir avec moi, même si je savais qu’elle y était déjà allée ce matin. Elle me répondit oui contre toute attente, en me disant qu’une messe de plus ne ferait de mal à personne. Il fallait bien vingt minutes pour s’y rendre à pied depuis l’Alma, vingt minutes de plus à discuter ensemble de cette fameuse dissertation. Celle-ci allait être probablement ma plus réussie depuis que je suis entré au Salon, et tout cela grâce à Palatine et Pétra.
[Le reste de la discussion et ses détails ne sont pas disponibles dans la version abrégée]
La messe fut enfin terminée, et nous sortîmes de l’abbaye alors que le soleil était toujours assez haut dans le ciel. On approchait le jour le plus long, le solstice d’été, et cela faisait toujours du bien d’avoir de la lumière en plus à ces heures aussi tardives. Nous avions pris garde de discuter pendant la messe, il ne fallait pas déborder autant. Cependant, dès notre sortie, ce fut comme l’ouverture des vannes d’un barrage. Nous avions tous deux pensé à d’autres points pendant le service, ce qui nous donna bien d’autres possibilités de discussions. Tellement qu’on ne les épuisa même pas le temps d’arriver à l’Alma, après avoir acheté un encas. Je n’avais pas mangé depuis longtemps, Palatine m’avait même appelé dès que je suis sorti de la messe pour me rappeler que j’allais mourir de faim tôt ou tard (et aussi pour nous demander de lui acheter un dîner, par ailleurs). C’est ce que nous fîmes, et cela nous donna l’occasion de discuter plus. Nous étions comme deux enfants, deux collègues, un observateur externe aurait dû trouver cela très sympathique à regarder.
Arrivé à l’Alma, le Salon s’était considérablement vidé comme tous les dimanche soir. Il ne restait que Palatine, Pétra et moi. J’avais eu envie un instant de relancer une discussion, cette fois avec Palatine. Mais celle-ci avait besoin d’aide pour un autre de ses projets, l’aide de Pétra. Bon, c’était tant mieux pour moi. Je pouvais me replonger dans mon écriture et me dédier enfin à cette dissertation.
Ne passons plus par quatre chemins comme on le dit. Transposons ce texte, faisons-le évoluer, érigeons-le au stade de chef d’œuvre de la philosophie moderne. Amis, ici commence mon ouvrage pour de bon.
Fin Page1
ou l'analyse d'une philosophie perdue
Version Abrégée
Date de Parution: 17 Juin 2015
Catégorie: Philosophie, Argumentation, Commentaire
Lieu de Publication: Académie des Lettres Modernes et Anciennes (ALMA), Ville de Roncevaux
Code d'Identification ALA: UR-77251-XC
Chapitre Premier
De l'Ordre d'une Trouvaille Précieuse ou les antécédents à l'analyse
Oui, quiconque l'ait écrit. Le petit ouvrage, il ne conviendrait pas de l'appeler livre mais plutôt nouvelle, était écrasé par deux autres bien plus grands. Pas d'auteur, pas de code ALA, pas de genre même. Même pas un titre ! D'aucuns pourront se dire que ne pas titrer un livre résulte en une grande barbarie de la part de l'auteur. Ne pas titrer un ouvrage, c'est ne pas achever sa pensée, ne pas avoir les idées claires et n'avoir aucun esprit de synthèse. Mais à qui devrions nous reprocher le fait que l'ouvrage n'ai pas de titre ? Il n'avait pas plus d'auteur, ni même une information périphérique. Il n'avait pas de code barre, ce qui signifiât qu'il faisait partie des ouvrages qu'on ne pouvait même pas emprunter. Quel mystère, quelle découverte ! Il m'a semblé de trouver une plante au milieu d'un désert aride et chaud. Contrairement à certains qui auraient osé jeter cet ouvrage aux oubliettes, j'ai voulu le prendre sous mon aile pour l'étudier plus en détail. Après tout, personne n'aurait remarqué qu'un si fin ouvrage avait disparu des étagères, et je faisais partie du Salon de toute manière. Personne n'interdira à un homme de sortir ce livre de là où il avait été placé, sinon la raison morale de ne pas s'éterniser sur un ouvrage quelconque. Je suis allé au-delà de cette raison, j'ai pris le livre sans même l'ausculter plus que cela et je suis monté quelques étages pour monter au Salon.
Aujourd'hui, c'était un jour de pluie. Il n'y avait rien à faire dans mon appartement, comme d'habitude. Depuis maintenant trois ans que je fus là, je n'ai jamais évité une occasion de me rendre au Salon. J'ai rencontré des dizaines de personnalités littéraires antariennes qui m'ont appris à apprécier plusieurs types de littérature. De même, j'ai tenté d'apprendre aux autres la beauté de la littérature catacombienne. Je passais mes journées dans les niveaux les plus inférieurs de l'Alma, à la recherche d'ouvrages que personne n'avait jamais encore ouvert, avec des tournures de phrase mystérieuses. Je rêvais à l'idée de trouver des ouvrages perdus et de les remonter à la surface. C'était pour moi une ambition littéraire majeure, et cela l'est toujours. Et ce nouvel arrivage dans ma collection, il était des plus prometteurs. Arrivé au Salon, Palatine était en train de gribouiller quelques schémas comme à son habitude, à planifier visuellement son prochain écrit. Face à la grande fenêtre se tenait Tristan, revenu de son escapade dans les plaines de Laxande, en train de regarder le ciel comme il le faisait bien souvent. Personne d'autre n'était présent, c'était l'occasion parfaite pour m'asseoir à un bureau et commencer l'étude de ce nouvel ouvrage que j'avais débusqué.
Je commençais par regarder la couverture. Le livre était intégralement blanc. Immaculé, presque, si ce n'était pour le fait qu'il était un peu abîmé. Surement les bibliothécaires n'ont pas pensé à faire attention à un ouvrage si petit et si dénué de sens... pour eux. Une seule petite icône était présente, dans un coin au dos du livre. Un œil peut être, un hiéroglyphe. C'était le même que celui qu'arborait le drapeau de Valinor. Au moins, on savait à quel genre de littérature on avait à faire. À présent, comme l'analyse superficielle était manifestement achevée, il était temps d'en lire les pages. Très peu de pages, certes. Mais je sentais qu’elles cacheraient un plaisir des plus vivaces à le lire. Après une esquisse rapide de ces quelques feuillets, l'ouvrage était vraisemblablement divisé en quatre lettres. Il était temps de les lire et de s'en faire une idée. Peut-être que je me trompais, il s'agissait peut-être d'un roman pseudo-philosophique qu'avait écrit un homme âgé sur son lit de mort. Ou peut-être que j'avais trouvé un vrai trésor de la littérature moderne (je ne puis savoir si l'ouvrage était réellement moderne à l'instant, mais au vu de ma lecture il en semblait ainsi). Quoi qu'il en soit, il était bien trop mystérieux pour être seulement médiocre.
Chapitre Deux
Au plaisir d'en lire son entièreté ou l'aperçu de l'ouvrage
J'essayais de fermer les yeux pour rassembler mes idées. C'est ainsi que je sentis une main se poser sur mon épaule. À ce moment-là, je fus tellement pris par surprise que mon sursaut fut assez puissant pour me chasser de mon fauteuil et me redresser debout. Je n'en revenais pas, j'étais si crispé que cette simple main m'a mis dans un état d'alerte presque burlesque. Cette main, c'était celle de Palatine qui avait elle aussi fini sa journée. Inquiétée de mon état, elle me posa des questions par rapport à ce que je venais de lire. C'était le membre du Salon que j'appréciait le plus car elle comprenait mon attachement pour la littérature perdue comme celle-ci. Il m'était assez simple de me fier à elle et de lui raconter mes trouvailles. Et pourtant cette fois-ci, elle me regardait d'un air inquiet. On était soudés entre intellectuels du Salon, mais les aventures que nous vivions individuellement laissaient parfois à désirer. Palatine m'avait réveillé au milieu de ma transe valinoréenne, après la lecture d'un ouvrage si intense. Il était normal de se faire du souci, je n'avais pas bougé de ma position de toute la journée.
Nous nous assîmes tous deux dans des fauteuils en face de la grande fenêtre. Tristan était déjà parti depuis un bon moment, il ne restait que nous deux. Peut-être allions nous dormir ici ce soir ? Les couchettes étaient disponibles, nous n'aurions pas à nous faire du souci. En tout cas, je ne me faisais pas de soucis pour ma part. Palatine en revanche avait l'air pressée de rejoindre son domicile. Elle prenait quand même le risque de s'assoir à mes côtés et de me demander sur quoi j'avais travaillé toute la journée, un risque considérable sachant qu'il était bientôt onze heures et au vu de ce que j'avais témoigné en ouvrant ce livre, nous étions sur de bons fondements pour faire nuit blanche. Par où commencer ? Le livre n'avait ni de début ni de fin, pas en termes de discours, mais plutôt en termes de compréhension. Il faut avoir lu la fin pour comprendre le début, et ce sont ce genre d'ouvrages qui sont les plus durs à expliquer. Mais Palatine était patiente. Son visage perdu entre ses longs cheveux noirs, à siroter une tasse de thé, elle avait l'air attentive. Si elle le voulait, alors j'allais lui expliquer.
L'ouvrage, encore une fois, je ne saurais le réitérer moins que cela, était d'une beauté spectaculaire. Les mots étaient agencés avec une prouesse somptueuse et les figures de styles étaient présentes par milliers. C'est réellement un livre que n'importe quel amateur de littérature devrait lire pour s'en inspirer. L'histoire, bien qu'elle soit extrêmement floue, traite de quatre lettres. Ces quatre lettres ont été écrites supposément par un scientifique, un scientifique qui perd la raison au fil des lettres. Il est à la recherche de ce qu'il appelle l'équation universelle, pour quantifier le monde. C'est quelque chose d'osé, de grand, peut-être d'irréalisable. Mais il le dit avec tellement de ferveur qu'on en vient à se demander si elle existe réellement. Lettre après lettre, mot après mot, on a l'impression qu'il se rapproche sans relâche de son but. Et en même temps, sa raison commence à flétrir. Il en perd complètement ses repères, on ne le reconnait plus. Et au final, il se reconvertit dans une autre idée, que le monde est pluriel, et que chaque pluralité contient encore plus de pluralités. Ce n'est pas très clair dit comme cela, je vous l'accorde. Il m'a moi même fallu l'expliquer plusieurs fois à Palatine pour qu'elle comprenne. C'était réellement un texte obscur, mais c'est justement dans cette obscurité que réside son charme. Elle voulait bien y croire et fournissait visiblement des efforts. Lorsque ma courte description fut achevée, il était minuit passée. Nous devions nous rendre à l'évidence, nous allions passer la nuit ici.
Ce n'était pas la première fois que je restais au Salon plus de vingt-quatre heures. Je l'ai déjà fait en rédigeant les plus longs de mes ouvrages. Quant à Palatine, elle fréquentait les lieux si souvent que plusieurs doutaient du fait qu'elle possède vraiment un appartement. Ou peut-être que si, mais il ne lui servait à rien. L'Alma était pourtant si accueillante, il est absolument justifié de penser que passer ses jours ici serait la meilleure chose à faire. Mais revenons-en à l'ouvrage, ne nous égarons pas. J'avais décidé par ma liberté en tant qu'explorateur de ce récit de le nommer « Lettre de Valinor » par ses origines et le fait qu'elle soit constitué de lettres. Il ne fallait pas donner un nom pompeux à quelque chose d'aussi mystérieux. Au contraire, il faut préserver dans mon avis le mysticisme et le mystère qui plane sur cet ouvrage. Il est fort intéressant grâce au fait qu'il est mystérieux. Un titre aussi mystérieux que Lettre de Valinor ne pouvait qu'accentuer cela. Ainsi, posés sur nos couchettes, il nous fallait un argument pour trouver sommeil. Nous avions parlé de cette lettre pendant presque deux heures maintenant, et Palatine comprenait mieux sa disposition. Jusqu'au moment où elle dit, d'un ton fort et clair: « Ce roman est quand même assez fascinant ». J'ai trouvé cela très bon de sa part, et j'en était fier malgré le fait qu'il ne m'appartenait pas. Mais j'ai tiqué sur le mot roman. Je lui ai donc dit d'une voix douce qu'il s'agissait clairement d'un ouvrage philosophique. Et là, nous sommes tombés sur un désaccord.
Palatine pensait fermement qu'une histoire aussi garnie que celle-ci (elle l'avait lue entre temps, après cent explications de ma part) se devait d'être de la littérature. Les tournures de phrase, le fait que l'homme perd doucement sa raison... C'est évidemment du roman. Moi au contraire, j'avais passé la journée dessus. Le texte présentait une philosophie très importante sur le thème de l'Unité et de la Science. Une philosophie qu'on ne peut que déceler en s'y plongeant complètement. Il est compréhensible que Palatine, à travers quelques lectures seulement, peine à voir ce côté enrichissant de l'histoire. Mais elle résistait. Ce livre était de la grande littérature, et la philosophie n'est qu'une surinterprétation. Il ne fallait pas se faire d'idées.
Même si nous nous préparions à nous endormir, nous nous sommes levés pour prendre place dans des fauteuils face à face dans la grande chambre du Salon. Nous étions décidés à faire valoir nos arguments, même si cela allait prendre toute la nuit. Ainsi, notre débat pouvait commencer. S'agissait-il de littérature ou de Philosophie ?
Chapitre Trois
De la dualité de l'ouvrage ou le Débat avec Palatine de Rigault
Chapitre Quatre
De l'issue littéraire du présent ouvrage ou l'objet périphérique à nos recherches
Lorsque je me suis réveillé vers onze heures du matin le jour suivant, Palatine était déjà partie je ne sais où. Probablement à la messe, c'était dimanche. Pour ma part, j'y vais le plus souvent le soir, pour clôturer la semaine. Mais à chacun ses préférences. Cela m'a permis d'avoir le salon entièrement vide et à ma disposition au moins pour quelques heures. Mon bureau était toujours dans le même cafouillis que je l'avais laissé la veille, la grande fenêtre me piquait les yeux (signe que je n'avais pas bien dormi, mais peu importe) et les fauteuils de notre débat étaient désordonnés. Je me souviens qu'à un moment, nous nous étions levés et le débat s'était presque enflammé. Cela a dû les pousser de partes et d'autres. Mais que faisons-nous ? Il n'est pas temps de vous conter mon histoire. Il y a une autre histoire fort intéressante qui mérite notre attention bien plus en détail. Plongeons-nous ainsi dans l'analyse littéraire de la Lettre de Valinor, on ouvrage absolument remarquable qui a conquis mon cœur.
Le plus grand et le plus intéressant des sujets est sans doute le personnage principal qui perd la raison. En effet, lorsqu'on lit, on s'aperçoit au fil du texte que ses phrases simples au début deviennent puis confuses, saccadés, dans un rythme cassé et précipité. Dès lors, cela nous fait comprendre l'importance que nous devons attacher à ce personnage, son rôle clé dans l'établissement d'une finalité frappante et le point de pivot qui servira à retourner la conscience du lecteur en confirmant ce qu'il rejetait depuis le début. Le fait que le scientifique se perde dans ses explications, qu'il en vient à perdre la raison, cela est fort intéressant et témoigne d'une construction très bien établie. En effet, le scientifique « normal » si nous pouvons l'appeler comme cela est d'habitude porteur de raison. C'est lui qui effectue des tentatives, expériences, qui confirme ce que nous savons ou bien vient le compléter. Si l'on remonte à l'époque, aux débuts de la philosophie antarienne, nous savons que la méthode scientifique a pris son envol vers le XVIIème siècle, voire au XVIème. Depuis ce jour, ou plutôt cette période, nous vivons dans un paradigme où le scientifique suit une méthode ordonnée pour parvenir à ses résultats, des résultats fiables qui prouvent la véracité des faits. Nulle confiance ne peut être faite aux écrits non validés, et c'est ainsi que la bible et l'évangile furent pris pour cible. Mais ne divaguons pas. Le scientifique est celui ou celle qui est censé donner raison. Dans un débat, des discussions, c'est lui qui apporte les preuves au service d'une partie ou de l'autre. Lui ne discute pas, il fournit. Le scientifique est celui de qui on attend les réponses concrètes, et à partir de celles-ci des décisions peuvent être prises. Dans la Lettre de Valinor, le scientifique est bien dépassé par tout cela. Il nous fait croire qu'il adhère à ces standards en effet, on peut le voir alors qu'il réitère savoir une équation universelle ou du moins être au bord de la posséder. Il prétend posséder le savoir, mais sans nous donner plus d'informations. Tenez, c'est la même chose qu'on reprochait à la bible autrefois ! Un texte flou, mais la chose est certaine. Dites-moi si ce n'est pas de l'hypocrisie ! Oui en effet, notre personnage est tout sauf scientifique. Dans son basculement, nous nous rendons compte qu'il vire au mysticisme au fur et à mesure que le texte évolue. L'évolution même du personnage représente cela. Le rythme déliquescent de ses phrases montre ainsi la progression, d'un modèle paradigmatique du scientifique à la réalité des faits où le scientifique n'est plus.
Cela me permet de transitionner vers le deuxième point, tout aussi important. C'est bien sûr le choc entre raison et mysticisme. En effet, les deux se chevauchent à merveille. D'une part, le texte est plein de terminologies scientifiques et techniques, nous pourrions facilement croire qu'il sait ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Or, la fin nous en apprend plus. Il ne donne point d'informations. Parle avec un langage flou. Nous parle de termes abstraits comme l'Unité ou la pluralité. Tout porte à croire qu'il ne s'agit pas d'une revue scientifique mais une espèce de prospectus religieux d'une certaine secte basée sur une pseudo-science. Oui, le scientifique représente la pseudo-science, et le moyen dont cela est représenté rend les passages légendaires. Il existe certes ce choc entre superficiel et discours, entre les mots choisis et comment ils sont mis entre eux. Une disposition que je trouve absolument fascinante: Les mots seuls montrent que l'homme est clairement un scientifique qualifié. Mais quand ils sont arrangés de cette manière, il s'agit plutôt d’une espèce de moine ou d'adepte à une église ou secte curieuse. N'exagérons rien non plus. Mais réellement, cela illustre la richesse et la beauté du texte. Il n'a jamais été fait meilleur que cela en terme d'agencement: utiliser les dimensions pour combiner deux terrains radicalement différents, une autre embuscade littéraire qui piège les lecteurs superficiels et laisse passer ceux qui s'y intéressent plus en détail. De plus, toujours dans le même registre et par la même technique, on observe une deuxième juxtaposition entre cette fois ci l'ordonnance et le dérèglement. La confusion et la linéarité. Ce sont deux valeurs qui sont encore une fois lourdement confrontés à travers le texte. Oui, d'une part cela nous semble ordonné. Les mots sont visiblement choisis, l'homme est expert dans son domaine et le champ lexical témoigne d'une vraie structure. Mais dès qu'on regarde la périphérie, qu'on compare et qu'on se rende compte de la syntaxe, le désordre arrive sous nos yeux. Oui, c'est ce qu'on appellerait un « bordel organisé » dans le jargon populaire, pardonnez mon expression puissante. Mais il est nécessaire de visualiser telle chose. Les oppositions comme celles-ci œuvrés sur plusieurs dimensions du texte en même temps témoignent d'un savoir-faire incroyable. Et c'est ainsi un autre point littéraire de ce texte qui doit être absolument mentionné.
Enfin, une autre prouesse de ce récit réside sans aucun doute dans sa force de nous communiquer le malaise. N’importe qui en lisant l'ouvrage sentira une certaine forme de malaise. Et pourtant, lorsqu'on lit, on se rend compte que le scientifique essaye d'être le plus certain de lui-même possible. Il continue à essayer de nous convaincre et surtout de convaincre à lui-même que cette équation existe bel et bien. Non seulement le fait de forcer cette information pour que nous l'intériorisions dans notre esprit, cela ne peut que nous faire penser l'inverse. Le scientifique n'est visiblement pas si sûr de lui même ou il n'aurait nul besoin de se justifier à maintes reprises. Pire encore, nous avons l'impression qu'il se ment à soi-même. Et c'est là où l'ouvrage devient des plus intéressants. Le scientifique ne nous parle pas à nous, il se parle à soi-même. Il cherche à se convaincre soi-même de cette folie absurde, il sait que personne n'y croira et c'est une partie perdue d'avance. Pourquoi donc chercher à nous convaincre ? Si cela avait été son but, il aurait été plus charismatique et aurait avancé de meilleurs arguments. Non, il ne cherchait pas à faire cela. Il se cherchait lui-même, il voulait se mentir, il voulait penser différemment. De notre point de vue externe, une seule sensation peut être retenue lorsque nous voyons quelqu'un se faire du mal de cette manière: le malaise. Oui, c'est ce malaise en effet que nous sentons, peut-être une empathie certaine pour le scientifique. Il hésite de plus en plus, et dès qu'il arrive enfin à en être convaincu il comprends la vraie nature du sujet: l'équation n'existe tout simplement pas. Cette idée de malaise rejoint celle des oppositions mis en place dans le récit, ainsi que son rythme cassé qui laisse clairement entendre une sorte de bégaiement. Cette attitude est bien assez pour pouvoir mettre chaque homme normal dans cet état de malaise vis à vis de ce qui est lu. Vraiment, cet ouvrage est des plus intéressants. Palatine avait peut-être raison tout compte fait. Celui-ci était vraiment d'une beauté littéraire qui ne pouvait être accidentelle, et cette idée du scientifique malaisant ne fait qu'embellir un bouquet déjà bien garni.
Il y a bien d'autres analyses, plus fines et plus poussés encore. Nous pourrions peut-être parler des métaphores employées, voire la ponctuation. Mais ces trois thèmes sont dans mon avis les plus importants. Je laisserais à Palatine la chance de s'exprimer à propos de cela, toujours si elle le souhait bien évidemment.
Chapitre Cinq
D'une connexion reliant sens à interprétation ou la transformation philosophique et progressive de l'ouvrage
Débutons ainsi ces connexions en nous penchant sur justement la signification philosophique de la perte de raison du personnage. Nous avons établi ensemble le fait qu'un scientifique se doit d'être raisonnable pour parvenir à son travail de scientifique. Or, l'homme fait tout l'inverse à mesure que l'histoire se produise. Il néglige sa raison au profit de son scientisme, de son mysticisme et de la croyance pure. Ce n'est certainement pas quelque chose de recommandable, encore moins si l'on écrit des lettres pour en parler. À la Fantassine ceux et celles qui écrivent pour n'arriver à rien ! Si l'on commence sur une lignée, il faut la terminer. Ce n'est pas un bon exemple que de penser à cela par rapport à cet ouvrage dans cette même optique. La raison semble donc le premier chapitre à aborder, celui qui connectera notre raisonnement philosophique à cette écriture. La raison, déjà. Comment peut-on parler de la raison sans la définir. Dans ma vision et dans celle de Pétra (Je l'ai consultée rapidement alors qu'elle regardait au-dessus de mon épaule pour savoir ce que je faisais), la raison se divise principalement en deux grandes catégories: La raison morale et la raison logique. La raison morale est notre fil directeur imprégné de la société, c'est celle qui nous fait obéir aux mœurs et normes sociétales. C'est celle souvent qui nous induit en erreur quand placés dans un territoire inconnu, comme dans un pays étranger. Nous voulons appliquer la raison morale que nous avons appris depuis jeune âge, mais il s'avère peut-être que les habitants du pays que vous visitez ont une conception différente de cette raison morale. Dans cet ouvrage, il n'est pas question de voyage, certes. Mais ces nuances de raison morales vont nous revenir en aide plus tard. D'un autre côté, la raison logique est plus universelle et plus généralisée. C'est, comme son nom l'indique, l'application de principes logiques dans son raisonnement. Que ce soient des mathématiques, comme en additionnant un plus un qui serait égal à deux selon cette raison logique, ou quand nous approchons un sujet en employant des déductions, inductions et syllogismes pour parvenir à des conclusions ou théorèmes applicables à tous. C'est celle-ci qui va nous intéresser le plus. En effet, quand on décrit l'individu comme "perdant la raison", il s'agirait surtout en mon avis de la raison logique. Nous-mêmes pouvons reconnaître qu'une équation universelle semble une théorie des plus farfelues. Comment serait-il même envisageable de quantifier l'univers dans son entièreté par une simple équation ? Si l'on traduit cela en jargon plus compréhensible, trouver une équation universelle signifierait trouver potentiellement une réponse à tout. Les plus optimistes d'entre nous penseront certes qu'il existe bel et bien une solution à tout, et je ne le renie pas. Mais mettre toutes ces solutions sous forme d'équation, c'est bien plus complexe. Qu'elle existe (la solution) ne veut pas dire qu'on la connaît, après tout. Ainsi, partir déjà du principe que ce genre d'équation puisse exister va déjà à l'encontre de notre raison logique d'une certaine manière. Qui plus est, au fil de la lettre, la logique de son discours se détériore au fur et à mesure, la syntaxe devient obscure et il est plus complexe de distinguer les faits et arguments qu'il porte. Cette confusion n'est pas digne d'une raison logique poussée, autre connexion entre ce qui est constatable textuellement et la philosophie de la raison qu'on peut en ressortir. Cependant, comme je l'ai dit, la raison morale n'est pas à négliger. En voyant ce scientifique perdre la raison logique, nous pouvons nous demander s’il est même moralement acceptable de perdre cette raison logique. Si nous nous baladons dans la rue en prétendant qu’un et un égalent trois, n'allons-nous pas à l'encontre de l'opinion publique ? Et si nous prétendons qu'une équation universelle existe ? Cela ne reviendrait-il pas au même ? D'autant plus que la folie dans laquelle il s'embarque, surtout à parler de mysticisme, cela n'est guère un comportement conforme aux normes sociétales que nous avons... si l'on suppose qu'il en fait partie. Bien oui, là rentre en jeu cette nuance. Il est possible de sauver le côté moral de sa raison, ou du moins justifier son comportement en supposant que les mœurs de là où il provient acceptent cette tenue. Peut-être que la recherche d'une équation universelle est quelque chose de valorisé dans ladite société. Qui sommes-nous pour juger de la qualité de la culture d'autrui, après tout ? Donc, laissons le doute planer sur ce qui est de la raison morale. Cela nous servira d'antithèse plus tard pour prouver qu'il y a des limites à notre thèse d'une perte de raison et que celle-ci ne concerne que la partie logique. Quoi qu'il en soit, nous avons déjà trouvé un lien entre la partie textuelle et la réflexion philosophique que nous pouvons en faire.
Venons en maintenant à un deuxième lien que nous pouvons établir. Celui-ci sera peut-être un peu plus court mais tout aussi notable. En effet, le scientifique transitionne au fur et à mesure de son discours vers un état secondaire, un état de mysticisme. C’est certainement fascinant, surtout après qu’il avait essayé de nous convaincre qu’il était un scientifique raisonnable ! Bien sûr, il est dur de le croire, là est toute l’ironie. Mais bien d’autres choses auraient pu remplacer cette tournure. Il aurait pu être corrompu, il aurait pu cacher sa honte de ne pas avoir réussi à parvenir à son but comme il nous l’avait tant promis. Non, il fait tout autre choix, celui de perdurer dans son idée et de la retourner sous forme mystique. Sans garanties, n’ayant que des croyances et des illusions à disposition, il décide de les suivre. À ce moment-là, les idées étaient encore dures à organiser pour moi. Devait-on enchaîner sur une discussion sur la question religieuse ? Il ne s’agissait cependant pas de religion ici. Bien au contraire, on frôlait le sectarisme. Mais après tout, rappelons-nous ce que nous avons établi dans le paragraphe antécédent. Nous ne sommes pas placés correctement pour juger des mœurs et coutumes, surtout des siennes. Parvenons ainsi à rejeter l’idée de pouvoir dicter ou juger d’une personne delà notre raison morale. Et si nous ne pouvons user de notre raison morale, la question religieuse devient de plus en plus abstraite. Oui, nous ne pouvons parler de religion ici, car celle-ci se voit enchaînée au principe de raison morale que nous avons explicitement omis dans notre discours pour éviter de prendre de mauvaises routes dans nos pensées. Tout de même, il nous faut converser d’un autre sujet. Sachons-le, il en faut pour qu’un scientifique bascule vers le scientisme et ce mysticisme aberrant. Et pourtant, cela n’a tout de même pas l’air de nous surprendre pour autant. Réfléchissons, cet homme est parti dans ses discussion dans l’unique but de trouver des réponses. En effet, on avait dit auparavant qu’on pouvait traduire une recherche de l’équation universelle par une recherche de réponse universelle. Que fait donc un homme lorsqu’il n’a pas de réponse ? Il se tourne vers la religion, bien évidemment. Nos ancêtres bien avant le catholicisme pensaient que les événements naturels comme la pluie ou le vent étaient l’œuvre d’une entité suprême de part du fait de leur manque de connaissances sur la situation. C’est justement la science qui est venue apporter les réponses dont nous avions besoin. Et c’est ce qui est matérialisé dans cette histoire. En effet, le scientifique représente la science, un homme qui cherche à savoir et à expliquer le monde. Or, dans son périple, il arrive à un stade où il n’a plus d’appui. Il n’a aucune preuve, aucune rationalité ou raison logique qui le supporte. Dans cette position, en haut d’une tour instable, deux choix s’offrent à lui: tomber à terre et mourir, donc abandonner son idée et se reconnaitre vaincu dans la plus grande des hontes ou bien s’envoler plus haut, grâce à rien, seulement par le pouvoir de la croyance. Il ne faut pas trop réfléchir pour comprendre le choix qu’a fait notre ami (je l’appelle comme cela à notre stade, l’appeler « scientifique » serait redondant et nous voulons construire un rapport spécial avec cet ouvrage et son protagoniste). Ce qui est extrêmement intéressant, c’est que par ce choix il abandonne une des parties qui font de lui ce qu’il est, c’est-à-dire un scientifique, en décidant de poursuivre la recherche coûte que coute pour avoir une réponse, mais la contrepartie étant qu’il doit se corrompre et se livrer à la croyance. Il parvient ainsi à trouver une réponse, mais c’est une réponse non tangible. À tout exemple pour mes lecteurs mathématiciens, cela ressemble aux nombres complexes. Certaines équations ne peuvent pas être résolues si l’on reste dans le monde réel. Mais en imaginant de nouveaux principes et en sortant de la réalité tangible, on peut utiliser le nombre complexe pour pouvoir trouver une solution à cette équation. Nous avons donc sacrifié un de nos objectifs pour avoir l’autre : nous avons eu une réponse, mais à quel prix ? Cette réponse est tout aussi non-tangible que les outils utilisés pour y parvenir. Pour résumer, le scientifique a deux objectifs : Obtenir une réponse et l’obtenir grâce à des preuves et appuis concrets. C’est comme diviser l’addition un plus un par trois. Si nous voulons que cette division soit égale à un, alors un plus un doit être égal à trois. Nous avons une solution, mais elle est absurde. Nous avons donc échoué à respecter les deux principes fondateurs de la science. Et notre cher ami (Oui, il a été promu au rang de cher ami désormais) travaille dans cet esprit-là. Il décide de se corrompre à moitié pour obtenir une solution. Il a un pied dans la science et l’autre dans la croyance. Il a une réponse, mais elle est trop abstraite. Ainsi, grâce à cette question du mysticisme, nous pouvons connecter ce texte aux thèmes de la science et de la croyance, deux sujets qui vont enrichir notre thèse et notre philosophie.
Concluons ce chapitre long mais nécessaire qui nous permet de passer au rayon philosophique de mon ouvrage. Le dernier point que je souhaiterais aborder que nous n’avons toujours pas couvert dans notre résumé littéraire mais qui est d’une importance capitale est le principe d’Unité et de Vérité. Ces deux thématiques sont probablement les plus importantes pour comprendre la finalité du récit, et c’est sur celles-ci que va s’appuyer majoritairement ma philosophie qui en débouchera. Mais pour ce faire, nous devons y établir une connexion au texte. En effet, le scientifique parle beaucoup d’unité, ce qui est normal me diriez-vous, il cherche tout de même à trouver une équation universelle. Si l’on voit le terme d’unicité comme d’un seul et même conglomérat, d’une seule particule, alors je voudrais bien vous donner raison. J’aurais moi-même pensé comme cela, que rassembler l’univers en une équation nous donne parfaitement cette idée d’unicité. Mais Pétra, qui est revenue faire un tour derrière mon dos, m’a tout de même illuminé sur une définition de l’unicité que je n’avais pas pris en compte. En effet, par unicité on peut tout aussi bien entendre le fait que quelque chose soit unique, qu’il se démarque du reste. On voit donc deux tranchants de la lame de l’unicité, celle quantitative qui décrit cela comme le rassemblement de tout en une seule et même unité de mesure, et celle qualitative où l’un est unique car il est différent du reste. C’est sur cette définition que j’aimerais me concentrer. Si l’on parle d’unicité de façon qualitative, on suppose qu’il existe d’autres unicités aussi. En effet, au nom de quoi disons nous que quelque chose est unique ? Ironiquement, je ne cesse de clamer le fait que cet ouvrage est l’un des plus uniques que je n’ai jamais lu. Mais si je peux le dire ainsi, c’est car j’ai pu en lire d’autres et en juger par expérience passée. L’Unique qualitatif est donc un jugement, une comparaison. Si le scientifique qualifie cette équation d’unique, c’est qu’il existe bien d’autres équations pour qu’il puisse affirmer son unicité. Ainsi, on se perd en confusion. L’équation unique est elle vraiment unique si elle est unique ? Nous avons ainsi trouvé une antithèse supplémentaire dans le discours de notre ami, une antithèse qui nous servira plus tard lors de notre développement philosophique. Mais avant cela, terminons sur notre thèse au sujet de l’unité. Oui, car il nous faut encore aborder le sujet de l’unité quantitative. Là encore, il nous est possible de trouver des connexions intéressantes entre une philosophie profonde et la nature littéraire du texte. Le scientifique suppose qu’il existe l’Unique en faisant référence à l’équation universelle, car par principe si une équation universelle existe elle est unique. Nous reviendrons plus tard sur cette théorie en parlant de l’emboîtement, soit comment l’infinité peut se contenir en elle-même, mais à cet instant comprendre cette nuance nous reviendra utile. Si le scientifique est convaincu qu’il existe une unique solution à tout problème, qu’il existe l’unique, alors c’est que l’équation n’est logiquement pas plurielle. C’est simpliste me diriez-vous, mais on bascule progressivement vers une autre contradiction. Car l’équation universelle contient tout, donc elle contient aussi des aspects pluriels. Le but entier de l’opération du scientifique est de condenser cette pluralité en unique. Mais elle ne disparait tout de même pas, le pluriel est toujours bel et bien dilué dans l’Unique ! On en vient donc à la conclusion que l’Unique est Pluriel, ce qui est vrai par deux définitions : Il existe plusieurs uniques et l’unique universel et composé de pluriels. Mais si nous avions dit que l’Unique n’est pas pluriel, comment pouvons-nous conclure que l’unique est pluriel ? L’unique est et n’est pas pluriel en même temps ? Non, nous venons de faire un raisonnement par l’absurde, et la conclusion de celle-ci est que la supposition de départ existe. Cette supposition était que l’Unique existe. Nous avons donc montré que dans les faits, il ne peut pas exister, et le seul moyen d’en parvenir est via la croyance et l’espoir qu’elle puisse exister comme mentionné précédemment.
Ces trois connexions pourront ainsi, je l’espère, vous donner un avant-goût des dissertations philosophiques que nous étudieront durant les pages à suivre. Passons à présent sans plus attendre en une brève analyse linéaire philosophique de la Lettre de Valinor, ainsi que pour nous soyons sur les mêmes repères lorsque nous philosopherons par la suite.
Chapitre Six
D’un aperçu d’ensemble sur la Lettre ou l’analyse philosophique brève exécutée de façon linéaire
L’ouvrage se compose en quatre lettres distinctes. Intéressons-nous donc à la première. Cette note décrit avant tout un aspect intéressant toujours pas exploré dans mon discours jusqu’à présent, soit une élimination de la « variance ». Ce terme a plusieurs définitions qui peuvent toutes nous amener dans différents chemins. Ainsi, il peut être interprété comme tout d’abord la variance statistique, autrement dit, le risque. En statistiques, elle représente le carré de l’espérance, c’est-à-dire l’espoir de succès. La variance mesure si pour arriver à cette espérance il y aura beaucoup de fluctuations (comme dans un jeu où il est possible de gagner beaucoup mais perdre beaucoup aussi). Cela est cohérent avec le raisonnement de quantification de l'univers qu’entreprend le scientifique, éliminer les risques voudrait dire pouvoir tout prévoir, et ainsi avoir une mesure de l'univers. Par la destruction du risque, il est possible d'atteindre une vérité mathématique universelle. Mais cette définition pose problème: si atteindre une équation universelle signifie supprimer cette variance, ou autrement dit d’avoir une variance égale à zéro, cela entend que il n’y a ni chance de gagner ni de perdre si l’on reprend l’explication statistique. Pire encore, si la variance est l’espérance au carré, et que la variance vaut zéro, alors l’espérance aussi vaut zéro. Et l’espérance n’est nulle autre que la moyenne de toutes les possibilités. Dans ce cas, nous nous retrouvons en une fourchette. Soit cela entend qu’il n’y a donc aucune possibilité et que l’espérance fasse donc zéro, soit l’expérience admet en effet des possibilités mais elles sont toutes nulles. Dans le premier cas, s’il n’existe aucune possibilité alors l’expérience ne peut tout simplement pas exister. Et si elle n’existe pas, cela veut dire que l’équation universelle non plus. Dans le deuxième, si toutes les possibilités sont nulles alors on retrouve le problème identifié dans le précédent chapitre. L’unique ne peut pas être composé de plusieurs possibilités et être unique en même temps, d’où une contradiction. Selon cette définition, l’Unique est donc inatteignable, mais le scientifique ne s’en rend pas compte à l’instant. Je devrais demander à des amies mathématiciennes d’une grande renommée, elles pourront certainement élargir mes connaissances sur la variance statistiques qui sont pour le moins assez limités à l’instant. Cependant, nous avons toujours une autre définition à explorer. En effet, la variance peut aussi être interprétée comme une pluralité d'interprétations. Dans cette situation, nous nous mettons nous-mêmes en position d’échec et mat, dans un cul de sac philosophique et logique. Puisque la variance elle-même est variante, il y a une infinité de variances et donc forcément des aspects complètement uniques. La variance est variante, donc on ne peut pas partir de son principe pour trouver l’unique. C’est les débuts de la théorie de l’emboitement formulée plus tard, d’autant plus que cette variance variante va plus tard rejoindre la conclusion du scientifique lorsqu'il parle de l'Unique dans sa dernière lettre. Pardonnez si je divulgâche, mais c’est assez compliqué déjà de pouvoir vous fournir un résumé philosophique comme celui-ci sans faire d’allusions.
Passons ainsi à la deuxième note de notre ami, qui est dans les faits plus obscure. Les raisonnements qu’il utilise pour nous convaincre de l’existence de cet unique me sont assez familiers, car j’en suis un fier utilisateur. Il s’agit là de raisonnements par emboîtement si vous n’aviez toujours pas deviné. Le principe est des plus simples: On suppose d'abord qu'on peut transformer l'existence finie en chiffres par nature infinis, le principe dont part notre ami. S’il peut passer du premier stade ou échelon à la quantification, c'est grâce à la mesure de l’univers. Or, par domaines de définition, toute chose finie est obligatoirement contenue dans l'infini. Donc, il est possible de contenir toute l'existence qui est finie dans une suite de chiffres. Des théories ont notamment été émises sur le chiffre pi, le plus célèbre de ces suites infinies. D’après certains mathématiciens réputés, toute notre vie et celle de l’univers sous forme de film sont contenues dans pi sous forme de binaire (je crois, je ne connais pas très bien ces faits-là, je suis bien loin d’être mathématicien moi-même). L’infini peut ainsi contenir toute l’existence puisqu’il est par principe infini. Or, cela devient plus intéressant si l'on réduit cette suite de chiffres de l'infini à quelque chose de fini, on trouvera donc un emboitement parfait qui contient parfaitement le domaine de l'existence. C’est comme essayer des boites de plus en plus petites jusqu’à ce que cette existence puisse rentrer parfaitement sans le moindre espace. Or, ce que nie ici le scientifique, c'est qu'il n'y a pas un ordre spécifique, qu'il est possible d'avoir une infinité de ces suites de chiffres "univers" mais ordonnés différemment. Oui, en effet, si l’on reprend notre exemple avec pi, il existe forcément un film qui décrit notre vie, mais celui-là est joué à l’envers ou bien notre adolescence qui est montrée avant notre enfance. C’est toujours en soi le même film de notre vie, mais ordonné différemment. Cela nous rapproche beaucoup de sa conclusion de l'Unique, puisqu’en essayant de prouver qu’il existe il se rend compte qu’il a prouvé que plusieurs uniques existent, rendant absurde son hypothèse de départ.
Dans la troisième note, l'équilibre est en train de chuter, on peut le voir à son langage qui est incroyablement saccadé. À présent, Il fait face au paradoxe qu'il avait mis en évidence par mégarde dans la première note en essayant de nous démontrer sa stratégie pour parvenir à l’unique, c'est à dire celle où variance aurait des définitions variantes. Eh oui, là est toute l’ironie: le mot variance lui-même a plusieurs définitions variantes ! Je dois dire que cela m’a un peu fait ricaner (on s’amuse comme on peut), car cette ironie n’arrange pas son travail. La suite logique est donc toute trouvée: Il tente de définir donc la variance d'une seule définition, grave erreur ! Il va en effet se rendre compte peu à peu de ce en quoi il vient de s’engager. Il n’existe pas ou très peu de mots qui peuvent être interprétés d’une seule façon. Et essayer de borner les définitions est certes d’une part un outrage à la littérature mais n’amène que à la contradiction. Dans le langage familier, on aurait dit qu’il se tirait une balle dans le pied, et je dois dire que cette expression représente parfaitement la situation. Et je ne vous ai toujours pas dit le pire ! J’ai dû m’arrêter d’écrire à cet instant tellement je rigolais dans mon coin. Une part de moi avait honte, comment j’étais devenu aussi fou pour rire tout seul, surtout à propos d’un ouvrage comme celui-ci ? Palatine, qui était revenue enfin après une longue matinée d’absence semblait s’inquiéter pour moi. Cette fois-ci, je lui donnerai raison, il n’y a pas de quoi rire comme cela. Ou peut-être que si ? Vous allez probablement rire vous aussi. Que l’ironie du sort fasse du mot « variance » un mot à définition variantes, c’est déjà assez drôle. Mais que croyez-vous que notre scientifique fait lorsqu’il tente de définir la variance en une seule définition ? Bien évidemment, il essaye d'utiliser d'autres mots qui sont eux-mêmes variants ! Il s’est heurté au pire obstacle que tous les philosophes rencontrent lorsqu’on parle du langage. Car il est impossible de remettre en question ce langage si nous sommes en train de l’utiliser pour justement le remettre en question. C’est comme un interdit mathématique, comme diviser par zéro. C’est le grand mur de la philosophie du langage, et notre scientifique se l’est pris dans le nez pour tout dire. S’il veut définir la variance sans variance, ses mots doivent être sans variance. Il doit donc définir ces mots sans variance avant de les utiliser. Mais les autres mots qu’il utilise pour définir ceux-ci doivent aussi être sans variance ! C’est un enfer sans fin, c’est ridicule. Comprenez à présent les raisons de mon fou rire. Pour ajouter un peu de scepticisme à la soupe (pardonnez la locution familière), il part du principe que les chiffres sont le meilleur moyen pour représenter l'univers. Et si c’étaient des formes ? Des sons ? Une autre entité que nous n'avons pas découvert ? Il ne remet pas en question son système de définition, il part donc sur des bases instables qui le mènent peu à peu vers l'écroulement. Un écroulement qui ne va sans doute pas le déranger s’il décide de s’appuyer sur la canne invisible et toute puissante de la croyance.
Enfin, la note ultime. La quatrième note. Le scientifique comprend qu'il est entré dans plusieurs contradictions en essayant de décrire son processus à voix haute et en essayant de nous convaincre. Si vous vous rappelez plus haut, nous avons dit que l’homme ne chercherait peut être même pas à nous convaincre nous mais à essayer de se convaincre lui-même d’abandonner sa raison. Non seulement cela, notre ami n'a fait que renier le « paganisme » pendant toute son exposition, un nouvel élément qui vient enrichir notre philosophie de la religion. En parlant de paganisme, il fait une autre grave erreur puisqu’il suppose que la science est en fait une croyance (ce qui ne croient pas à son potentiel sont en effet des mécréants). Bien pire encore, il identifie justement l'Unique, une présence, presque un être transcendant au fond de l'univers qui le porte à se redéfinir et croire au fait que l'univers est réellement variable. En s'imaginant qu'il existe ce genre d'entité supérieure, il bascule dans le mysticisme et oublie complètement la science qu'il se devait de respecter, rigoureuse et précise. Il abandonne donc la méthode scientifique pour atteindre un nouveau paradigme, la science par mysticisme de l'infinité et de l'unicité variante. Nous retrouvons ainsi tous les repères énoncés auparavant, tous réunies dans cette conclusion finale qui nous apporte à étendre cette philosophie soulevée.
Je vous l'accorde, le texte est vraiment obscur. La syntaxe est compliquée par moments, les raisonnements sont même complexe à comprendre. Comme discuté avec Palatine, l’ouvrage est majoritairement de la littérature, presque exclusivement de la fiction. Cela pourrait très bien être un roman, comme elle le voulait. Ce texte n’a pas vocation à être philosophique en soi, mais il soulève des points que je ne peux pas négliger. La philosophie qui en ressort doit être étendue, l’ouvrage fait déjà un très bon début mais il est de notre sort de la continuer. Tout ce que le récit raconte en somme, c'est l'histoire d'un homme obsédé par l'élimination de toute divergence pour trouver une unique vérité. Or, en trouvant cette vérité, il se rend compte qu'il la fait au moyen de croyances et que c'est dans la pluralité qu'on ne peut que trouver l'unique. Le seul moyen de trouver une équation universelle, c'est par la croyance. Le scientifique croit qu'il y a une réponse à la fin de la découverte ultime, mais cette réponse c'est de croire qu'elle existe.
Si vous êtes un minimum littéraire, vous comprendrez sûrement pourquoi je suis aussi excité en lisant cet ouvrage. Relisez rapidement ces dernières pages, voyez tout le chemin qu’on a traversé ensemble ! Et ce n’est que l’introduction, je ne pensais jamais avoir à écrire autant sur un livre tombé du ciel sans titre ni auteur ni même une couverture. Je ne sais pas vous, mais je trouve cela absolument fascinant. La philosophie qui ressort de ce texte est absolument magistrale, et je pèse mes mots.
Après avoir achevé ce chapitre, je me suis donc reposé un instant. C’était intense mais divertissant. Palatine était revenue sur ses schémas de la veille, les autres travaillaient comme à leurs habitudes. Seulement Pétra était disponible pour qu’on puisse en discuter ensemble. J’ai tenté de lui faire lire ce que j’avais écrit jusque-là. C’était une grande philosophe d’une renommée exceptionnelle, je doutais qu’elle puisse trouver mon écrit d’une si grande qualité. Et pourtant, contre toute attente, elle avait l’air de l’adorer. J’étais réellement tombé sur un ouvrage exceptionnel, et mes analyses étaient très intéressantes d’après ses dires. Je la remerciais chaleureusement, au fond j’étais un peu gêné. Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas reçu d’approbation pour des projets délirants comme celui-ci. Pétra avait cependant l’air de sincèrement l’aimer. Mieux encore, elle voulait en discuter avec moi.
Nous avons ainsi passé les prochaines trois heures assis face à face sur des fauteuils comme avec Palatine la veille (ou plutôt devrai-je dire tôt ce matin, vu l’heure à laquelle nous avions achevé notre débat). Mais cette fois, ce n’était pas une confrontation. Pétra voulait m’aider à formuler un plan concret, à trouver une ligne directrice et à étendre ce début de philosophie de la Lettre de Valinor le plus possible. C’était évident, cet ouvrage méritait bien sûr un tel honneur vu sa qualité surprenante.
Chapitre Sept
Dialogue avec Pétra Scudier ou la complicité d’un projet philosophique ambitieux
La discussion pouvait ainsi commencer. Je devais mettre au clair d’abord mes idées. J’ai commencé par lui parler des termes clés que j’avais identifié jusque-là. Tout d’abord, les plus importants étaient sans aucun doute l’Unité et la pluralité. J’ai rapidement explicité mes trouvailles par rapport à ces deux-là, en expliquant ma théorie de l’emboitement (ce n’est pas vraiment la mienne en fin de compte, je me la suis un peu appropriée). Elle n’était pas non plus championne en mathématiques, mais a parfaitement compris mes idées sur la variance. Ensuite, j’ai enchaîné sur la raison logique et morale. Nous avions mis en évidence ces deux définitions, tout en barrant celle morale d’intervenir dans notre raisonnement pour être plus cohérent dans notre discours. Et enfin, le choc entre science et croyance fut établi. J’ai longuement décrit à Pétra cela, notamment où il s’agissait de la corruption et des deux principes d’un scientifique. Nous en avions faits du chemin, et nous étions lourdement armés pour amorcer un essai philosophique de plusieurs dizaines ou centaines de pages.
Une fois mon discours achevé, Pétra voulu m’applaudir. Ce n’est pas pour me jeter des fleurs, mais cela ne m’arrive pas souvent. On arrive rarement à la cheville d’une telle femme, la dépasser est hors de question. Mais dans tous les cas, je me suis rapproché de manière considérable à cette limite. Elle avait tout compris, et elle trouvait cela fascinant. Même Palatine avait levé l’oreille de l’autre côté de la pièce pour essayer de comprendre. Elle n’était pas très philosophe, cela ne l’intéressât que quelques minutes. Après tout, j’ai eu une complicité avec elle hier soir aussi, il est normal de vouloir garder des nouvelles de ma progression.
Pétra a donc pris la parole, en essayant d’évidence ce qui pourrait être amélioré. Tout d’abord, il manquait beaucoup de structure dans mes idées. Il me fallait une thèse et une antithèse, et pour l’instant je n’avais que quelques bouts pour les former. ¬¬Elle me proposa d’établir un plan en quinconce (sa spécialité) en étudiant d’abord « d’après un autre » soit en donnant raison au scientifique notamment sur les parties concernant la raison. Ensuite, j’aurais pu enchainer sur quelques limites d’après observation extérieure. Je pouvais ensuite faire une transition entre cette partie très textuelle grâce à une approche avec les thèmes de la science et du mysticisme. Enfin, je pourrai lâcher complètement le texte pour m’envoler dans une troisième thèse philosophique sur l’unique et la pluralité. Trois axes, six parties (deux chacun), dix-huit sous-parties (trois pour chaque partie). Pour le dépassement, elle m’a dit que serait une mauvaise idée, car nous partons essentiellement d’un ouvrage. À la place, elle me conseille de rattacher cette philosophie dans une sorte d’uchronie en donnant un autre sens au livre qui n’a jamais été entendu ainsi. Réinventer l’ouvrage, c’est l’objectif qu’elle m’a donné. Et je ne pourrais jamais la remercier autant pour tous ces conseils. Je ne plaisantais pas quand je disais que Pétra était réellement talentueuse.
Nous avions discuté encore plusieurs heures sur comment introduire, comment conclure, les contenus des sous-parties. Nous faisions la dissertation à l’oral, nous deux. Après bien trois heures, je voyais qu’il était bientôt dix-sept heures pile. Il me fallait marcher rapidement en direction de l’Abbaye de Sainte Esther pour la messe du dimanche soir, écrire cet ouvrage m’avait déjà pris plus de vingt quatre heures de ma semaine. J’ai demandé à Pétra si elle voulait venir avec moi, même si je savais qu’elle y était déjà allée ce matin. Elle me répondit oui contre toute attente, en me disant qu’une messe de plus ne ferait de mal à personne. Il fallait bien vingt minutes pour s’y rendre à pied depuis l’Alma, vingt minutes de plus à discuter ensemble de cette fameuse dissertation. Celle-ci allait être probablement ma plus réussie depuis que je suis entré au Salon, et tout cela grâce à Palatine et Pétra.
[Le reste de la discussion et ses détails ne sont pas disponibles dans la version abrégée]
La messe fut enfin terminée, et nous sortîmes de l’abbaye alors que le soleil était toujours assez haut dans le ciel. On approchait le jour le plus long, le solstice d’été, et cela faisait toujours du bien d’avoir de la lumière en plus à ces heures aussi tardives. Nous avions pris garde de discuter pendant la messe, il ne fallait pas déborder autant. Cependant, dès notre sortie, ce fut comme l’ouverture des vannes d’un barrage. Nous avions tous deux pensé à d’autres points pendant le service, ce qui nous donna bien d’autres possibilités de discussions. Tellement qu’on ne les épuisa même pas le temps d’arriver à l’Alma, après avoir acheté un encas. Je n’avais pas mangé depuis longtemps, Palatine m’avait même appelé dès que je suis sorti de la messe pour me rappeler que j’allais mourir de faim tôt ou tard (et aussi pour nous demander de lui acheter un dîner, par ailleurs). C’est ce que nous fîmes, et cela nous donna l’occasion de discuter plus. Nous étions comme deux enfants, deux collègues, un observateur externe aurait dû trouver cela très sympathique à regarder.
Arrivé à l’Alma, le Salon s’était considérablement vidé comme tous les dimanche soir. Il ne restait que Palatine, Pétra et moi. J’avais eu envie un instant de relancer une discussion, cette fois avec Palatine. Mais celle-ci avait besoin d’aide pour un autre de ses projets, l’aide de Pétra. Bon, c’était tant mieux pour moi. Je pouvais me replonger dans mon écriture et me dédier enfin à cette dissertation.
Ne passons plus par quatre chemins comme on le dit. Transposons ce texte, faisons-le évoluer, érigeons-le au stade de chef d’œuvre de la philosophie moderne. Amis, ici commence mon ouvrage pour de bon.
Fin Page1
Posté le : 04 jan. 2025 à 21:57:11
3395
Page 2
Chapitre Huit
De la définition des thématiques abordés ou l’introduction à un essai philosophique sur le questionnement de l’unicité, la croyance et la raison
Le présent chapitre n'est pas disponible dans la version abrégée.
Chapitre Neuf
De l’ordre de la raison ou le premier axe de dialectique philosophique
Le présent chapitre n'est pas disponible dans la version abrégée.
Chapitre Dix
Du parallèle érigé entre science et scientisme ou la croyance comme extension du phénomène philosophique de la raison
Le présent chapitre n'est pas disponible dans la version abrégée.
Chapitre Onze
Discours sur l’Unicité ou la création d’une philosophie nouvelle et révélatrice à travers une construction complexe
Le présent chapitre n'est pas disponible dans la version abrégée.
Chapitre Douze
De la transposition philosophique d’un ouvrage littéraire ou réinventer les fondements principaux d’une écriture possibiliste
Le présent chapitre n'est pas disponible dans la version abrégée.
Chapitre Treize
Des après-propos et remerciements ou la finalité d’une aventure philosophique marquante
Cette aventure a réellement changé ma vie en tant qu’écrivain. En découvrant la Lettre de Valinor, j’ai pu augmenter mon savoir et parvenir à mon but ultime de ramener à la vie des ouvrages de qualités perdus dans les catacombes de l’Alma. J’ai fait relire ma dissertation à Pétra. Celle-ci n’en revenait pas, elle la trouvait sincèrement d’une qualité exceptionnelle. J’eût même droit à des félicitations collectives, même de la part des plus pessimistes, après qu’ils ont lu mes réflexions. J’ai écrit au total presque cent pages, quatre-vingt d’entre elles traitent seulement de la dissertation philosophique. J’ai réussi l’objectif que Pétra m’avait donné. J’ai réinventé la Lettre de Valinor. Et cela a changé la perspective de tous sur le potentiel de débusquer des ouvrages perdus dans les étagères.
Je vais envoyer mon manuscrit à l’imprimerie de l’Alma une fois que cette petite conclusion sera terminée. Normalement, il devrait pouvoir être édité et publié d’ici quelques jours. Je pourrai enfin faire découvrir au monde entier cet ouvrage dont personne ne connaissait l’existence mais que tout le monde a besoin de lire au moins une fois par sa qualité. J’en ferai une version abrégée d’une vingtaine de pages, sans la dissertation mais avec le strict minimum d’analyse pour aider les jeunes dans leur lecture de la Lettre et pour qu’ils comprennent l’absolue beauté de cet ouvrage.
En attendant, je suis descendu dans la salle de la couronne pour y déposer sur un piédestal la copie originale de la Lettre de Valinor que j’avais pioché quelques jours auparavant. Etant un membre du Salon, je pouvais mettre en vedette des livres pendant un certain temps. J’allais m’assurer que celui-ci attire l’attention des plus jeunes. Car c’est aux jeunes qu’il faut enseigner cette discipline. Ceux qui croient que la littérature n’est que lecture se trompent. C’est une aventure à travers les rayons, découvrir le livre qui nous charmera. Même s’il faut visiter les niveaux les plus profonds pour le trouver, cela en vaut mille fois la peine. Et la Lettre de Valinor en est la preuve.
Même après tout ce temps, je ne m’étais pas sérieusement posé la question. Qui l’avait posé là ? Qui l’avait même édité ? Peut être venait il de la salle du réceptacle où l’on range les nouveaux ouvrages des espoirs et jeunes écrivains ? J’ai regardé les archives, aucune trace de ce livre. Rien. Il s’était simplement matérialisé dans l’une des plus grandes bibliothèques du monde. Ou avait-il été placé là pour moi ?
Je ne crois pas au destin. Mais quelle aventure cela fut…
Je remercie avec la plus grande des sincérités Pétra Scudier et Palatine de Rigault pour leurs efforts et leur aide considérable dans la production de ce qui est à ce jour ma plus grande réussite.
M. V.
Fin Page 2
Chapitre Huit
De la définition des thématiques abordés ou l’introduction à un essai philosophique sur le questionnement de l’unicité, la croyance et la raison
Chapitre Neuf
De l’ordre de la raison ou le premier axe de dialectique philosophique
Chapitre Dix
Du parallèle érigé entre science et scientisme ou la croyance comme extension du phénomène philosophique de la raison
Chapitre Onze
Discours sur l’Unicité ou la création d’une philosophie nouvelle et révélatrice à travers une construction complexe
Chapitre Douze
De la transposition philosophique d’un ouvrage littéraire ou réinventer les fondements principaux d’une écriture possibiliste
Chapitre Treize
Des après-propos et remerciements ou la finalité d’une aventure philosophique marquante
Je vais envoyer mon manuscrit à l’imprimerie de l’Alma une fois que cette petite conclusion sera terminée. Normalement, il devrait pouvoir être édité et publié d’ici quelques jours. Je pourrai enfin faire découvrir au monde entier cet ouvrage dont personne ne connaissait l’existence mais que tout le monde a besoin de lire au moins une fois par sa qualité. J’en ferai une version abrégée d’une vingtaine de pages, sans la dissertation mais avec le strict minimum d’analyse pour aider les jeunes dans leur lecture de la Lettre et pour qu’ils comprennent l’absolue beauté de cet ouvrage.
En attendant, je suis descendu dans la salle de la couronne pour y déposer sur un piédestal la copie originale de la Lettre de Valinor que j’avais pioché quelques jours auparavant. Etant un membre du Salon, je pouvais mettre en vedette des livres pendant un certain temps. J’allais m’assurer que celui-ci attire l’attention des plus jeunes. Car c’est aux jeunes qu’il faut enseigner cette discipline. Ceux qui croient que la littérature n’est que lecture se trompent. C’est une aventure à travers les rayons, découvrir le livre qui nous charmera. Même s’il faut visiter les niveaux les plus profonds pour le trouver, cela en vaut mille fois la peine. Et la Lettre de Valinor en est la preuve.
Même après tout ce temps, je ne m’étais pas sérieusement posé la question. Qui l’avait posé là ? Qui l’avait même édité ? Peut être venait il de la salle du réceptacle où l’on range les nouveaux ouvrages des espoirs et jeunes écrivains ? J’ai regardé les archives, aucune trace de ce livre. Rien. Il s’était simplement matérialisé dans l’une des plus grandes bibliothèques du monde. Ou avait-il été placé là pour moi ?
Je ne crois pas au destin. Mais quelle aventure cela fut…
Je remercie avec la plus grande des sincérités Pétra Scudier et Palatine de Rigault pour leurs efforts et leur aide considérable dans la production de ce qui est à ce jour ma plus grande réussite.
M. V.
Fin Page 2
Posté le : 25 jan. 2025 à 17:56:50
2393

L'inquiétude monte face à l'armement de Valinor et aux mouvements militaires entre Valinor et Ambar
Ces images témoignent du renforcement de la coopération militaire entre Valinor et Ambar alors que Verdar multiplie les livraisons d'équipements militaires envers ses partenaires et voisins et désormais envers Tirgon. Elles démontrent l'augmentation de la production d'armes et d'équipements et le renforcement mutuel de ces deux armées au voisinage direct de Tanska. Un tel équipement dépasse aussi très largement ceux en dotation dans les forces armées valinoréennes qui ne dispose que d'une industrie restreinte et peu capable.
En échange, Verdar recevrait de son partenaire des livraisons de matériaux et de ressources dont l'industrie serait très consommatrice. Ce renforcement doit amener à un possible renforcement des mesures sécuritaires dans les régions centrales selon le gouvernement qui cherche encore à comprendre les décisions politiques prises à Tirgon visant à provoquer cette hausse de tension.
"Si le matériel livré reste encore loin de fournir à Valinor des capacités terrestres dignent de ce nom, il s'agit là d'un premier pas vers un armement bien plus large mais aussi bien plus menaçant. La prochaine étape pourrait constituer en la livraison de blindés, de pièces d'artilleries sinon de génie militaire. Une telle livraison ne serait qu'un signe néfaste que Valinor se prépare à la guerre. Contre qui, cela est la question, mais ces voisins sont limités, et nous sommes l'un d'eux."
Selon le renseignement tanskien, l'Empire ambarrois produirait actuellement plusieurs centaines de blindés dont la destination pourrait être Valinor.

Posté le : 08 mars 2025 à 11:14:04
5137
Camarades Secrétaire Général, un message des services diplomatiques de la Nation !
Le jeune auxiliaire qui venait de débouler dans le bureau de Lorenzo avait presque hurlé, en effectuant sa mise au garde à vous. Ce n'était pas souvent qu'on avait l'occasion de transférer un message au Camarade Secrétaire Général, et il adorait ce travail, en dépit des histoires qu'il avait entendu.
Je t'écoute.
Lorenzo regardait pas la fenêtre, les mains dans le dos, l'air pensif.
Les services diplomatiques de la Nation disent : l'Empereur Valinoréen est mort aujourd'hui aux alentours de 18 heures. En attente d'instructions.
Lorenzo tourna imperceptiblement la tête. Puis se dirigea vers son bureau.
Bien ! Transmettez ceci à L'État-Major.
Plan Trône Pourpre lancé. Initiatives delta-20 et delta-25 à initier immédiatement. Si nécessaire, initier la procédure PO-1.
Ordres à exécuter dès la réception du message. Classification argenté. Terminé.
Et, bien entendu, pour les services diplomatiques : dites leur de me laisser gérer. Exécution immédiate.
Le jeune auxiliaire partit, courant, prêt à livrer son message. Les mots prononcés quelques jours plus tôt prenaient leur sens.

Lieu de l'opération : République Populaire et Sociale d'Illirée
Type d'opération : Déploiement rapide, sécurisation de territoires.
Objectifs de l'opération :
- Parvenir à se déployer rapidement et efficacement sur le territoire Illiréen;
- Sécuriser le plus rapidement et efficacement possible les zones sous contrôle Illiréen;
- Retrouver le contrôle sur les zones qui ne seraient pas contrôlés par le pouvoir Illiréen;
- Développer une force de défense et de dissuasion locale permettant la protection directe du pouvoir Illiréen.
- 15 000 soldats professionnels
- 2 500 soldats réservistes
- 2 500 armes légères d'infanterie de 10ème génération
- 5 000 armes légères d'infanterie de 9ème génération
- 7 500 armes légères d'infanterie de 5ème génération
- 2 500 armes légères d'infanterie de 2ème génération
- 500 mitrailleuses lourdes de 3ème génération
- 200 mortiers légers de 7ème génération
- 1 000 lance roquettes de 2ème génération
- 100 lance-missiles antichar de 2ème génération
- 50 canons tractés de 2ème génération
- 20 canons automoteurs de 5ème génération
- 25 canons automoteurs de 1ère génération
- 10 lance roquettes multipes de 1ère génération
- 10 véhicules blindés légers de 1ère génération
- 50 transports de troupes blindés de 2ème génération
- 100 véhicules de combat d'infanterie de 2ème génération
- 40 chars légers de 1ère génération
- 20 chars d'assaut de 1ère génération
- 20 véhicules légers tout terrain de 2ème génération
- 50 camions de transport de 2ème génération
- 10 camions citernes de 5ème génération
- 5 camions citernes de 2ème génération
- 5 camions citernes de 1ère génération
- 2 bulldozers de 1ère génération
- 1 pont mobile de 1ère génération
- 2 chars de dépannage de 1ère génération
- 10 véhicules de transmission radio de 2ème génération
- 10 véhicules radar de 2ème génération
- 10 avions de chasse de 5ème génération
- 20 avions de chasse de 4ème génération
- 10 chasseurs bombardiers de 1ère génération
- 10 avions d'attaque au sol de 6ème génération
- 1 bombardier furtif de 1ère génération
- 3 avions de ligne de 1ère génération
- 10 avions de transport tactique de 1ère génération
- 10 avions ravitailleurs de 1ère génération
- 1 avion radar de 2ème génération
- 1 avion de guerre électronique de 1ère génération
- 2 appareils de transport hybride de 1ère génération
- 1 drone de reconnaissance de 1ère génération
Elles empruntent un couloir aérien préalablement sécurisé par les forces aériennes de combat Loduariennes, qui elles sont parties à 18 heures et 15 minutes.
Pendant toute la durée de l'opération par le même couloir aérien sera emprunté.

À 18 heures 15, les forces aériennes de combat Loduariennes décollent pour sécuriser le couloir aérien qui sera emprunté par les forces logistiques aériennes Loduariennes.
Les forces de combat sont composés de :
- 10 avions de chasse de 5ème génération
- 10 chasseurs bombardiers de 1ère génération
- 1 avion radar de première génération
- 2 avions ravitailleurs en retrait.
Note ultérieure :
La réserve au sol est composé de :
- 75 lance-missiles antiaériens de 7ème génération
- 10 avions de chasse de 6ème génération
- 10 avions de chasse de 4ème génération
- 10 chasseurs bombardiers de 4ème génération
Posté le : 09 mars 2025 à 12:18:09
1405
Déclaration publique du Gouvernement de la Nation Communiste de Loduarie et de son État-major, publié en la date du 03/01/2016.
En la date du 2 janvier à 18 heures et 05 minutes, la Nation Communiste de Loduarie a reçu un message d'urgence en provenance de son partenaire Illiréen.
Le message stipulait que : l'Empereur avait été assassiné ignoblement dans un attentat, commis par un groupe politique hostile au pouvoir et déjà inculpé de nombreux crimes similaires par le passé. Les autorités Illiréennes compétentes ont donc, considérant les risques qu'un tel événement pourrait avoir et pour éviter une déchaînement des forces terroristes du du groupe politique "Parti Absolutiste", décidé de demander de l'aide à la Loduarie, ce à quoi nous avons répondu favorablement. Un couloir aérien a été mis en place à 18 heures et 15 minutes, et un premier envoi de troupes d'urgence a été réalisé à 18 heures et 45 minutes après leur préparation en urgence. Les pays avoisinants ont étés prévuenus du passage de notre aviation dans les 2 à 5 minutes précédant son passage, considérant l'urgence de la situation.
Nos forces resteront à Valinor le temps qu'il faudra pour voir le pays sécurisé et protégé d'hypothétiques forces extérieures voyant là une possibilité de s'ingérer dans la politique Illiréenne. Nos forces en présence au sein de l'Illirée seront agrandies en fonction de la menace, du temps et de nos moyens.
La Nation Loduarienne annonce formellement que le lancement de l'opération "Trône Pourpre" a été initié en urgence à la demande expresse de la République Populaire et Sociale Illiréenne.
En la date du 2 janvier à 18 heures et 05 minutes, la Nation Communiste de Loduarie a reçu un message d'urgence en provenance de son partenaire Illiréen.
Le message stipulait que : l'Empereur avait été assassiné ignoblement dans un attentat, commis par un groupe politique hostile au pouvoir et déjà inculpé de nombreux crimes similaires par le passé. Les autorités Illiréennes compétentes ont donc, considérant les risques qu'un tel événement pourrait avoir et pour éviter une déchaînement des forces terroristes du du groupe politique "Parti Absolutiste", décidé de demander de l'aide à la Loduarie, ce à quoi nous avons répondu favorablement. Un couloir aérien a été mis en place à 18 heures et 15 minutes, et un premier envoi de troupes d'urgence a été réalisé à 18 heures et 45 minutes après leur préparation en urgence. Les pays avoisinants ont étés prévuenus du passage de notre aviation dans les 2 à 5 minutes précédant son passage, considérant l'urgence de la situation.
Nos forces resteront à Valinor le temps qu'il faudra pour voir le pays sécurisé et protégé d'hypothétiques forces extérieures voyant là une possibilité de s'ingérer dans la politique Illiréenne. Nos forces en présence au sein de l'Illirée seront agrandies en fonction de la menace, du temps et de nos moyens.
La Nation Loduarienne annonce formellement que le lancement de l'opération "Trône Pourpre" a été initié en urgence à la demande expresse de la République Populaire et Sociale Illiréenne.
Posté le : 09 mars 2025 à 15:59:59
2691
7 janvier 2016
Le Califat constitutionnel exprime sa sollicitude et présente ses condoléances aux familles et aux proches des victimes, aux partis politiques des victimes, et au peuple valinoréen en général. Aucune cause politique ne saurait justifier le recours à la violence contre des personnes désarmées, et avec des méthodes qui frappent indistinctement les innocents. Les auteurs de ce crime seront, sans aucun doute, retrouvés par les autorités de Valinor, et l'Azur souhaite qu'ils soient jugés à la mesure de leur crime, dans le respect des lois démocratiques du pays. L'Azur se réjouit que des suspects aient été appréhendés et que l'enquête ait pu être diligente ; ces suspects ont proclamé leur innocence. La suspicion pesant sur un certain parti politique doit cependant être étayée par des preuves tangibles et amener des juges indépendants à formuler un jugement adéquat pour que soit caractérisée, ou pas, la culpabilité des suspects dans les actes qui leur sont reprochés. L'implication de représentants politiques dans une affaire criminelle ne saurait être négligée par tous les défenseurs de la justice en politique, qu'il s'agisse de l'Azur ou a fortiori de tout pays membre de l'Union Economique Eurysienne.
A la suite de ce drame, et après la publication des résultats électoraux, des changements politiques importants ont eu lieu à Valinor. L'Azur s'inquiète que ces changements soient conformes au droit valinoréen dans la mesure où l'un des partis politiques ayant obtenu une représentation parlementaire significative il y a moins d'une semaine est dans le même moment immobilisé pour des raisons judiciaires. Ce fait suffit à affaiblir la sincérité démocratique des changements survenus, alors que plusieurs sources informelles rapportent que les nouvelles autorités valinoréennes ont sollicité un appui matériel sécuritaire de la part de l'Etat de Loduarie, qui n'est pas un Etat démocratique.
L'Azur formule le voeu que les nouvelles autorités valinoréennes parviennent sans encombre à restaurer la sécurité et la confiance au sein du pays, et à ce que la justice soit rendue avec impartialité et adéquation, en mémoire des victimes de l'horrible attentat du 2 janvier 2016. Par ailleurs, l'ambassade d'Azur à Targon confirme que les lois du Califat constitutionnel protègent le droit d'asile, qui est accordable à tous ceux qui sont inquiétés pour leurs opinions politiques ou orientations personnelles dans leur pays d'origine. Relevant de la juridiction azuréenne, ce droit s'applique dans les bâtiments de l'ambassade, dont l'intégrité ne saurait être remise en cause.
En l'état actuel des choses, l'Azur appelle ses ressortissants sur place à limiter leurs déplacements dans le pays et, le cas échéant, à solliciter l'appui d'Agatharchidès pour mettre en oeuvre leur rapatriement immédiat à Agatharchidès.
Posté le : 05 avr. 2025 à 17:56:37
Modifié le : 20 août 2025 à 23:50:45
3701

Communiqué officiel du comité central du Parti Eurycommuniste velsnien, 28 mars 2016
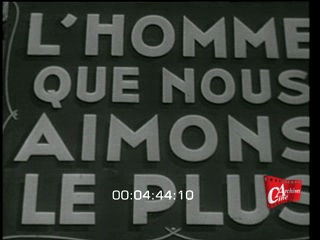
La terrible nouvelle et le grand malheur viennent se jour frapper tous les peuples libres, et les travailleurs du monde entier, par l'annonce du décès de notre cher et grand camarade Lorenzo, secrétaire général de la Loduarie Communiste, ce 28 mars 2016. Le peuple héroïque de la Loduarie Communiste et son gouvernement venant nous apprendre la triste nouvelle de la disparition du grandiose bâtisseur du loduarisme, de la figure la plus importante de l'eurycommunisme du XXIème siècle.
Tout d'abord, par ces mots, nous nous adressons en premier lieu au peuple loduarien, de la part de tous les exploités, de tous les écrasés, de tous les sans-rien, qui ont porté sa figure comme étendard d'une société résolument nouvelle et révolutionnaire.
Une peine immense emplit nos cœurs. En cette journée cruelle de deuil universel, nous assurons au peuple loduarien de notre fraternelle et indéfectible solidarité. Tous les travailleurs de Velsna, et tout le peuple de Velsna, tous les vrais camarades, tous les vrais amis de la paix universelle et de la République de l'amour humain partagent une même douleur. Pour tous les exploités de la classe ouvrière velsnienne, le camarade Lorenzo, malgré sa mort, ne cessera jamais, ô grand jamais, d'être perçu par tous les velsniens comme un grand artisan d'une société alternative et belle: celle du socialisme.
Nous rendons hommage à celui qui, en 2001, a allumé une étincelle d'espoir dans une Loduarie alors rongée par une junte militaire fasciste. Qui parmi les opposants de ce grand homme aiment à rappeler à quoi ressemblait la Loduarie avant l'ascension au pouvoir du camarade Lorenzo ? Qui parmi les nations capitalistes osera omettre que durant ces quinze années de mandat, ce grand libérateur des peuples s'est contenté de gouverner sur un qtatut-quo ? Non. La Loduarie communiste, nous pouvons le dire, a permis à des millions de travailleurs de sortir de la misère et de l'analphabétisme. Lorenzo a récupéré une Loduarie roulant à la charrue, et il la laisse aujourd'hui avec l'un des plus grands parcs nucléaires du monde, avec un réseau routier et ferré modernisé, avec des logements gratuits pour tous les travailleurs.
Et cette étincelle qui s'est allumée en Loduarie en 2001 a eu tôt fait de devenir un grand feu de joie, car le camarade Lorenzo ne se serait jamais contenté de libérer un seul pays: il fallait émanciper toujours plus de peuples, libérer toujours plus de travailleurs. Nous n'oublierons jamais l'action du secrétaire général en faveur du bonheur et de la libération des peuples: en Okaristan, en Translavye, et partout où le drapeau de la Révolution prolétarienne a été planté, tantôt avec succès, tantôt avec regret.
Le nom de Lorenzo illumine de sa resplendissante clarté le chemin à suivre pour réaliser le plus grand rêve de l'humanité: le chemin du communisme ! Nous, membres du comité central du Parti Eurycommuniste Velsnien, que nous saurons puiser dans la vie et l’œuvre du camarade Lorenzo, dans la clarté de ses perspectives révolutionnaires, dans l'audace et le caractère concret de ses directives, dans sa liaison constante avec les masses laborieuses, des forces chaque jour renouvelées, pour en suivant la trace du camarade secrétaire, être dignes du qualificatif de "loduariste".
Les eurycommunistes velsniens sauront rester fidèles aux principes loduaristes, contre les déviations de la ligne telle qu'édictée par le camarade Lorenzo, réaffirmant sans cesse la fermeté de notre tâche de libération et d'émancipation du genre humain. Nous prenons acte, par ta mort, camarade Lorenzo, su rôle fondamental de tous les partis frères dans l'apport aux masses laborieuses de la formation nécessaire à la lutte pour leurs droits.
Camarade Lorenzo, nous te disons adieu: ami de tous les travailleurs, de tous les opprimés, de tous les laissés pour compte. Tu as fait honneur à la quête du paradis socialiste, et nous tous, ouvriers de tous les pays: velsniens, loduariens, estaliens, translaves, qu'ils soient dans le monde socialiste ou capitaliste, nous reprendrons le drapeau.
Ta mémoire vivre dans nos actes, tes enseignements éclaireront toujours notre route. Nous ne cesserons jamais d'aller de l'avant, vers le communisme.
Posté le : 16 avr. 2025 à 21:17:34
1771

Discours prononcé par le PDG de la société Rhédie Airline
Chers illiréens,
Pourquoi vous limitez vous à votre pays, si vous avez la possibilité de voyager dans notre beau pays.
Ou pourquoi pas en Teyla, faites de vos plus beaux rêves de voyage une réalité !
Nos avions sont les ailes de votre liberté, et ces paroles en sont la clé. Je suis ici pour vous libérer de votre prison. Allez-y, visitez les abruptes falaises velsniennes !
Mais ce n'est pas tout ! Nos vols de lignes sont certes très satisfaisants, mais depuis quelque temps, c'est notre secteur militaire qui est en pleine expansion.
Un écran géant s'illumina dans la salle de conférence. Un avion de chasse prit forme parmi tous les pixels qui composaient l'écran.
Désormais, notre groupe s'organise pour mieux défendre notre nation.
Face aux nouvelles avancés militaires des grandes puissances, nous nous devons d'aider notre nation à elle aussi aller de l'avant. La Rhédie, autre fois risée des armées mondiales, va désormais révolutionner sa défense pour reprendre du poil de la bête.
Pour ce faire, il nous faut des gros moteurs bourrés de pétrole et des mitrailleuses remplie de poudre !
Alors on a fait fonctionner notre matière grise, et on a pondu ce petit bijou : le TF-P1 (Team Fighter Prototype One).
Muni de ses canons dernière générations, il perce les carlingues des ennemis en mille morceaux. Comme son nom l'indique, il est fait pour combattre en équipe, généralement constitué de trois à cinq TF-P1.
Ils seront plus souvent déployés pour des missions de soutien des troupes terrestres, par exemple en terrain difficile à parcourir, tel que des montagnes ou encore en haute mer.
Pour des missions tactiques, il sera plus souvent accompagné d'un TB-P3. C'est un bombardier de même carrure qu'un TF-P1, pouvant accueillir seulement trois bombes légères.
Cette formation (trois TF-P1 et un TB-P3), est souvent utilisée pour neutraliser un point stratégique ennemi.
Grâce à ces nouveaux avions, notre nation à de quoi, je pense, redorer son blason.
Merci bien de m'avoir écouté,
À bientôt
