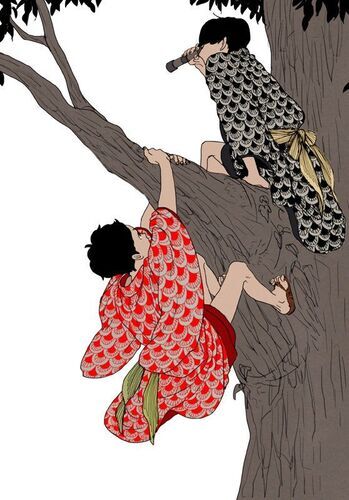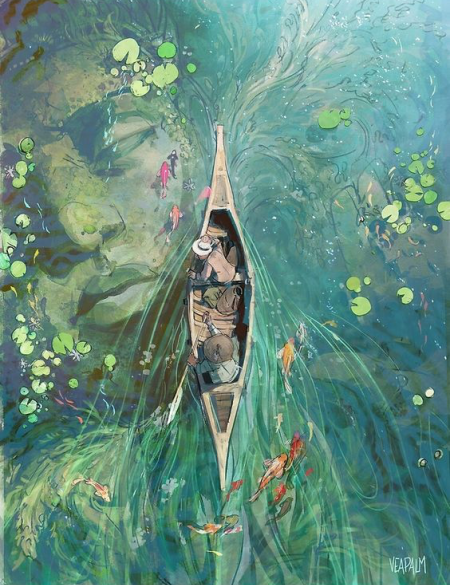Petite histoire d’Uminomon :
Uminomon est un ancien comptoir fondé par des eurysiens pour le commerce avec les tribus autochtones-maronhos, celui-ci est rasé en 1531 par les samouraïs explorateurs burujois. Cette destruction, peu commune dans les usages burujois, a été faite pour saper le moral des eurysiens présents en Maronhi et grandement limiter leurs capacités de ripostes ultérieures. Avec les années, la colonie d'Uminomon, littéralement la "porte des océans", se construit, s'enrichissant de la pêche et du commerce avec les territoires de l'Empire Burujoa. Entre la fin du XVIe et XVIIe siècles, des missionnaires catholiques originaires de Cendane y établissent illégalement le premier foyer chrétien et catholique de Maronhi en période de domination burujoise. Le jōshu du château de la colonie devient également le premier daimyo à se convertir au christianisme, ce qui lui vaudra des sanctions du pouvoir impérial et des offensives des autres daimyos de la Péninsule du Couchant. Reprise en main par le pouvoir impérial burujois avec l'aide des seigneurs locaux, la colonie ouvre bientôt son port, avec un accord express de l'empereur, aux marchands étrangers. Elle restera seule dans ce cas jusqu'à la période dite des "Provinces combattantes". Sous le Shogunat Susano, puis sous la Première république, alors que le port s'agrandit en raison d'une relative libéralisation des échanges, un autre port est construit, cette fois-ci purement militaire. Il restera jusqu'à aujourd'hui le plus grand arsenal de Maronhi. À l'image de Siwa et de nombreuses cités côtières, Uminomon ne bascula dans le camp des insurgés qu'en 1962, à la veille de la fin de la guerre civile.
Uminomon aujourd’hui :
Comme dit précédemment, Uminomon est le principal arsenal naval de la République de Maronhi où stationnent la majorité de la flotte lourde, de surface, de la Marine maronhienne. L’arsenal est historiquement situé à proximité immédiate du centre ville d’Uminomon pour diverses raisons, comme la proximité des marchands pour le ravitaillement en vivres des navires ou la proximité des habitations des marins lorsque les bateaux sont à quai. L’arsenal touche le port traditionnel et artisanal d’Uminomon principalement tourné vers le cabotage fluvial et la pêche côtière. Toutefois, depuis les années 1960, un port de commerce en haut profond a été construit à quelques kilomètres du centre ville, directement sur le littoral. Ce nouvel aménagement a été privilégié à l’agrandissement du port historique pour faciliter les opérations de dragage des chenaux et ainsi permettre l’accès des plus gros navires, pour éviter le passage de navires étrangers à proximité immédiate de l’arsenal mais aussi pour les grands espaces de fonciers terrestres disponible pour l’aménagement de la plateforme portuaire. Aujourd’hui, Uminomon est le plus grand port de commerce de la Maronhi et un des plus grands du Paltoterra et devrait conforter sa place dans les années à venir grâce aux nombreux travaux financés et effectués par l’Empire Burujoa.

L’explosion du trafic portuaire :
A la faveur du très grand réchauffement des relations burujo-maronhienne, les échanges commerciaux entre l’Empire et l’ancienne colonie n’ont cessé de se développer, de manière exponentielle. En l’espace de quelques années, le trafic maritime entre les ports du Burujoa, en premier lieu celui de JinCity à Cendane et les ports de Maronhi est passé de 3 mouvements quotidiens, soit environ 1.095 trajets aller-retour à plus de 15 mouvements quotidiens, soit environ 5.475 trajets en 2011. A l’horizon 2015, les autorités portuaires burujoises s’attendent à plus de 10.000 départs de bateaux depuis les ports de l’Empire vers la République. Du côté du Burujoa, cette explosion du trafic est mieux absorbée qu’en Maronhi, les départs autrefois presque tous au départ de JinCity sont mieux répartis dans tout l’Empire avec en particulier des départs des ports d’Okukonai et du Xinemane. Alors qu’en Maronhi, presque tout le trafic est absorbé par le port d’Uminomon, ce qui n’est pas sans conséquence. Si le trafic en nombre de mouvements de navires a été multiplié par 5 en 5 ans, le volume a lui été multiplié par 7 sur la même période, traduisant qu’en plus de l’augmentation du nombre de liaisons, les navires sont plus gros qu’auparavant. Par ailleurs, le trafic passagers autrefois inexistant se développe progressivement avec la création d’une ligne de ferry maritime entre Uminomon et Karaimu, proposant 3 départs par semaine pour environ 187.000 passagers par an et 98.000 véhicules. Le trafic n’a pas augmenté que vers le “papa” Burujoa, il a augmenté vers le monde entier. Par ailleurs, les exportations ont surtout été portées par les produits alimentaires, le bois et les minérais quand les importations se font principalement sur les produits manufacturés, les hydrocarbures et les composants électroniques.
Les aménagements burujois :
Pour accompagner cette explosion du trafic dans les ports de Maronhi, moins bien absorbés qu’au Burujoa, l’Empire a massivement investi dans les ports de la République, en particulier celui d’Uminomon. Pour se faire, le Département des Affaires Étrangères a fait d'importants dons aux différents consortiums possédant les ports maronhiens, mais bien évidemment les dons les plus importants se sont tournés vers le consortium d’Uminomon. Les différentes composantes du consortium, les za et les machiya, possédaient, avant les dons 7 et 8 sièges au conseil de gestion du port. Au fur et à mesure des dons et des travaux, les autorités consulaires burujoises ont obtenu 3, puis 5 et enfin 10 sièges au conseil de gestion, sans pour autant avoir supprimé les sièges des za et machiya.
Le Burujoa a presque totalement “reconstruit” le port d’Uminomon datant des années 1960. Avant le remaniement général, le port comptait une section “300” comportant un quai principal de 370 mètres de long et 2 quais annexes de 270 et 70 mètres construit durant les années 1960. Durant les années 1970, une section “600” est aménagée comprenant un quai de 640 mètres de long pouvant accueillir des navires de 200.000 tonnes. Le premier aménagement financé par le Burujoa est la reconstruction totale de la section 300 aux derniers standard modernes, avec des quais en béton armé, des portiques semi automatisé et un canal plus profond, réalisé entre 2009 et 2011. L’année suivante c’est au tour de la section 600 d’être reconstruite entre 2010 et 2012.
Parallèlement à cela, de nouvelles sections ont été aménagées, tout d’abord un port céréalier tourné vers le riz, le quinoa, le manioc, l’igname et autres céréales produites localement. Ce terminal complet compte notamment 3 quais capables d’accueillir des navires de n’importe quel gabarit mais également 4 hangars capables de stocker 145.000 tonnes de céréales chacuns. Une section de vracs liquides a également été entièrement financée par le Burujoa pouvant expédier ou importer 4 millions de tonnes de liquide. Enfin, l’Empire a financé la réhabilitation des fleuves et rivières permettant la desserte du port. Par ailleurs, les autorités consulaires ont soumis plusieurs projets aux autorités maronhiennes sur la création de voies terrestres pour une meilleure desserte du port.