-1700 : début de l'expansion militaire de ce qui deviendra l'Empire Mazaticuéen
-1622 : fondation officielle de l'Empire du Mazaticue
-778 : premier contact entre les civilisations akaltienne et sakkin par l'annexion du territoire de cette dernière
-70 : fin de l'occupation du territoire sakkin par l'Empire Mazaticuéen
Ier siècle de notre ère : expansion des mazaticuéens dans les îles alguarenos
931 : conquête et destruction de la cité de Yumcab par les autres cités akaltiennes
1651 : début de la Guerre d'Or, ou Période Sombre
1665 : fin de la Guerre d'Or et victoire face aux colons teylais, début de l'âge d'or économique et scientifique akaltien
1811 : fin de la Guerre de Sakkins, création du Protectorat de la Terre-de-l'autre-côté-du-Détroit
1859 : début de la Guerre de la Souveraineté, opposant les quatre grandes cités akaltiennes
1861 : fin de la Guerre de la Souveraineté et fondation de l'Union des Cités d'Akaltie (unification définitive du pays)
1865 : début de la Guerre des Sauveurs, grâce à laquelle l'Akaltie libère l'Uuqtinut des autorités post-coloniales d'origine kaulthe
1868 : fin de la Guerre des Sauveurs et fondation de la République Native d'Uuqtinut avec l'aide de l'Union des Cités
1870 : fondation de la Nouvelle-Kintan
1873 : l'Akaltie donne officiellement son indépendance à la Nouvelle-Kintan
1896 : guerres dans les îles de Nellnely-Nacuot et Kamaltapente, résultant sur l'annexion des îles de Nacuot par l'Akaltie, du Kamaltapente par la Yukanaslavie et d'une partie de l'île de Nellnely par le Grand Kah
1899 : début de la guerre d'indépendance au Chandekolza, soutenue par l'Akaltie
1903 : début de la guerre d'indépendance anaistésienne, soutenue par l'Akaltie
1907 : fin de la guerre d'indépendance anaistésienne
1915 : départ des dernières troupes akaltiennes du Chandekolza, indépendance totale du pays
1919 : fondation de la Ligue Anticoloniale Akaltienne par l'Akaltie ; l'Uuqtinut, le Chandekolza et la Nouvelle-Kintan y prennent part
1923 : l'Anaistésie rejoint la Ligue Anticoloniale
1943 : retour de l'Akaltie dans l'isolationnisme quasi-total
1986 : abolition de la peine de mort
2012 : signature du Traité de Kopip, sur l'amitié stéruso-akaltienne, l'Akaltie participe à la Conférence d'Elysium et rejoint la Coopération Aleucienne des Nations
2013 : signature du Traité de Barba et fondation par l'Akaltie et trois autres nations de l'Alliance pour la Sécurité Économique Aleucienne
2014 : dissolution du Parlement des Cités, remplacé par le Nouveau Parlement des Cités, implication de l'Akaltie dans l'indépendance des Républiques Etznabistes
2015 : changement du nom de la Ligue Anticoloniale Akaltienne en Empire Anticolonial Akaltien, proclamation de l'Empire des Cités d'Akaltie (début de la crise impérialo-unioniste)
2016 : fin de la crise impérialo-unioniste avec la fusion en l'Union et Empire des Cités d'Akaltie



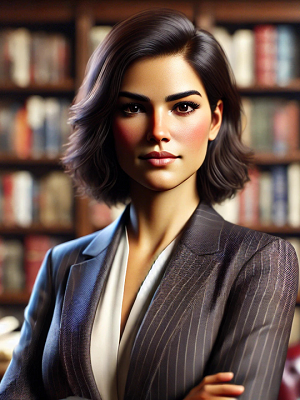


 Ligue de l'Ekliz
Ligue de l'Ekliz









