Posté le : 03 mai 2025 à 00:16:18
8676
Du "Mouvement du Crépuscule" à l'Intégration : La gauche institutionnelle teylaise a-t-elle oublié la Lutte des Classes ?.
Source : Revue Internationale d'Histoire Sociale et Ouvrière
Auteur : Dr. Elias Vancek (Historien spécialisé, implanté à Commune-Ville Libre)
Le Royaume de Teyla se présente aujourd'hui sur la scène internationale comme un modèle de stabilité monarchique et de prospérité économique libérale. Ses dirigeants vantent une croissance soutenue, une intégration réussie dans les structures mondiales comme l'Organisation des Nations Démocratiques (OND), et une société technologiquement avancée. Pourtant, derrière cette façade rutilante, une analyse historique des mouvements sociaux et politiques révèle une trajectoire complexe et, pour la gauche radicale, profondément décevante. L'histoire de la gauche teylaise est celle d'une domestication progressive, d'un renoncement à la lutte des classes au profit d'une intégration dans un système fondamentalement inégalitaire, que l'on pourrait qualifier de "monarcho-libéral". Des premiers soulèvements ouvriers du "Mouvement du Crépuscule" à la social-démocratie gestionnaire du Mouvement Royaliste et d'Union (MRU) actuel, le chemin parcouru semble avoir éloigné la gauche institutionnelle de ses racines combatives. Dans ce contexte, l'émergence de forces nouvelles comme Avenir du Peuple (A!) pose une question cruciale : assistons-nous à un possible retour aux sources radicales, adaptées aux défis du XXIe siècle ?
L'histoire ouvrière teylaise commence dans l'ombre et la répression. Le "Mouvement du Crépuscule", né dans les années 1880 de la misère des mines de charbon et de l'exploitation industrielle naissante, témoigne d'une conscience de classe précoce. Des réunions secrètes aux actes de sabotage contre l'outil de production, ces premières luttes, bien que désorganisées, portaient en elles une critique fondamentale du système. La légalisation tardive des syndicats en 1902, arrachée après des événements tragiques comme le massacre de la mine "Bernard & Charles", et les "Grandes Grèves" du début du XXe siècle marquent l'apogée de cette conflictualité. La Confédération et Union des Ouvriers (CUO) et sa branche politique naissante, Uni par la Gauche (UG), incarnaient alors une force capable de défier le pouvoir patronal et étatique, comme en témoigne la chute du gouvernement Lavoile en 1912 suite à la grève générale contre la Guerre des Bwrs. Les revendications étaient claires : réduction du temps de travail, fin du travail des enfants, dignité ouvrière. C'était une lutte frontale, une affirmation de la classe ouvrière comme sujet historique.
Cependant, même ces victoires portaient en elles les germes de la modération future. En obtenant la reconnaissance légale et quelques améliorations matérielles, le mouvement ouvrier institutionnel commençait, peut-être inconsciemment, à accepter les règles du jeu imposées par l'État monarchique et l'économie capitaliste naissante.
Le milieu du XXe siècle marque un tournant décisif. La base militante de la CUO s'érode, tandis que l'idéologie social-démocrate gagne du terrain au sein de l'UG. La scission de 1942 et la transformation en Rassemblement Pour la Gauche (RPG), avec l'épuration des éléments communistes, symbolisent cette rupture. Le RPG choisit la voie parlementaire et la respectabilité institutionnelle. La crise de 1948 est, de ce point de vue, révélatrice. Face à la menace de l'extrême-droite et à l'assassinat de son leader François Clément, la gauche, plutôt que d'appeler à une rupture révolutionnaire, choisit de soutenir l'intervention de la monarchie (Catherine II) et de participer activement à l'élaboration de la nouvelle constitution. Certes, cette constitution renforce les aspects démocratiques, mais elle sanctuarise la monarchie et le cadre capitaliste. La gauche devient "royaliste", un oxymore politique qui signe son intégration définitive au système.
Les mandats de Rose Mivèrgne (1958-1970), bien que marqués par des avancées sociales indéniables (allocations chômage, début de politique du logement), s'inscrivent dans une logique de gestion et d'aménagement du capitalisme, non de son dépassement. La réponse timide à la crise économique de 1966 montre les limites de cette approche : face aux secousses du marché, le gouvernement RPG choisit l'austérité plutôt que la confrontation avec le capital. L'État-providence teylais naissant ressemble davantage à un filet de sécurité pour maintenir la paix sociale qu'à un outil de transformation radicale.
L'arrivée au pouvoir de Pierre Lacombe et de son Rassemblement Pour la Royauté (RPR, ancêtre des Royalistes actuels) en 1980 inaugure une ère de contre-réformes néolibérales brutales. Dérégulation, privatisations (même si Teyla a une histoire limitée de nationalisations), affaiblissement du droit du travail, coupes dans les aides sociales : l'agenda est clair et vise à démanteler les quelques acquis sociaux antérieurs et à renforcer le pouvoir du capital.
Face à cette offensive, le Mouvement Royaliste et d'Union (MRU), né en 1976 de la mue définitive du RPG, apparaît largement impuissant. Malgré des mobilisations sociales et une opposition parlementaire, il ne parvient pas à bloquer les réformes structurelles. Le Congrès de Cielazur en 1992, tentative d'union de la gauche royaliste, montre déjà les limites de la stratégie : on cherche un programme commun pour gagner les élections dans le cadre existant, pas pour renverser le système. L'objectif est devenu l'alternance, la gestion, et non plus la transformation sociale. Le MRU, bien que critiquant Lacombe, accepte implicitement les fondamentaux de l'économie de marché libérale.
Le retour au pouvoir du MRU avec Florence Gaillard puis Angel Rojas (depuis 2012) n'a pas fondamentalement changé la donne. Certes, la période du "Grand Versement" a vu une amélioration du niveau de vie grâce à la croissance et à une politique budgétaire plus expansive. L'accès aux biens de consommation (technologies, culture) s'est démocratisé. Mais cette prospérité s'est construite sur les bases néolibérales consolidées par Lacombe et sur une intégration croissante à l'économie mondialisée (adhésion implicite ou explicite aux logiques de l'OND, de l'Espace Noor(d)croen).
La politique du gouvernement Rojas, bien que teintée d'un vernis social (Loi Cheval sur la cohésion sociale, aides au logement), reste fondamentalement ancrée dans le paradigme libéral. On cherche à "corriger les excès" du marché, à "accompagner les transitions", mais jamais à remettre en cause la propriété privée des moyens de production ou la logique de profit. La focalisation sur l'innovation technologique (Manticore 2030, 5G) et la compétitivité internationale (soutien aux exportations, recherche de partenariats type Drovolski) montre que l'objectif reste l'insertion de Teyla dans la compétition capitaliste mondiale, et non la construction d'une alternative. L'État teylais sous le MRU est devenu un gestionnaire efficace du capitalisme national, saupoudrant quelques mesures sociales pour maintenir la paix, mais ayant abandonné toute ambition de rupture. La "gauche de gouvernement" teylaise a internalisé le dogme néolibéral.
C'est dans ce contexte d'hégémonie du consensus monarcho-libéral et de démission de la gauche institutionnelle qu'émerge Avenir du Peuple (A!). Créé en 2014, ce parti, bien que numériquement faible à l'Assemblée (12 sièges), incarne une rupture idéologique claire. Son programme – communalisme, écosocialisme radical, démocratie directe, critique acerbe de l'OND et du capitalisme mondialisé – résonne avec les luttes originelles du mouvement ouvrier teylais tout en intégrant les préoccupations contemporaines, notamment écologiques.
Avenir du Peuple ne cherche pas à aménager le système, mais à le remplacer. Sa critique de la démocratie représentative et sa promotion de l'autogestion locale le placent en opposition frontale avec l'État centralisé teylais et les structures parlementaires traditionnelles. Son internationalisme, bien que différent de celui des eurycommunistes (plus proche du communalisme Kah-tanais ou de l'Internationale Libertaire), le distingue de la realpolitik de l'OND défendue par le MRU et, dans une certaine mesure, par LR.
Le défi pour Avenir du Peuple est immense. Il doit convaincre une classe ouvrière et des populations précarisées souvent désabusées par la politique, séduire les déçus du communisme autoritaire loduarien sans tomber dans un sectarisme contre-productif, et résister à la marginalisation médiatique et politique orchestrée par le "système". Il doit prouver que son projet n'est pas une utopie déconnectée, mais une alternative concrète et désirable.
L'histoire de la gauche teylaise est celle d'une lente dérive, d'un éloignement progressif de la base ouvrière et de la lutte des classes au profit d'une intégration confortable dans les institutions de la monarchie libérale. Le MRU, héritier de cette tradition, est aujourd'hui un parti de gestion, certes socialement plus attentif que la droite LR, mais fondamentalement aligné sur les préceptes néolibéraux.
Le vide laissé par cette trajectoire offre une opportunité historique à des forces nouvelles comme Avenir du Peuple. En renouant avec une critique radicale du système, en mettant l'accent sur la démocratie directe et l'écologie, et en s'adressant directement aux oubliés de la prospérité teylaise, les communalistes pourraient incarner le renouveau tant attendu de la gauche combative. Les élections de 2017 seront un premier test crucial. Le peuple teylais, et en particulier sa classe ouvrière, entendra-t-il cet appel à rompre avec un consensus qui semble avoir atteint ses limites ? Ou la force d'inertie du système monarcho-libéral parviendra-t-elle, une fois de plus, à contenir la contestation ? L'histoire reste à écrire, mais les lignes de fracture sont désormais visibles.
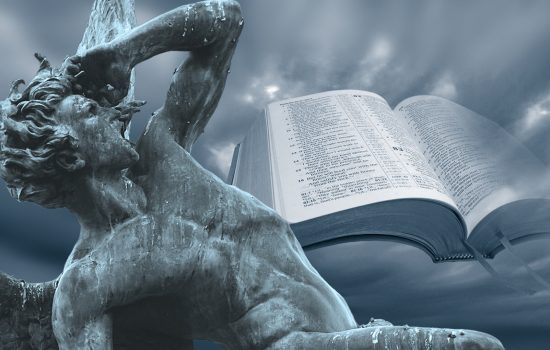





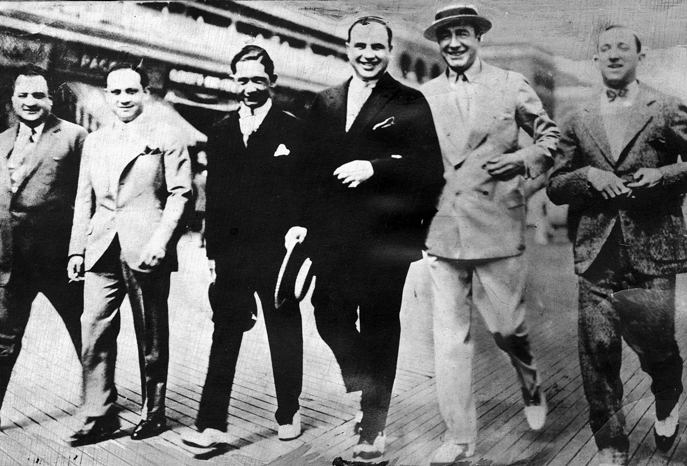
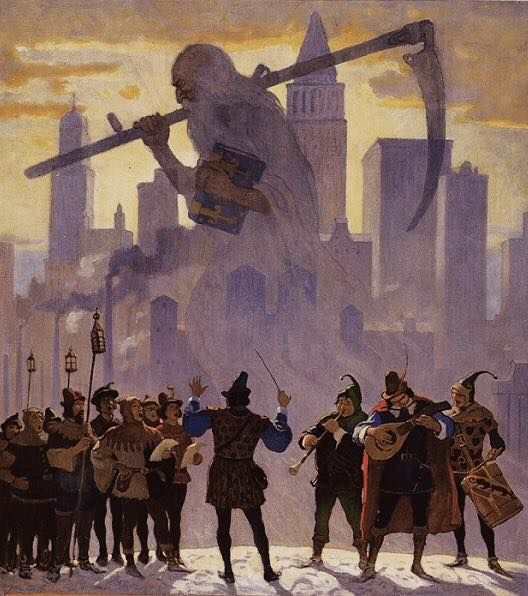


 Opération : KILL MRU.
Opération : KILL MRU. La Nouvelle Guerre Politique : Longue Marche par les Institutions.
La Nouvelle Guerre Politique : Longue Marche par les Institutions. Alimenter la Bête Nationaliste.
Alimenter la Bête Nationaliste.