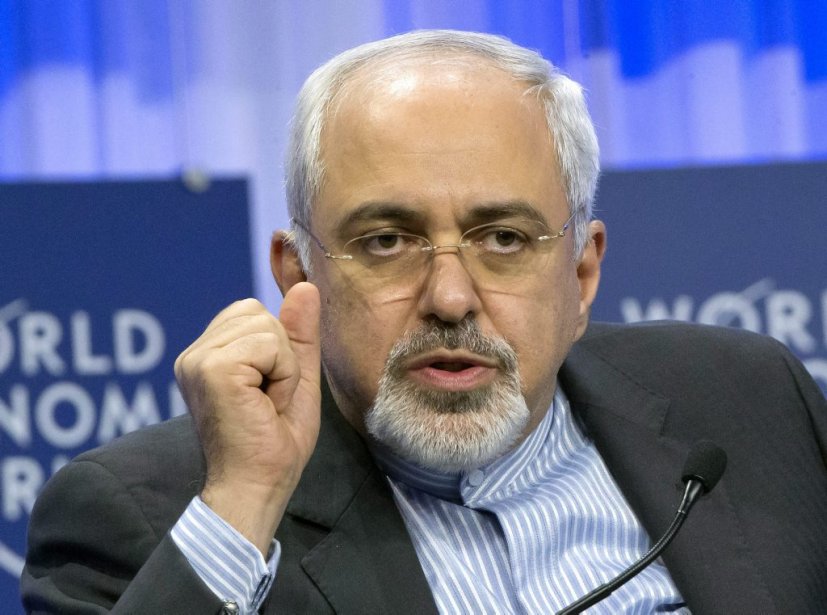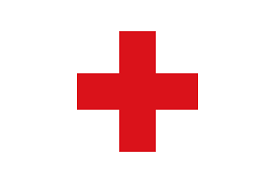... Trahir. D'accord. Mais trahir qui ?
Traduire n’est jamais un acte anodin. Au contraire, c'est une prise de position fondamentale, une proclamation géopolitique et, en dernière instance, existentielle. Une affirmation — souvent précaire, toujours nécessaire — que les idées qui façonnent le monde, ces courants tectoniques qui dessinent les continents de la pensée, ne sauraient rester les captives d'une seule langue, d'une seule culture, et surtout pas de celle qui, par le poids de l’Histoire et la mécanique inexorable de la domination, s'est imposée comme universelle dans sa fonction et, de ce fait, totalitaire dans ses implications. Surtout pas de celle-là. Car comme l'a si bien démontré Yursen Baccus, dans un diagnostic d'une lucidité glaciale, la véritable arme de l'entreprise coloniale, l'arme de destruction massive la plus efficace, ne fut ni la canonnière qui éventrait nos côtes, ni le fusil qui décimait les récalcitrants, ni même la Bible qui promettait un royaume céleste pour mieux justifier l'enfer terrestre. Non. L'arme ultime fut le bombardement culturel, cette lente et patiente éradication des univers mentaux par l'imposition d'une langue étrangère.
Le verbe n'est pas neutre ; il est le premier territoire conquis ou libéré, le véhicule par lequel une cosmologie entière, avec son Panthéon de valeurs, s'impose, redéfinissant le bien et le mal, le héros et le traître, le sacré et le profane, le possible et l'impensable. Le langage n'est pas une simple nomenclature apposée sur un monde préexistant et stable ; il est, comme le suggérait Danasabe, l'ADN d'une culture, le code génétique d'une vision du monde. Imposer sa langue, c'est donc bien plus qu'imposer un vocabulaire : c'est inoculer un code viral dans l'imaginaire d'un peuple, un code qui réécrit sa mémoire, pirate ses rêves, neutralise ses anticorps critiques et, à terme, programme sa propre obsolescence.
La langue du maître est la première des prisons, la plus subtile, celle dont les murs sont invisibles parce qu'ils sont construits à l'intérieur même de l'esprit du captif, qui finit par confondre les limites de sa cellule avec les limites du monde. Traduire, dès lors, n'est pas simplement transposer des mots : c'est opérer une décolonisation de la conscience, c’est fracturer les murs de la cellule mentale, c’est réarmer un imaginaire qui a été systématiquement démilitarisé.
Publier aujourd'hui Anatomie de la Cage du grand penseur Kamau Mboya en langue swahilie relève, de ce fait, d'une double transgression, d’une rupture consciente avec l'ordre sémantique et politique établi. La première transgression, la plus visible, est d'ordre politique : c'est celle d’introduire dans notre espace intellectuel, et par-delà dans notre conversation publique, une pensée jugée séditieuse, problématique, dérangeante par la structure impériale qui encore nous administre. Une pensée qui commet le crime de lèse-majesté de nommer la violence là où le discours officiel ne parle que de "partenariat" et de "développement" ; une pensée qui expose la prédation là où l'on nous vante la "solidarité".
La seconde transgression, cependant, est peut-être plus fondamentale encore, plus profonde dans sa portée subversive, car elle est d'ordre épistémologique. C'est le geste qui consiste à le faire dans notre propre langue. C'est de conférer à une pensée de libération la noblesse et la précision de nos mots, la cadence de nos tournures, la résonance de nos métaphores puisées dans notre terre, le souffle ancestral qui est le nôtre. C'est arracher la Théorie, avec un grand T, à l'apanage des langues du Nord. C’est refuser le postulat tacite — et profondément raciste — selon lequel nos langues, jugées aptes à chanter nos peines et nos joies, à négocier le prix des denrées sur le marché ou à murmurer les contes au coin du feu, seraient par essence inaptes à la pensée abstraite, à l'analyse rigoureuse, à la dissection conceptuelle de la nature même du pouvoir. C'est un acte de légitimation épistémologique. C'est une déclaration d'indépendance intellectuelle qui affirme, contre des siècles de mépris académique et de condescendance missionnaire, que le swahili peut penser le monde dans toute sa complexité, qu'il peut forger ses propres concepts, qu'il peut et doit devenir une langue de science et de philosophie.
Pourquoi, alors, exhumer ce texte écrit il y a trente ans par un exilé dans le froid d'une métropole eurysienne, un texte décrivant une situation coloniale qui, en apparence, n'est plus la nôtre ? On nous objectera sans doute, avec cette condescendance polie qui est devenue la marque de l'humanisme impérial, que nous vivons à une autre époque, que les jours de l'administration directe sont révolus. Que nous sommes des citoyens à part presque entière, avec des droits inscrits dans le marbre de leur Constitution, des représentants dans leurs assemblées lointaines, et même la promesse vague d'un avenir partagé. La situation actuelle est précisément délétère, en ça qu'elle a substitué à la violence brute des chaînes de fer une violence systémique bien plus corrosive, celle que Chikanari Shinzo a si magistralement décrite : la mécanique du sous-développement organisé. L'Empire n'a pas tant développé l'Afarée qu'il n'a sous-développé sa propre dépendance, structurant notre économie pour qu'elle serve ses besoins, et ses besoins seuls.
La cage dont parle Mboya dans son ouvrage magistral a simplement changé de nature. Elle n’est plus un territoire mais une conscience. Ses murs ne sont plus faits de miradors et de barbelés, mais des clauses des accords de libre-échange qui organisent le pillage légal de nos ressources, des conditionnalités de l'aide au développement qui dictent nos politiques publiques, des programmes scolaires écrits à Estham qui nous apprennent l'histoire de leurs rois mais l'amnésie de la nôtre, des superproductions culturelles qui nous enseignent comment rêver leurs rêves et désirer leurs vies. La cage est devenue, comme le théorisait Kelly Moerman, une adhésion à un "genre de l'humain" – celui de l'Homme Occidental, blanc, rationnel et propriétaire – dont nous ne sommes que la version subalterne, l'imitation perpétuellement imparfaite. C'est une dépendance économique maquillée en partenariat, une aliénation culturelle vendue comme modernité, et cette lassitude putride qui pousse un peuple à accepter sa propre dépossession comme une fatalité biologique. Le confort, pour la petite élite que le système coopte et récompense, est le plus efficace des anesthésiants.
Anatomie de la Cage, écrit par Mboya dans la solitude et l'urgence, après avoir été chassé de sa terre pour "activités antinationales", est un livre dangereux, car il ne propose aucun réconfort. Mboya, avec la froideur d'un chirurgien penché sur un corps malade — ce corps du colonisé que d’autres avant lui avaient déjà si brillamment autopsié — met à nu les mécanismes de la domination psychologique avec une rigueur qui frôle la cruauté. Dans des chapitres aux titres évocateurs — "L’architecture du vide", "La grammaire de la soumission", "La nécropolitique du rire", "L'auto-colonisation comme projet de vie" — il décrit avec une clarté insoutenable ce schisme intérieur, cette fracture de l'âme que l’on nomme désormais le complexe du colonisé. C'est l'homme ou la femme qui, pour survivre dans le système qui le nie, apprend à se voir à travers les yeux du maître, à mépriser sa propre histoire comme une chronique barbare, à considérer sa culture comme un folklore obsolète et sa langue comme un obstacle sur la voie royale du Progrès. Qui, parmi nous, en lisant ces lignes, ne sentira pas le goût de cendre d'une vérité amère et familière ? Qui n'a jamais forcé un rire complice à une blague qui niait son humanité ? Qui n'a jamais ressenti ce vertige en entendant un ancien parler, ce mélange de tendresse et de pitié pour une sagesse que le monde moderne a déclarée caduque ? Qui n'a jamais senti ce malaise persistant, cette impression d'être un acteur dans une pièce qui n'est pas la sienne, récitant un texte écrit par un autre pour un public qui jamais ne le reconnaîtra comme l'un des siens ?
Mboya, dans le sillage d’une longue lignée, nous force à voir ce processus non comme un échec personnel, une faiblesse de caractère, mais comme le résultat logique, quasi mathématique, d'une structure de pouvoir conçue pour broyer les identités afin de mieux assimiler les corps et les ressources. La légitimité du système impérial repose entièrement sur cette amnésie organisée, sur notre incapacité à voir la cage pour ce qu'elle est. C'était ainsi.
Traduire cet ouvrage en swahili, donc, c’est opérer une greffe sémantique, une transplantation conceptuelle d'une nécessité vitale. La langue impériale, par sa structure même, est inapte à décrire la violence qu'elle engendre du point de vue de ses victimes. Elle possède les mots pour "croissance économique", mais pas pour "siphonnage des richesses" ; pour "stabilité régionale", mais pas pour "pacification des résistances" ; pour "intégration", mais pas pour "ethnocide". Elle produit ce que le sociologue Amand Huemac Chardin appelle un épistémicide : la destruction massive des savoirs, des expériences et des manières de voir le monde des subalternes, les rendant inintelligibles et donc inexistants. C'est pourquoi importer les concepts de Mboya — "la conscience serve", "l'auto-dépréciation structurelle", "la violence symbolique" — et leur trouver des équivalents qui résonnent avec la mémoire de nos anciens, en puisant dans la richesse de notre propre lexique, c'est commencer le long et ardu travail de désintoxication mentale. C'est forger dans notre langue les outils pour penser notre condition, pour mener notre propre enquête sur nos propres malheurs.
C'est précisément ce que théorisait Chardin : la culture est le terreau de la résistance, l'élément dynamique qui permet à une société de préserver son histoire tout en projetant son avenir. L'acte de traduction devient un acte de culture au sens le plus fort : un facteur de mobilisation. C'est passer de la mélancolie à la colère, de la colère à l'analyse, et de l'analyse à l'action organisée. Le verbe lui-même devient un acte de résistance, la première fissure dans les murs de la cage. Car un mal qu'on ne peut nommer est un mal qu'on ne peut combattre ; il reste un sentiment diffus, une angoisse sans cause apparente, une mélancolie sans objet. Un poison lent.
En conséquence de quoi, nous ne présentons pas ce livre comme une curiosité historique ou un simple exercice intellectuel pour les salons de Kenkela. Il doit être reçu pour ce qu'il est : un outil. Un scalpel pour disséquer les discours officiels sur le "développement" et la "solidarité impériale". Un miroir pour nous confronter sans complaisance à notre propre aliénation. Et peut-être, seulement peut-être, une première carte pour naviguer hors du labyrinthe, une boussole pour atteindre une épistémologie du Sud global. L'Histoire, contrairement à ce que la propagande de l'Empire voudrait nous faire croire, ne s'est pas arrêtée avec notre pacification. Elle n'est pas ce fleuve tranquille qui nous porte vers un destin déjà tracé par la bienveillance de nos maîtres, dont nous avons vu la nature véritable et le vrai visage dans deux siècles d’asservissement brutale. Elle est une succession de ruptures, un champ de forces où la conscience est l'arme la plus décisive.
Certains diront que cette publication est une provocation. Nous le comprenons. Si dire la vérité telle que nous la percevons, du point de vue de nos blessures et de nos espoirs, est une provocation, alors nous sommes des provocateurs. Si aspirer à une pleine et entière souveraineté, non seulement politique et économique, mais mentale, culturelle, et, en dernière instance, spirituelle, est un crime au regard de la loi impériale, alors nous plaidons coupables. Kamau Mboya a écrit ce livre pour son peuple, à un moment crucial de son histoire. Il se trouve, par la contingence cruelle des dynamiques de pouvoir qui régissent ce monde, que son histoire est encore, en partie, la nôtre.
Ce livre se présente comme un diagnostic. À nous, désormais, de regarder le mal en face et, enfin, de chercher à guérir.