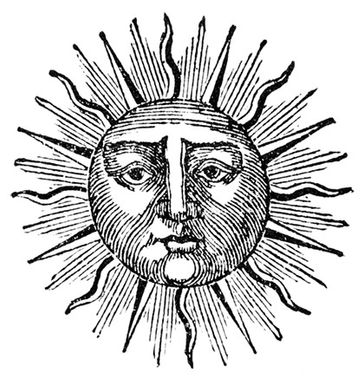Le LevantLittérature, culture, voyages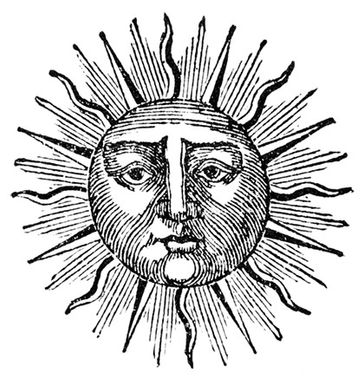 Le grand retour de l'instabilité du continent afaréen : des générations entières traumatisées, une empreinte sociale durable
Le grand retour de l'instabilité du continent afaréen : des générations entières traumatisées, une empreinte sociale durable

[justify]On ne compte désormais plus le nombre des victimes fauchées par les missiles balistiques churaynn, le voisin occidental de notre pays. L'emballement de la machine de guerre impériale envers des populations afaréennes se heurte partout où l'on en parle à l'incompréhension : au sein des pays touchés bien-sûr - Trois Nations, Garmflüßenstein - ainsi qu'au Banairah et aux pays limitrophes, mais également à l'international, notamment au royaume de Teyla, du fait de sa proximité via ses outre-mers, et dans bien d'autres pays. La menace latente d'un embrasement du continent, voire même de l'ensemble du pourtour blêmien pèse lourdement sur les consciences de nos concitoyens, à en croire les témoignages spontanés qui nous ont été envoyés via notre courrier des lecteurs. Il est fort à parier que ces événements tragiques, auxquels s'ajoutent les massacres de masse opérés par la funeste Principauté de Carnavale en Empire du Nord et en Kabalie, marqueront d'une façon indélébile la politique, la société civile et sa culture des décennies à venir.
"Je sens le rêve banairais en péril"Nombreux et nombreuses sont nos lecteurs et lectrices ayant évoqué leur inquiétude quant à la pérennité du système banairais tourné vers l'entente régionale, le développement économique pacifique et la défense des états afaréens. Dans un monde diplomatique bien plus instable où les puissances frontalières ne sont plus de confiance, il devient compliqué d'imaginer la poursuite des idéaux banairais. L'augmentation des moyens de défense de l'Al Dayha passera sans aucun doute parmi les priorités de fin de mandat du Khasser Saroud Al Tenhè et de son gouvernement, et occupera le premier mandat de son successeur dès les élections de 2018. Pour beaucoup de nos correspondants, cela pourrait signifier une mise en marche nécessaire de la société civile vers la production militaire, au détriment des investissements d'avenir dans l'optimisation des industries, l'écoconception et le maintien d'une production matérielle en lien avec les ressources nationales et planétaires. "Le budget n'est pas extensible, et je crains que ces attaques n'obligent le gouvernement à réallouer des fonds pour l'armement. Mais notre avenir au long terme ne devrait pas être sacrifié à cause de barbares, c'est injuste" nous confie Shaakira, 27 ans. "L'irresponsabilité a un prix, et ce ne sera jamais les responsables qui le paieront", s'inquiète Haatim, 62 ans.
Ces actes barbares, perpétrés sans avertissement ou négociations au préalable, témoignent de l'impossibilité des autorités de l'Empire Islamique de Churaynn de se comporter comme des partenaires de confiance, et ce peu importe le sujet. Véritable frein au développement de normes et de mesures communes, c'est l'ensemble du pourtour blêmien et de l'intérieur du continent qui devra composer avec un élément turbulent et imprévisible dont la parole ne vaut rien. Un tel climat de défiance fera reculer, si ce n'est pas déjà le cas, la confiance des acteurs internationaux aux marchés est-afaréens au vu des risques inhérents au passage des bateaux, avions et convois terrestres, et ce d'autant plus si lesdits partenaires commerciaux possèdent des territoires au passé colonial ou coopèrent avec de tels états.
Certains retours nous donnent quelques lueurs d'espoir : Irfaan, 49 ans, nous souligne le rôle primordial que doit jouer notre pays dans la crise qui se joue en ce moment même, et pense qu'une telle situation pourrait au contraire provoquer un élan de fraternité transcontinental, mais aussi une volonté de coopération entre les différents régimes non belliqueux de la région : "Je m'inquiète surtout pour les populations touchées, qui en plus du passé colonial qu'ils ont vécu et des discriminations et du manque de liberté qu'ils subissent, sont également les premières à souffrir des soi-disantes opérations de décolonisation de Churaynn et de l'Antegrad. Pour le reste, l'ampleur de la menace qu'ils pèsent suffira, je pense et je l'espère profondément, à fédérer le restant des états de la région pour faire cesser ce désastre."
"Nous vivions dans l'illusion d'un continent relativement épargné par la guerre"Beaucoup de vos retours ont effectué un rapprochement entre l'actualité continentale et l'atmosphère irrespirable de l'Eurysie. Si les commentateurs et commentatrices banairais n'hésitent pas à dénoncer les attitudes militaristes et les éternelles poudrières qui caractérisent si bien ce continent aussi disparate que dangereux, ils sont souvent plus surpris lorsqu'il s'agit d'affaires afaréennes. "Dans les bombardements impériaux, je crois voir ceux de Rasken", s'exclame Izza, 20 ans, qui nous parle brièvement de l'étude de cas qu'elle avait pu réaliser lors de son parcours académique en journalisme et en géopolitique. "Certains régimes ne s'encombrent pas des valeurs morales portées par les démocraties du même nom et profitent de la faiblesse de leurs voisins afin d'imposer un rapport de force. Les raisons invoquées sont celles de la libération de territoires de ses occupants illégitimes, mais font fit du dialogue et de la diplomatie et ignorent la souveraineté des états et le poids des pertes civiles suite à de telles manœuvres qui, souvenons-nous en, font des civils les principales victimes, et ce résultat probant stratégiquement parlant." Longtemps vu par maints esprits du XXe comme du XXIe siècle comme l'apanage du vil colon eurysien, l'impérialisme militariste décomplexé n'a pas d'origine ethnique. En cela, l'actualité nous le rappelle tristement et bouleverse les systèmes de croyances de milliers d'Afaréens. Loin de décrédibiliser la cause anti-colonialiste, cette réalisation doit au contraire nous aider en tant que populations citoyennes et décideuses à rester alertes quant à la politique que nous menons en notre pays ou via ce dernier. De telles exactions, loin de faire avancer la cause, provoqueront à coup sûr la défiance des régimes centraux en charge des colonies encore existantes, ou bien des territoires en émanant, mais aussi de la population locale, fusse-t-elle indigène ou non. A la suite de ces attentats de grande échelle, il sera également politiquement impossible pour les gouvernements centraux en question d'avancer sur le droit des populations en place, car de telles actions pourraient être perçues comme un aveu de faiblesse face à leurs ennemis déclarés. C'est en tout cas, ce que nous raconte Rayyana, 65 ans, qui évoque par la même occasion son expérience en tant qu'aide humanitaire à travers le continent : "Pour que nous puissons opérer et aider les populations en péril, il faut déjà que celles-ci nous fassent confiance. Certes, le Banairah n'a rien à voir avec le Churaynn, mais cette trahison que constitue le bombardement d'Afaréens par d'autres Afaréens restera gravé dans leur mémoire et n'aidera en rien mes anciens confrères et consœurs dans leur travail.".
"Ecrire pour vivre"Certains parents sont également venus trouver réconfort auprès de nos rédacteurs s'occupant du courrier des lecteurs. A la charge mentale d'un avenir violent et incertain s'ajoute celle de protéger autant que possible leurs enfants, chose difficile lorsque les récents événements sortent de toutes les bouches. "Je ne sais pas comment gérer la situation", nous avoue Shuaib, 39 ans, père de deux enfants. "En même temps je ne veux pas leur faire peur, mais je ne peux pas non plus ne pas leur en parler. Ils en entendent parler partout, que nous le voulions ou pas.", continue-t-il. Lui, comme bien d'autres, a donc trouvé en attendant une manière de se décharger mentalement vis-à-vis des récents événements : il écrit ses pensées dans un carnet afin de s'en débarasser. "Cela m'aide à continuer à vivre normalement. Des fois j'ai l'impression d'en faire trop, de trop me sentir concerné alors que je n'ai pas été touché par ses attaques, mais je sais que ça ne sert à rien de réfléchir ainsi. Je sais que beaucoup de gens autour de moi ne sont pas autant affectés par ce qu'il se passe, je sais que je suis quelqu'un de facilement inquiet, mais c'est ainsi, pour moi c'est important". Si cela peut rassurer Shuaib, il n'est pas le seul à avoir exprimé ce besoin d'extérioriser le ressenti face à ces événements. Cette pratique est d'ailleurs recommandé par de nombreux spécialistes du domaine de la santé, n'hésitez donc pas à y avoir recours, que ce soit dans ce contexte ou dans un autre.