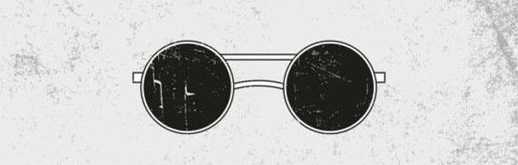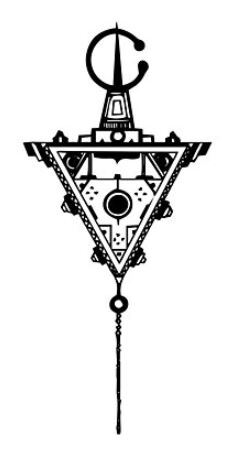Posté le : 19 oct. 2022 à 08:33:26
16475
Chasseuses, féminisme et bombes.
Le sanglier des rocheuses galope sous un soleil de plomb. Ses pieds claquent contre les pierres et les éboulis alors qu’il grimpe, attentif, le flanc de la colline. D’une vitesse et d’une agilité surprenante, l’animal est ici dans son domaine : chaque pierre lui appartient. Son pelage raid, encore plein de la vase où il a dû se baigner, pue d’une odeur musquée, familière. C’est une chose territoriale. Tant que le terrain est propice, qu’on y trouve à manger, à boire, elle finit toujours par y retourner. Tout est territorial, dans la nature. Le poète Hamza Idrissi lui-même observait que les oiseaux revenaient chaque année nidifier au même lieu. Les arbres prenaient racine, évidemment, et le gibier ne s’éloignait pas de son territoire. Et si les pierres pouvaient bouger, pensait-il, elles ne feraient que de rapides tours, revenant se loger là où l’érosion les avait laissées de telle façon qu’on y aurait pas vu la différence. Récemment, on les avait beaucoup dérangés, les sangliers. Dérangé en construisant des champs, des routes, des habitations, des clôtures et des grillages. Mais la province était grande, encore peu urbanisée, et les bêtes n’avaient pas eu de mal à trouver de nouveaux territoires. Celle-là avait peut-être migré, ou bien n’avait-elle pas eu à fuir. Cela ne changeait rien : elle se comportait ici comme elle l’aurait fait ailleurs : en maîtresse des lieux.
Arrivée au sommet du promontoire rocheux, l’animal trottine jusqu’à un bosquet d’arbres bas et secs, aux pieds desquels prospèrent quelques buissons de baies. C’est un bel endroit, les feuilles friables abritent du soleil mais pas de la lourdeur de l’air, on devine qu’il doit y avoir de l’eau, quelque-part sous la roche épaisse et la terre dure. Les sabots de l’animal la raclent, ça cherche quelque-chose, peut-être.
Il y a des plantes grasses, à l’écart. Elles donnent aussi des fruits à cette saison. L’animal hésite, hume l’air. Prudence innée, inscrite dans son code génétique ou forgée par l’habitude d’une humanité bien souvent hostile. Il ne sent rien. L’atmosphère, ténue et pesant, ne porte pas d’odeur, faute de vent. Alors il approche encore un peu des buissons, et baisse la tête, gueule béante, pour avaler les fruits.
Le claquement sec d’une détonation résonne dans l’après-midi. Puis il y a un gémissement terrible, sourd, guttural. L’animal gueule comme si ça pouvait changer quoi que ce soit. Il est étalé au sol, ses sabots battent le vide et ses yeux roulent dans leurs orbites. Sa langue tirée lui donne un air pathétique. Une seconde détonation, cette-fois son crâne explose, rompt comme œuf jeté au sol : le sang se déverse sur les buissons dans un déluge visqueux, draguant dans son flot des éclats d’os et de cervelle. Figé dans son calvaire. Sa puanteur est déjà affreuse : on peut maintenant l’approcher.
Asrar range son fusil. Elle sait mieux que quiconque qu’une détonation peut attirer le genre d’attention qu’elle veut à tout prix éviter, seuleent la chasse est une vieille coutume, ici, et elle ne compte pas laisser l’Histoire et ses vicissitudes l’empêcher de l’honorer.
C’est une petite femme. Prématurément vieillis par le soleil et les difficultés propres à la vie au bout du monde. Dans ces territoires effleurés par la modernité, juste assez pour qu’elle y ait charriée toutes ses horreurs, mais aucun de ses avantages. Une fille de la colonisation, de l’humiliation ancestrale infligée aux petits par les nobles d’ici, puis plus tard d’ailleurs. Ses cernes, ses cicatrices, son corps menu et sa petite tailles, témoignent de plusieurs vies de souffrance dont elle est, peut-être, à la fois le résulta et la fin. Du moins elle l’espère.
Pour elle, la chasse est une question de survie. Ou, pendant des années, s’agissait de ça. Maintenant le village avait importé le modèle coopératif. On avait cessé de vendre à perte, pour partager à profit. Elle chassait toujours, parce que le goût de la viande, la viande de gibier, à la fois consistante et forte, celle que l’on obtient pas en tuant un animal par ailleurs utile comme le sont les chèvres, la volaille, les vaches, ne l’avait jamais quitté. Aussi, car elle apprenait ainsi à se cacher. À tirer. Deux compétences qui lui seraient utiles, elle le savait dans le fond de son être, dans les jours à venir. C’est tout le Kodeda qui puait le charnier. Et pendant que les petits hommes en vert de l’empire, ces blancs suants milles morts et haineux de leur exil imposé dans ce qu’ils ne voyaient que comme un avant-goût de l’enfer, les mercenaires des nouveaux empires s’amassaient au chevet des prétendants au trône. Elle le savait très bien : l’avenir serait un bain de sang. Elle ne croyait pas à la victoire des forces du bien tout simplement parce qu’elle ne croyait pas en la moralité de l’univers. Le monde était fait pour les chiens, c’étaient eux qui gagnaient. Elle et les siens n’auraient donc qu’à chasser. Tuer autant de chiens que possible, que leur victoire ait un goût de sang et d’urine, de sueur versée pour rien, de dents cassées par une crosse de fusil.
Asrar s’assura une fois encore d’être bien seule. Son tir ne semblait pas avoir alerté qui que ce soit : elle ne voyait rien, n’entendait rien. Rien qu’elle et le silence des rocheuses. Alors se mit-elle en route à pas de loups, naviguant d’expérience à travers les pierres. Elle était autant à sa place, ici, que le sanglier. Elle était autant fille des collines que l’animal. Mais elle, en bonne prédatrice, connaissait la vertu du silence. Emmaillotés dans des vêtements traditionnels qui cachaient son visage et ses bras du soleil et de la poussière, elle progressait comme un spectre coloré, ocre, animal gracile et vengeur à qui son fusil donnait des airs de guérilleros en devenir. Elle incarnait peut-être, en cet instant, une certaine idée de l’émancipation qui ne passait ni par la philosophie des sœurs du sud lointain, ni par la politique des kah-tanaise utopistes, ni par le mensonge obscène de cette femme, héritière d’une noblesse voleuse, qui parce qu’elle payait des mercenaires du sexe opprimé prétendait soudain défendre l’émancipation. Il n’y avait bien que ses scribouilleurs, dépendant du salaire qu’elle et ses amis impérialistes leur versaient, pour prendre tout ça au sérieux.C’était ridicule. Au moins dans son village – et pour autant qu’elle puisse en juger, dans les autres aussi – on riait beaucoup. Des soldates femmes restaient des soldates. Les soldates étaient l’ennemi de la libération parce qu’elles travaillaient toujours pour les oppresseurs. Combien de soldates femmes, dites-moi, princesse, avant que les hommes cessent de battre leurs femmes ? Avant que l’éducation soit ouverte à tous ? Que les villes n’aient plus peurs des garçons et les décideurs des deux sexes ?
Arrivant sous les arbres bas, Asrar retourna la carcasse pour mettre à jour son ventre. Elle avait abattu un mal. Jamais que le premier porc de son palmarès, pensa-t-elle cyniquement.
Laissant sa besace tomber au sol, elle la déplia, et y fourre l’animal. Le corps mort semblait comme offrir une résistance résiduelle. Empestant terriblement, ses effluves n’étaient rien face à la rigidité de ses muscles compacts et de ses os. Asrar dû appuyer de tout son corps pour recroqueviller l’animal dans l’espace confiné du sac. Ses deux yeux morts semblaient la fixer d’un air débile. Sans trop savoir pourquoi, elle se saisit de sa langue pour l’enfoncer dans sa gorge.
Elle passa les lanières du sac autour de ses épaules et, soufflant d’un coup sec, se redressa. Elle était un peu comme l’animal, à bien y penser : compact, musculeuse. L’animal était une belle prise, et son poids était un bon poids. Mais rien qu’elle ne saurait transporter. Il serait toujours inférieur à celui des responsabilités présentes et à venir. Cette période d’entre-deux, à la fois calme avant la tempête et bref instant de répit, entre la misère et la guerre, n’était pas si agréable que ça. Elle vivait dans l’attente de la fin.
Assurée que les lanières tenaient bon, que le sac était bien solide, comme il l’avait été durant ces fidèles années de service, elle se mit en route, rebroussant chemin jusqu’au bas des rocheuses, où attendait la camionnette qu’on lui avait prêtée. Au bout de la route, à quelques kilomètres, le village. Le voyage ne fut pas long.
L’odeur du feu et des légumes grillés couvrait celle du cadavre. Bientôt ce serait au tour des lanières de viande, dûment préparées et couvertes d’un enduit d’huile et d’épices, de passer sur le grill et d’embaumer délicieusement l’atmosphère de ce début de soirée.
Quand elle était rentrée au village, Asrar s’était garée devant le petit atelier, celui attenant aux cuisines communautaires où s’affairaient déjà quelques villageois. Principalement des femmes et leurs enfants, mais aussi quelques hommes qui avaient assimilé, depuis le temps, les bases d’une vision plus égalitaire du monde. La cuisine, en soi, avait de toute façon quelque-chose d’agréable. C’était un moment important de sociabilisation et, aussi, de ce que les urbains appelaient la politique. La chose publique avait colonisée tous les espaces de conversation de telle façon qu’on se prenait désormais de passions sincères pour des questions que l’on aurait jugées saugrenue quelque temps encore. Saugrenue, car on aurait jamais pensé qu’il était possible, pour un petit village seul, de décider lui-même de son avenir. Maintenant on parlait du moulin qu’il fallait créer, et de comment s’y prendre. De ce que les autres villages proposaient en échange des céréales cultivés, et de cet ingénieur qui pouvait venir dans les plus brefs délais pour aider à réparer l’un des tracteurs. Une actualité qui devenait politique dès-lors que l’on avait le courage de s’en saisir.
Quand elle sortie du pick-up, Asrar fut accueillie par Darifa Jouahri, autre chasseuse, qu’elle qualifiait affectueusement de sœur d’armes. Comme elle une milicienne, comme elle une de ces femmes qui n’avait pas attendu le PIK pour se poser des questions, mais s’était rattaché à son mouvement par opportunisme et intérêt sincère. Elles s’étreignirent brièvement puis Darifa laissé éclater une exclamation de joie en voyant la taille du sanglier à l’arrière du véhicule. Elle avait forcé le ton, ce qui eut l’effet escompté : les enfants sortirent en courant de la cuisine communautaire, tournant autour de l’animal mort, s’exclamant à leur tour. Les adultes, qui pelaient les légumes, préparaient les huiles, discutaient, jetèrent un œil à la scène, saluèrent Asrar. L’un des hommes vint lui demander si elle voulait de l’aide pour déplacer le sanglier, ce qu’elle accepta. Lui et Darifa s’occupèrent donc de le déplacer dans le petit atelier, renvoyant par la même les enfants en cuisine, où s’était rendue Asrar pour boire de l’eau et prendre des nouvelles de l’avancée des préparatifs.
Aujourd’hui était, comme d’autres jours arbitrairement choisis dans l’année, un genre de jour de fête. On allait manger, danser, discuter avec ces gens d’autres villages et de la ville. Autour de grands braseros et de viande fraîchement chassée et dûment préparées
Là encore l’évènement avait une nature politique en pratique plus qu’en théorie. Par définition, les fêtes villageoises étaient la chose la plus politique des campagnes traditionnelles : la seule qui appartenait vraiment, de bout au bout, au peuple. La chose publique par excellence, renouvelée ici par l’incorporation dans un contexte où de plus en plus de choses devenaient, pour de bon, publiques. Ainsi, pour dire les choses simplement, on reproduisait ce que d’autres peuples, cultures, avaient fait à d’autres époques et d’autres contextes dans les mêmes buts : puisqu’on ne pouvait pas vraiment tenir de meeting politique, c’était de toute façon la chose du PIK, dont certains éléments étaient vilainement occidentalisés, pour toutes leurs autres vertus, on allait organiser un banquet. Il aurait été bien mal venu pour le gouvernement d’interdire un banquet, ou toute autre célébration traditionnelle rythmant la vie autrement très terne de ces campagnes, même réorganisées et modernisées par les théories politiques communalistes et l’important apport de capitaux qu’avaient provoqués certains investissements étrangers.
C’était d’ailleurs le sujet de ce banquet. On voulait parler de cet évènement tout à fait perturbant qui avait eu lieu, quelques jours plus tôt. Perturbant mais pas plus, car si l’arrêt soudain du chantier de la route suite à une attaque avait de quoi inquiéter la population jouissant des bénéfices les plus directs de cette opération, on s’était préparé dé longue date à ce que la coopération entre le gouvernement et le clan Saadin donne lie à ce genre de résultat. Car c’était bien ça, non ? Le clan Saadin et ses mercenaires attaquent, encore et encore, le gouvernement listonien ne fait rien, ou pas grand-chose, et profite de la situation pour détruire l’une des rares bonnes choses que la région portait encore en son sein.
Non ?
Pas nécessairement. C’était bien le problème : on avait des doutes sur le sujet ; On manquait d’information. Le PIK et ses éléments : clans, syndicats, partis politiques, amicales divers, groupes d’intérêt économiques, associatifs, avaient décidés d’organiser une consultation visant tant à prendre une décision qu’à déterminer si, par hasard, l’un des éléments de ce grand labyrinthe politique, n’avait pas des informations éclairant la situation.
Au sein du village on avait peu de certitudes, mais énormément de soupçon. Et une rancune qui prenait des tons de plus en plus désespérés à mesure qu’on se persuadait que les promesses d’améliorations et de lendemains heureux seraient de plus en plus dures à tenir si on ne débarrassait pas la région et des impériaux, et du clan. Pourtant, on – à comprendre, le PIK – avait explicitement demandé d’éviter toute action contre la Listonie. Justement parce que rien n’indiquait son implication dans la situation, aussi parce qu’on voulait éviter une guerre meurtrière qui aurait pour effet de détruire la région d’une part, et de donner à l’ennemi le plus redouté de tous, l’amicale impérialiste de l’ONC, une opportunité d’envahir la région. Une crainte véritable que la relative confiance dans les acteurs locaux – qu’il s’agisse des communes kah-tanaises, comprises comme des entités indépendantes et sœurs – ou l’Althalj, peu comprise mais adorée, ne suffisait pas à éteindre. Que pouvait un petit morceau de pierre face aux empires goinfrés de sangs et d’armes ? Que pouvait le Kodeda, ses rêves de liberté, face au monde ?
Espérer, et faire des banquets.
« Tu as peur ?
– Je ne suis pas une imbécile. Bien-sûr que j’ai peur. »
À ce stade, Asrar a les deux mains profondément enfoncées dans le vide ouvert du sanglier. Il fait frais, dans l’atelier, parce qu’il est fait pour traiter la viande. Propre, étonnamment, on y trouve pas de mouches, ou d’autres insectes qu’on imagine habituellement lorsque l’on parle d’une boucherie de village. Ici on fait les choses biens. Asrar, qui a appris de ses parents, s’y applique avec beaucoup de soin, pouvant quand nécessaire compteur sur le soutien de Darifa. D’abord elles ont sectionné la chair à plusieurs endroits, puis ont tirées sur la peau épaisse pour la retirer dans trop l’abîmer de la carcasse, révélant une chair rose et fibreuse. Les pieds et la tête du porc se trouvent à l’écart, à côté des pattes, qui feront de beaux jambonneaux. Le ventre a été ouvert et Asrar, qui porte des gants, sectionne proprement : on retire le foie, le tube digestif, sans rien déchirer, sans déverser la merde sur la bonne viande. Tout va dans un seau, aux pieds de l’établi. Darifa grogne.
« Pourtant c’est sur nous qu’ils comptent.
– Sur nous et sur beaucoup d’autres. Ismaël m’avait comparé ça à être des centaines à tenir une pierre. Quand tu fatigues, tu peux toujours retirer tes mains un instant : les autres tiendront toujours.
– A condition qu'on se repose pas tous en même temps.»
La phrase est ponctuée du bruit des tripes que l’on verse dans le seau. Suivront les poumons, le cœur, toute une tuyauterie qui semble presque étrange, alien, dans le contexte quasi-clinique de cette dissection traditionnelle.
« Ils vont essayer de nous massacrer, jeta enfin Darifa. Ce sera comme le Pontarbello.
– Je sais pas. Je crois pas trop à l’invasion. Je crois surtout qu’ils vont tenter de tuer le mouvement sans un bruit. Et qu’est-ce qu’on pourra bien y faire, dans le fond.
– Les tuer bruyamment. » Elle haussa un peu les épaules. « Tu serais prêtre à mourir pour ça, toi ?
– Je crois que oui. »
Le Kodeda était de ces régions du monde dont la culture n’admettait pas les paroles en l’air. C’était l’une des forces et des faiblesses de ces gens, assez terre à terre, pour qui une croyance n’avait de valeur que si elle s’appliquait. L’action plutôt que les mots. En un sens, quand on s’engageait dans une milice, surtout une qui ne payait pas, n’existait, en substance, pas pour répondre au besoin d’un riche héritier capable de payer mais à ceux d’un groupe se sentant réellement en danger, c’était qu’on était prêt à aller jusqu’au bout. Tuer. Être tué. Faire des choses affreuses.
« J’espère qu’on en sera pas réduit à ça. Au terrorisme, à ce genre de choses.
– Tuer des Listoniens, je crois que ça ne me ferait rien. Tu veux le couteau ?
– Merci. » Elle attrapa la lame et continua son travail, élargissant la section verticale taillée dans la carcasse de façon à la découper en deux dans le sens de la longueur.
« Les mecs tuent et violents depuis des siècles, je sais pas s’ils pleurent quand ils pensent au Kodeda.
– Ils pensent à l’empire, à sa gloire, des conneries. Puis ils se branlent parce que c’est trop l’éclate, d’avoir un empire.
– C’est ça. Donc les tuer, moi, ça ne me dérangerait pas. Ils peuvent être innocents, à un moment donné nos filles le sont aussi. Et elles sont pas épargnées.
– Tu penses à quoi ?
– Aux bombes.
– Ah. »
Les bombes. Vaste sujet. Proposé mainte et maintes fois, toujours ajourné, rejeté, refusé. Jamais pour les mêmes raisons. Préserver la paix, éviter l’embrasement, ne pas tomber dans l’illégalisme tant que possible. On avait préféré l’action non-violente. Les grèves, les occupations, l’entre-aide, l’éducation populaire. C’était une idée intéressante, certes, mais si on ne faisait pas souffrir l’empire, il ne lâcherait jamais l’affaire. C’était un animal vulgaire et stupide, qui n’évoluerait pas sans un solide coup sur la nuque. Voilà tout. Il fallait, en gros, lui faire comprendre qu’il ne pourrait jamais rien faire de la province. Et pour ça, la solution restait toujours et encore celle de la bombe.
« Mais... Au Kodeda, tu penses ?
– Tu le gardes pour toi ?
– Toujours.
– J’ai rencontré la kah-tanaise. L’Ingénieur.
– Et qu’a-t-elle dit ?
– Que ça pouvait se faire en Listonie. »
Elle n’ajouta rien, et son amie ne lui posa pas la moindre question, se contentant d’acquiescer en débitant la viande. En Listonie. Projet ambitieux, mais elle au rythme où allaient les choses